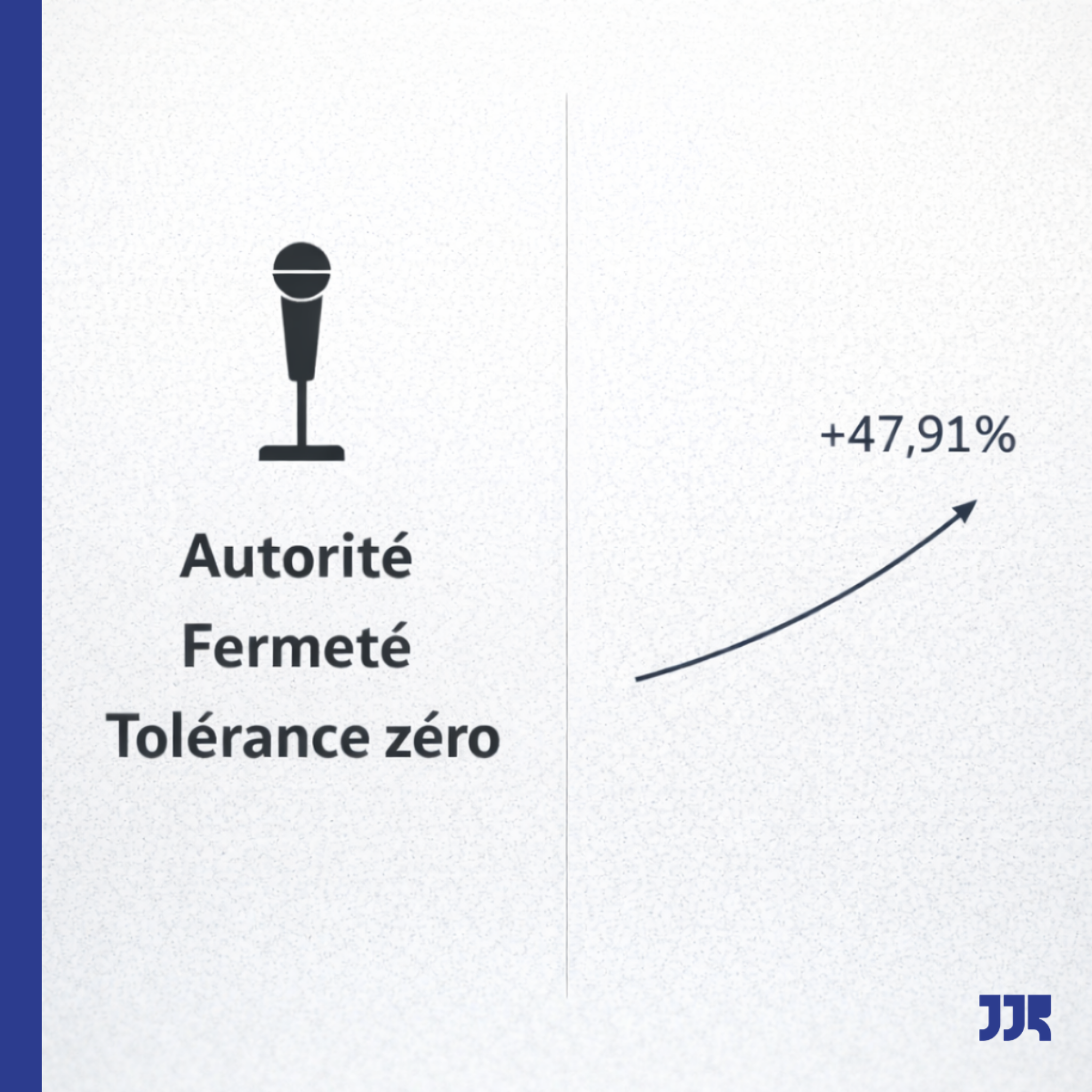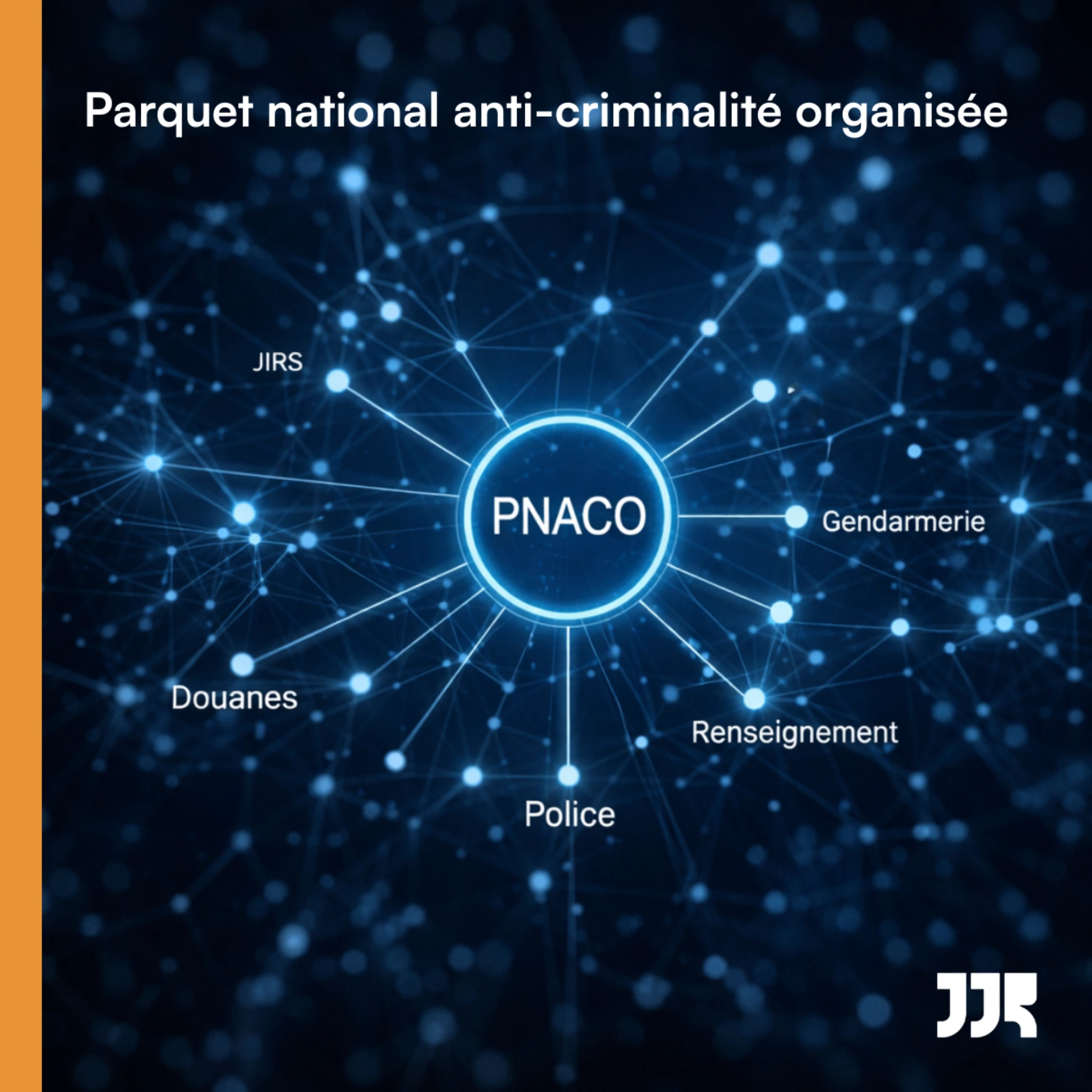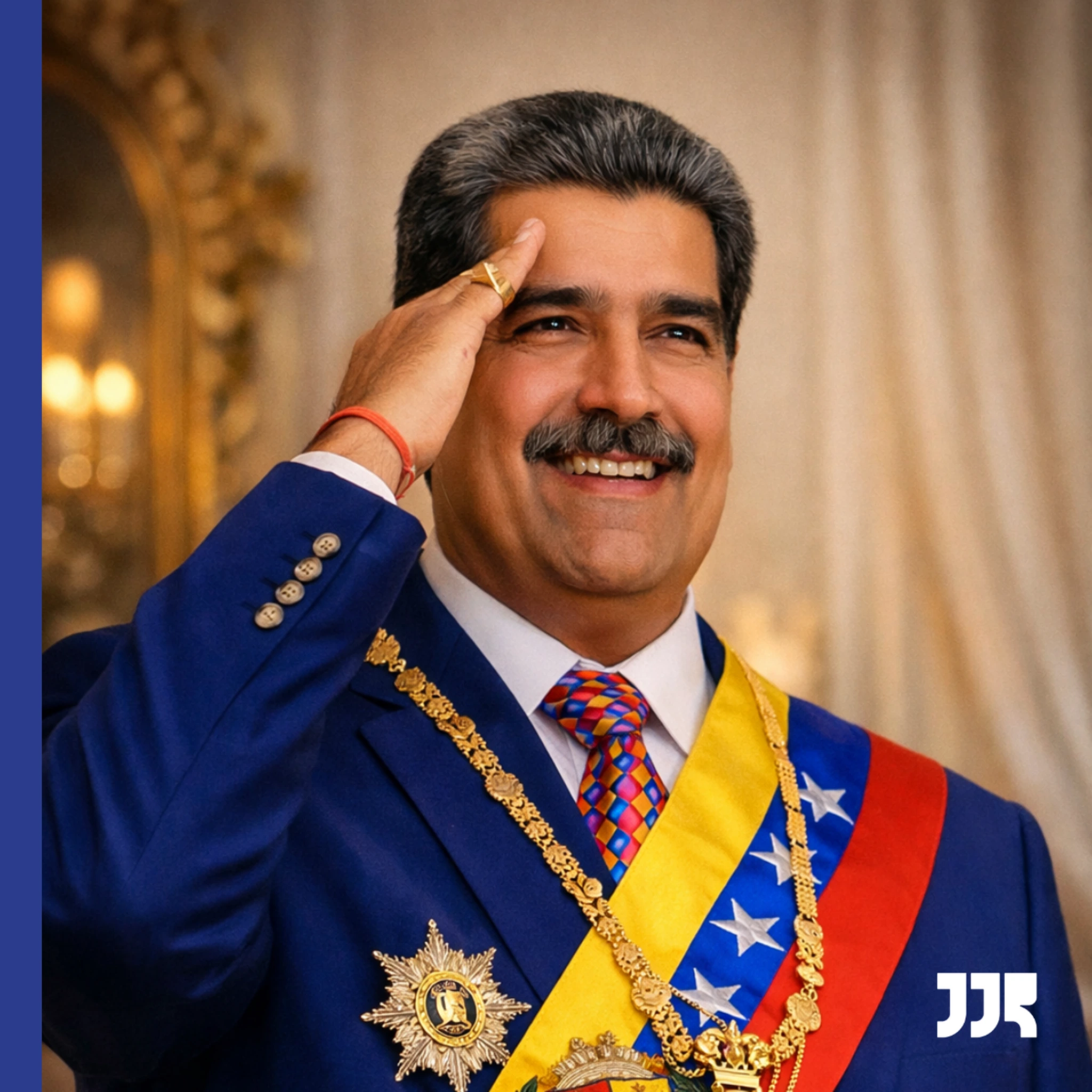Le 28 avril 2025, une large partie de la péninsule Ibérique s’est retrouvée plongée dans l’obscurité. En quelques minutes, l’électricité a disparu des foyers, des entreprises, des infrastructures critiques. Dès le lendemain, les autorités espagnoles et portugaises s’efforçaient de rassurer : la piste d’une cyberattaque était, selon elles, écartée. Pourtant, dans le même temps, plusieurs enquêtes étaient ouvertes, jetant le doute sur ces affirmations précipitées.
La fragilité des assurances immédiates
Alors que la population cherchait à comprendre l’origine de cette panne inédite, les autorités avançaient une certitude. Non, il ne s’agirait pas d’une cyberattaque. Non, il ne faudrait pas voir dans cet événement la main invisible d’un acteur hostile.
Et pourtant, plusieurs signaux faibles venaient troubler cette confiance affichée. Le Centre national de renseignement espagnol évoquait une « activité inhabituelle » en provenance d’Afrique du Nord observée dans les jours précédents. L’Audience nationale ouvrait de son côté une enquête pour sabotage. Ce paradoxe, entre certitude proclamée et prudence judiciaire, interroge profondément sur notre rapport à l’information de crise.
Peut-on écarter une hypothèse aussi grave que celle d’une attaque informatique quand, simultanément, on lance des investigations de grande ampleur pour en vérifier la possibilité ?
Le temps des certitudes éphémères
La gestion de crise obéit souvent à une exigence immédiate de communication. Face au choc émotionnel d’une panne massive, face à l’inquiétude légitime des citoyens, l’instinct des autorités est de rassurer rapidement.
Mais dans une époque marquée par la complexité des menaces hybrides, cette logique atteint ses limites. Car la confiance n’est plus un réflexe naturel. Elle doit être méritée. Elle doit s’appuyer sur des faits établis, non sur des affirmations de principe.
Écarter d’emblée l’hypothèse d’une cyberattaque sans disposer d’éléments irréfutables revient à risquer un retour de flamme médiatique et politique. Et ce risque, désormais, est immédiat. Dans l’univers hyperconnecté où l’opinion publique évolue, tout flou, toute approximation, toute certitude prématurée finit par se retourner contre ceux qui l’ont brandie.
Nommer les menaces sans trembler
Que s’est-il réellement passé en Espagne et au Portugal ? L’état des investigations ne permet pas encore de le dire avec précision. Mais une chose est certaine : l’incapacité à regarder lucidement les risques affaiblit la résilience collective.
Parler de sabotage, évoquer la possibilité d’une action pilotée par un service de renseignement étranger, comme le GRU russe, n’est pas céder à la panique. C’est, au contraire, affronter la réalité telle qu’elle pourrait être, sans fard et sans faux-semblants.
Savoir nommer la menace, c’est commencer à s’en protéger.
Dans ce monde instable où les lignes entre paix et conflit sont devenues floues, il n’y a plus de place pour les assurances hâtives. Plus de place pour les certitudes confortables. Seule une vigilance lucide permettra d’éviter de nouveaux effondrements silencieux.
La panne d’hier n’est peut-être qu’un avertissement. Encore faudrait-il savoir l’entendre.