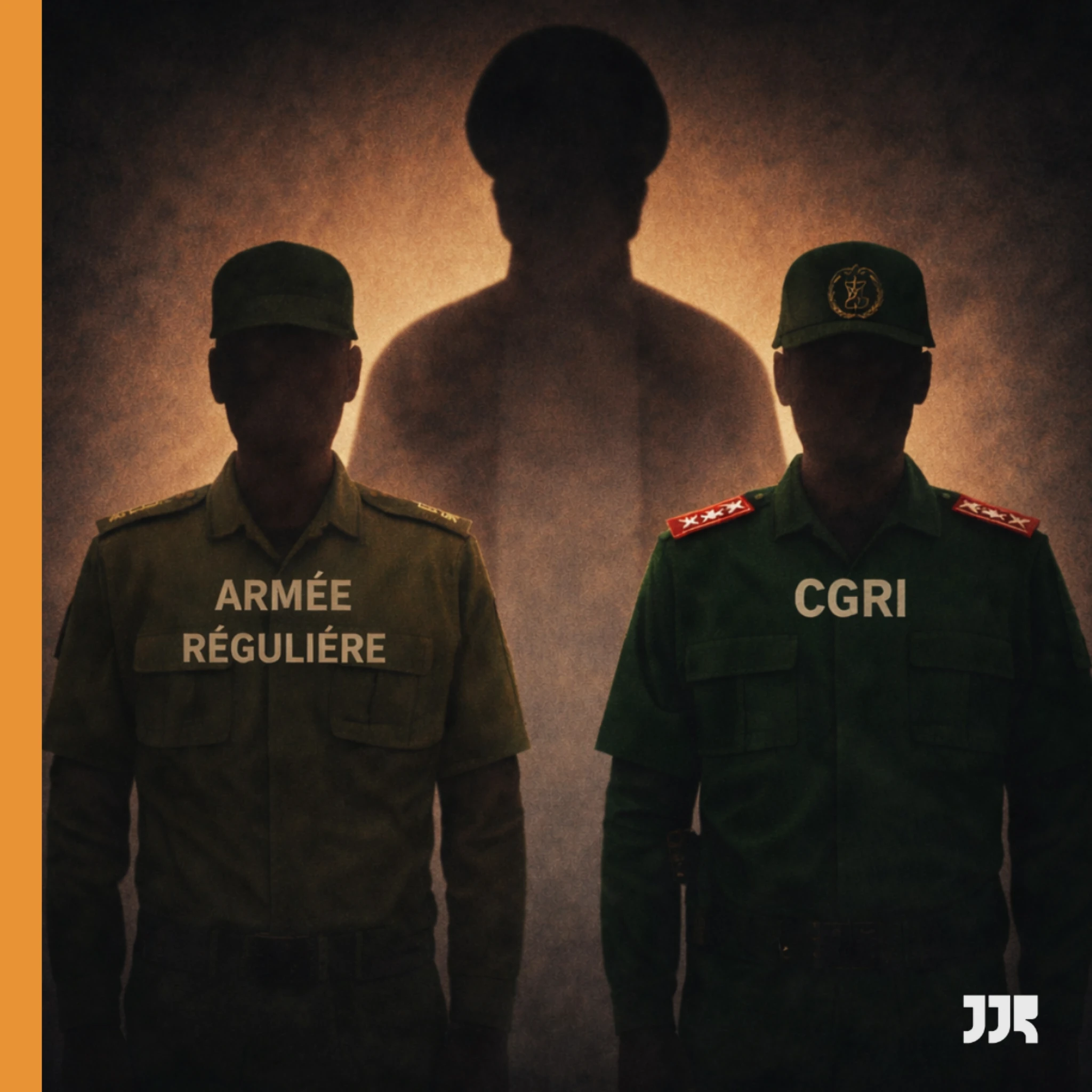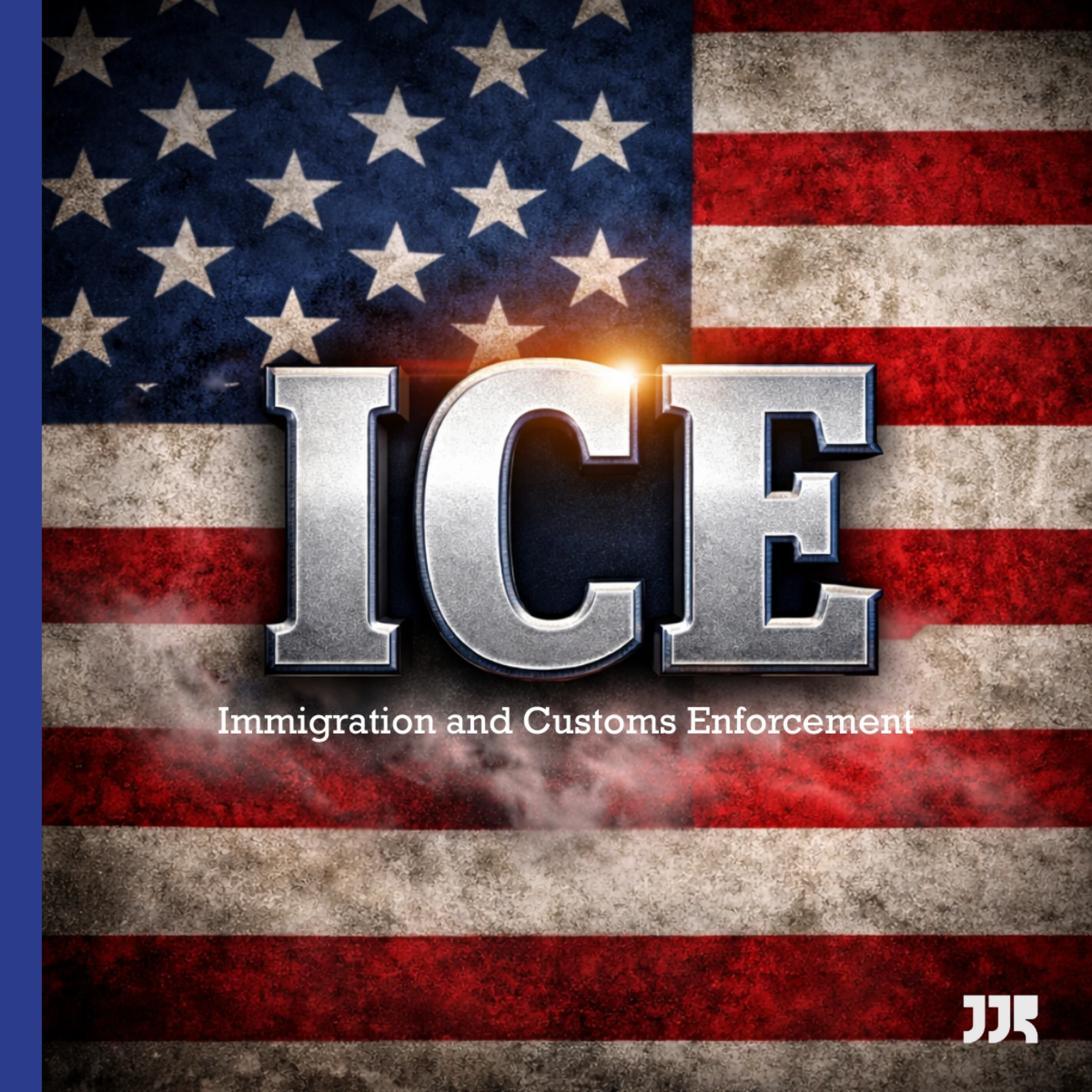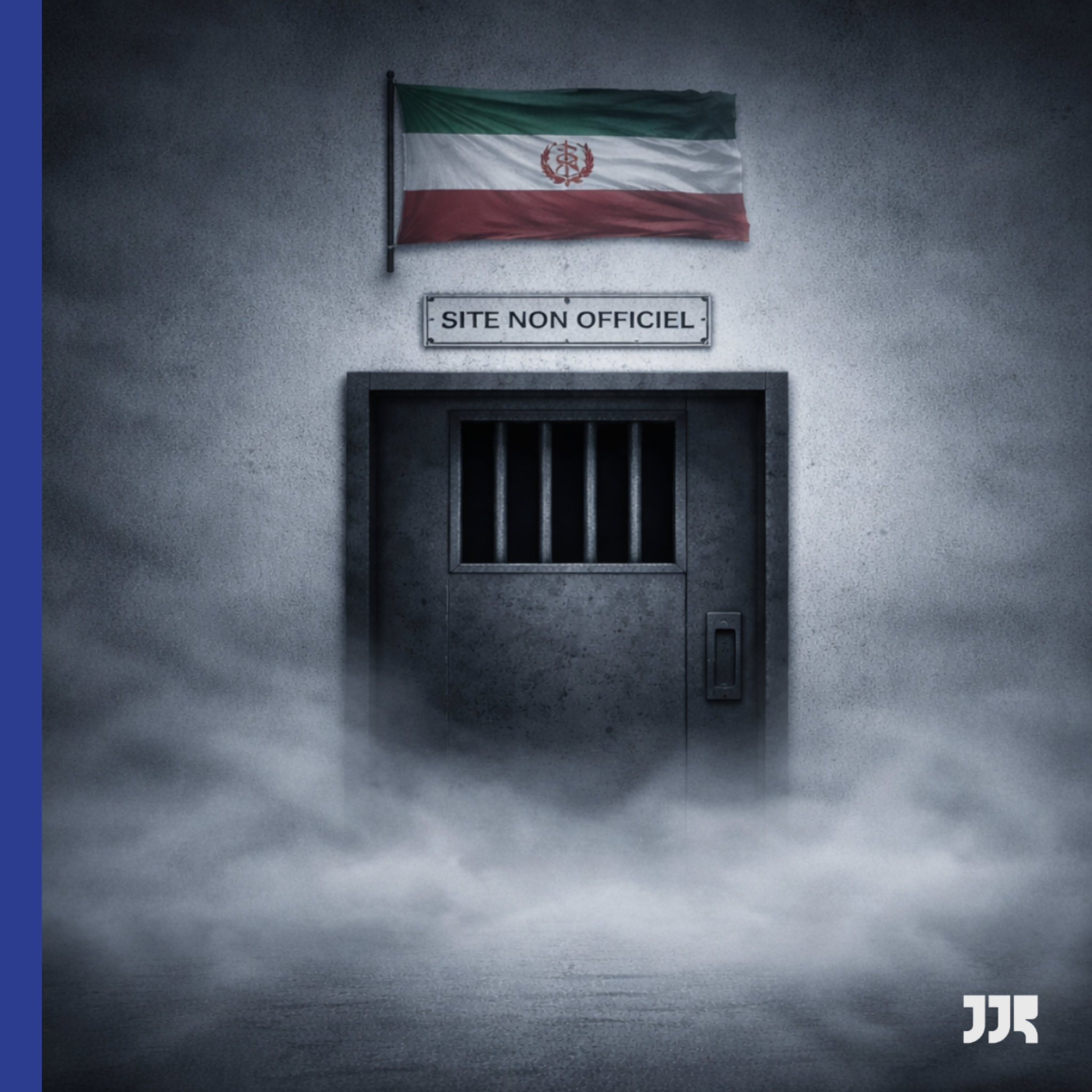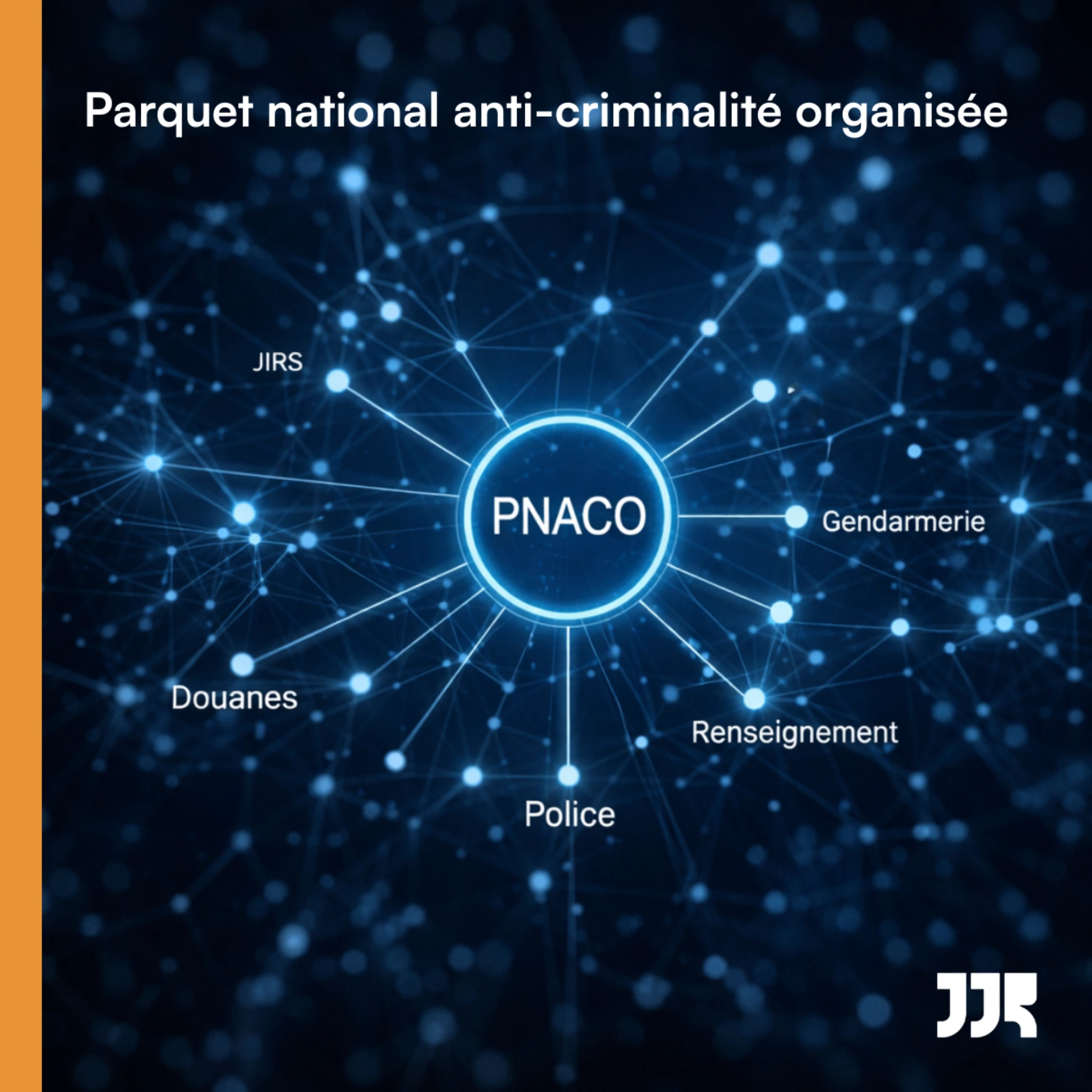À chaque flambée de violences liées aux trafics, la même idée revient : légaliser le cannabis pour assécher le marché noir. L’argument paraît séduisant, mais la réalité est bien plus complexe. Économie, santé publique, sécurité : rien n’indique que la légalisation réglerait le problème une bonne fois pour toutes.
Un mirage économique
Le cannabis représente en France un marché estimé entre 3,5 et 6 milliards d’euros par an, selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT). Croire que l’État pourrait absorber du jour au lendemain un tel flux financier relève de l’illusion.
Pourquoi ? Parce qu’un produit légal, encadré et taxé, restera toujours plus cher que la « beuh » vendue dans les cités, mais également parce que les « narcos » sauront s’adapter : ils miseront sur une « qualité » boostée, avec des taux de THC (tétrahydrocannabinol) qui exploseront. C’est le taux de THC qui est responsable de l’effet « défonce » qui attire les consommateurs. Bref, la partie est perdue d’avance.
De plus, les expériences internationales parlent d’elles-mêmes. Au Canada comme en Californie, la légalisation n’a pas éradiqué le trafic. Elle l’a même dopé. Résultat des courses : deux circuits coexistent, l’un officiel, réglementé, l’autre illégal, plus flexible et plus violent. Les trafiquants déplacent leurs marges, mais la violence demeure.
Un enjeu de santé publique
On compare souvent cannabis et alcool et c’est une grossière erreur. Oui, l’alcool tue près de 50 000 personnes chaque année en France (Santé publique France). Oui, l’obésité provoque encore plus de décès — plus de 68 000 selon l’Inserm, mais le cannabis a ses propres effets délétères.
Pas de surdose mortelle, certes, mais une altération de la mémoire, une perte de motivation et autres troubles anxieux. Chez les plus jeunes, l’impact est encore plus marqué, car toutes les grandes études, qu’elles viennent de l’Inserm ou de l’OMS, convergent : un usage régulier abîme les capacités cognitives et entraîne les décrochages scolaires. Et à forte dose, ce sont alors des risques d’hallucinations, de crises d’angoisse ou de bouffées psychotiques. L’image de « drogue douce » ne résiste pas à la réalité.
La sécurité, véritable nœud du problème
Le vrai sujet n’est pas la légalisation, mais bel et bien la capacité de l’État à reprendre durablement les territoires où prospèrent les trafics. Cela suppose plus de moyens policiers, une présence continue dans les quartiers sensibles et une reconnaissance pleine du rôle des polices municipales qui ne sont pas des « sous-polices ».
La justice face au dilemme
La réponse judiciaire, elle, ne peut plus se limiter à des sanctions symboliques. Les trafiquants doivent être condamnés fermement. Les consommateurs sanctionnés aussi : amendes, obligations de soins, suivi strict.
Rien qu’en France, plus d’un million de personnes consomment de la cocaïne. Faudrait-il, dans la même logique, légaliser aussi la coke, puis l’héro ou pourquoi pas le fentanyl ?
Une question de volonté politique
En aucun cas, la légalisation ne supprimera les trafics, mais elle ne fera qu’ajouter une couche de complexité à une situation déjà explosive. La vraie question est ailleurs : avons-nous la volonté de mobiliser des moyens hors normes pour une guerre longue, coûteuse, et sans doute impopulaire ?