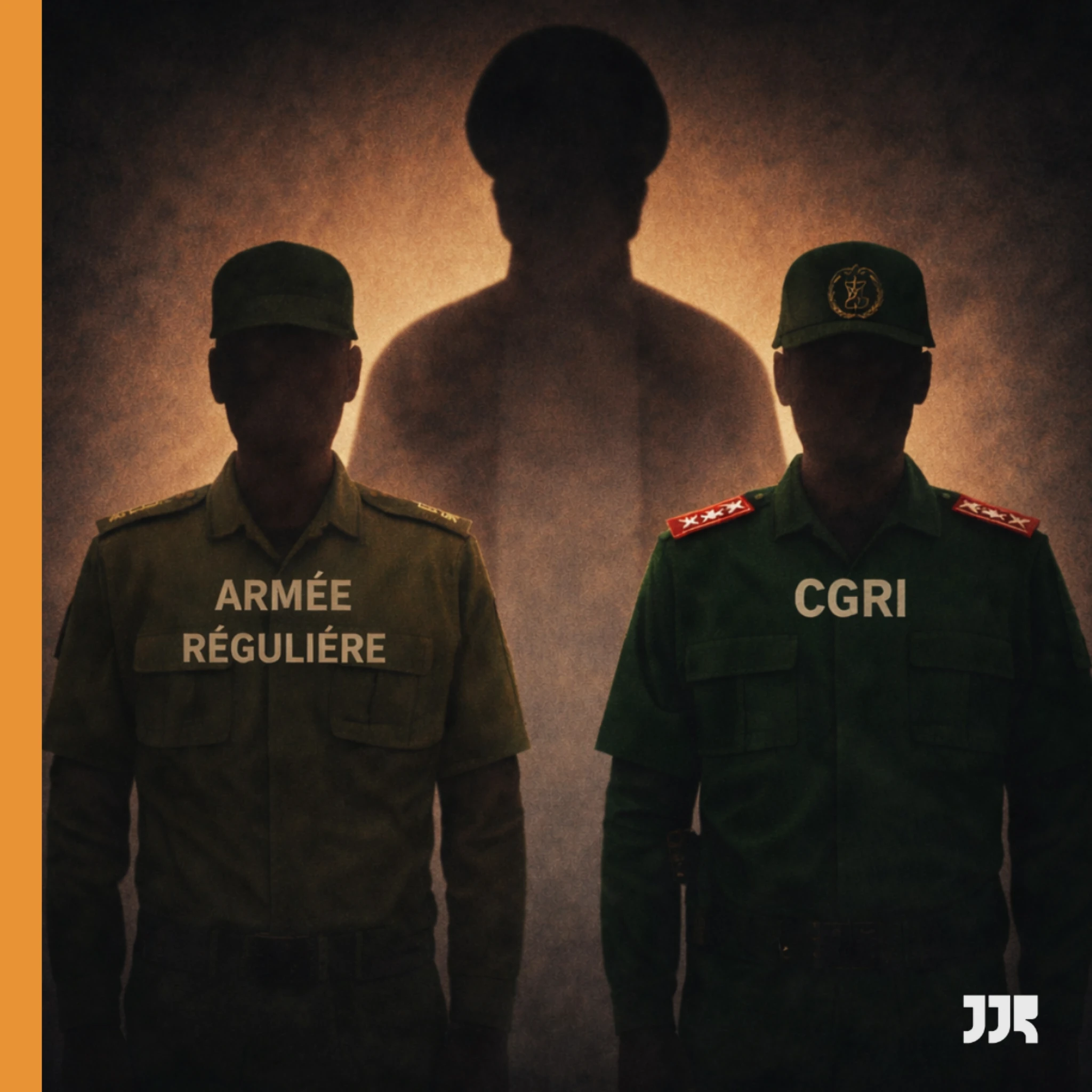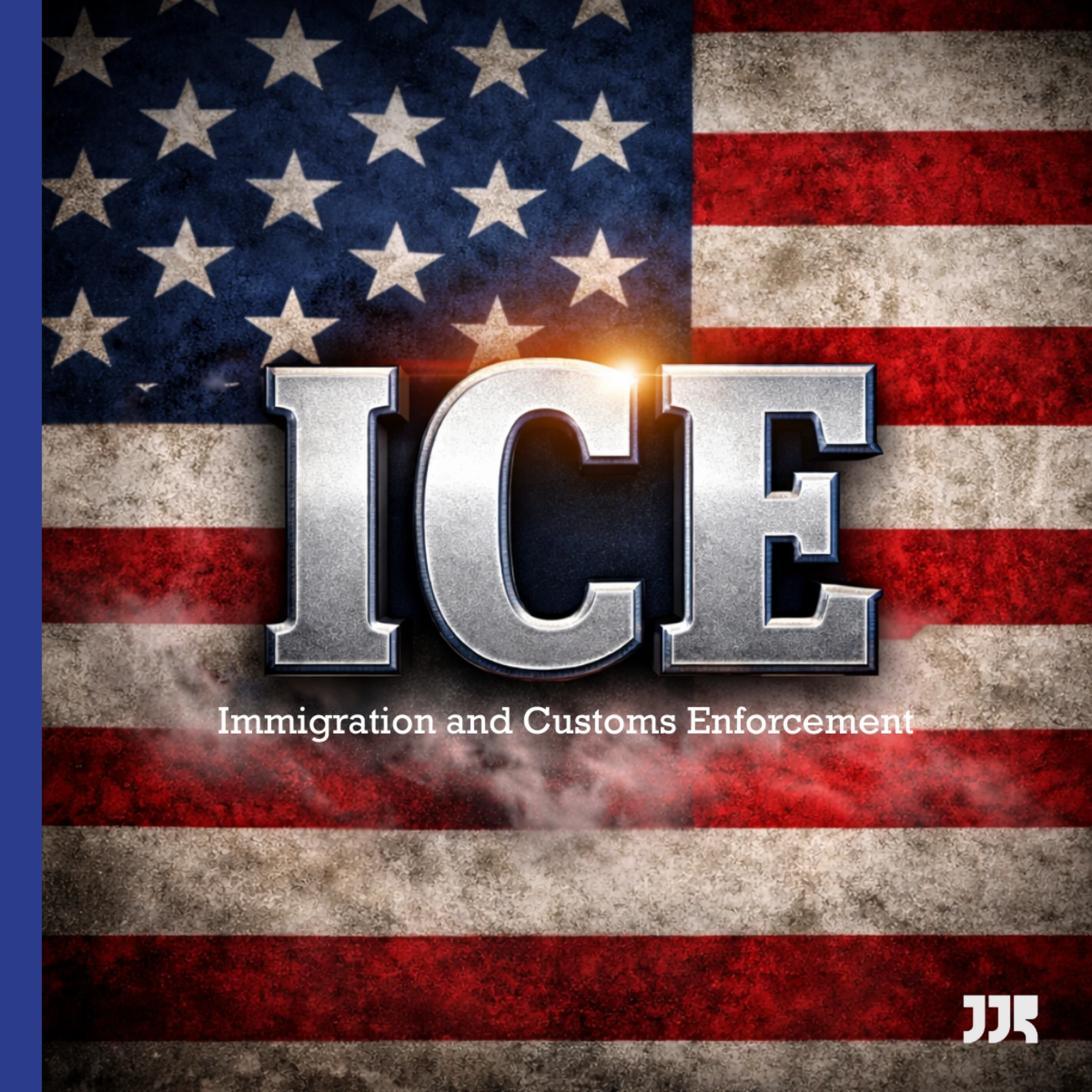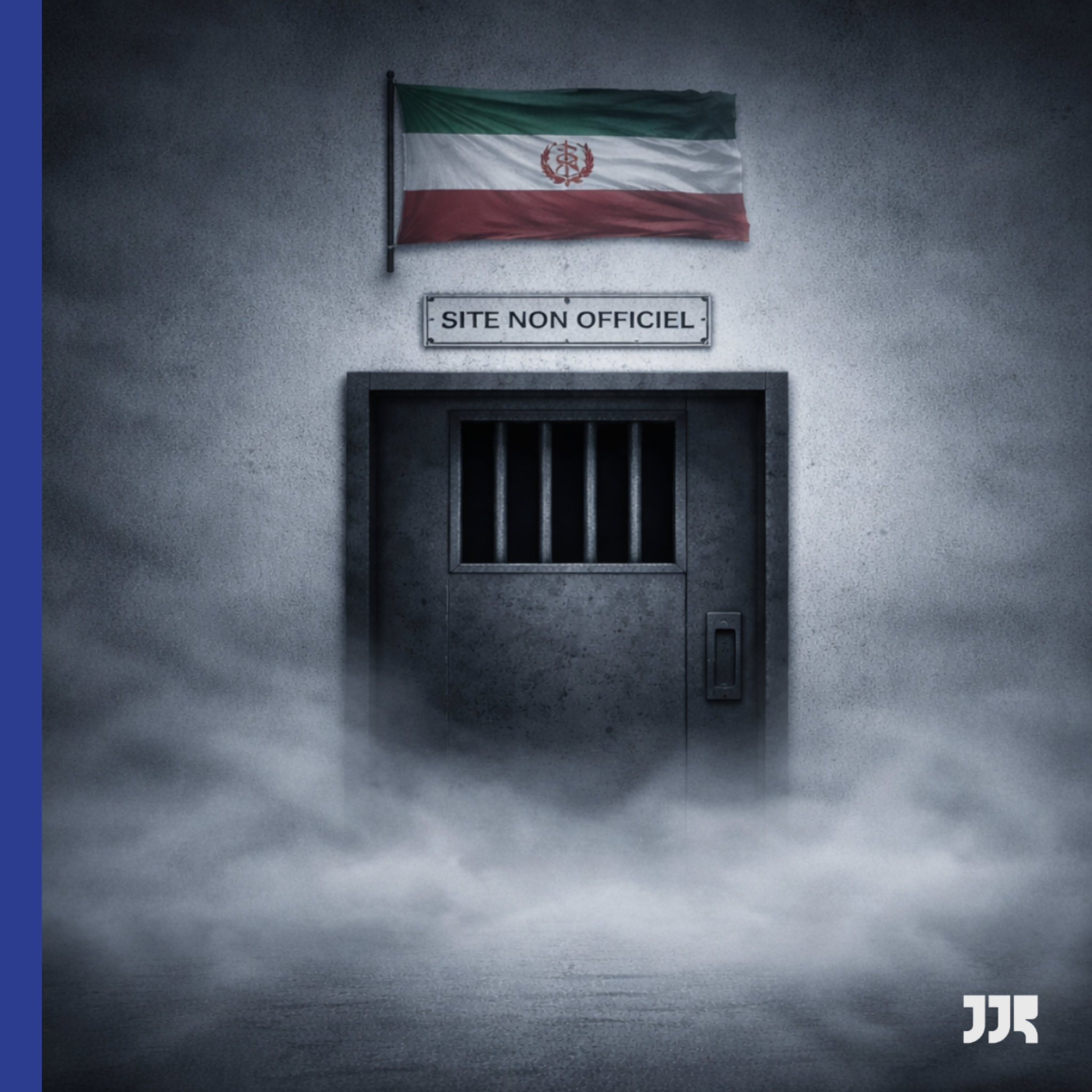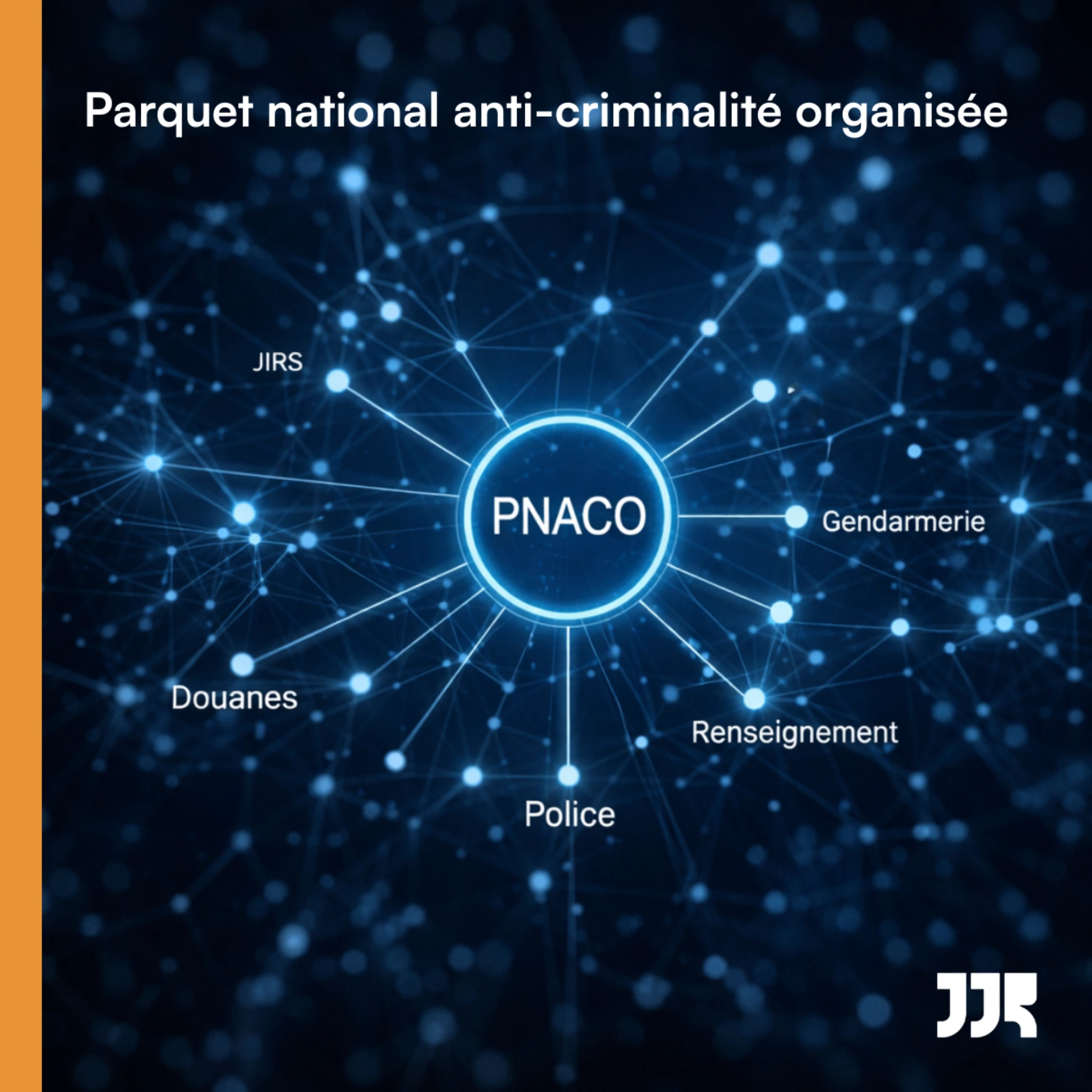Lorsque l’on aborde la question des risques, il est fondamental de comprendre que l’on s’adresse toujours à trois catégories de population distinctes. Cette réalité, souvent négligée, conditionne pourtant l’efficacité de toute stratégie de prévention ou de gestion des risques.
Trois regards face au risque
La première catégorie regroupe ceux qui n’en ont « rien à faire ». Ils traversent la vie en survolant les dangers, persuadés que rien ne pourra les atteindre. L’expérience leur a, jusqu’ici, donné raison. Mais, tôt ou tard, la réalité leur rappelle brutalement que le risque ne prévient pas.
La seconde catégorie comprend ceux qui reconnaissent l’existence du risque. Cette population, lucide, adapte ses comportements, anticipe les conséquences et met en œuvre des mesures de mitigation. Ces individus sont les véritables acteurs de la prévention.
Enfin, subsiste une troisième catégorie, celle des sceptiques. Pour eux, le risque appartient au registre du fantasme. Certes, dans bien des cas, ils auront raison : la majorité des risques identifiés ne se concrétisent jamais. Mais lorsque l’alerte se matérialise, les dégâts peuvent être irréversibles.
L’art difficile de la gestion des risques
Gérer un risque, ce n’est pas asséner une vérité face à une autre. C’est comprendre que la réalité est mouvante. En matière de gestion, une certitude prévaut : l’une des deux perceptions finira toujours par être validée par les faits.
La clé repose sur l’évaluation de la criticité du risque, croisement de deux facteurs essentiels : la probabilité d’occurrence et la gravité des conséquences. C’est ce niveau de criticité qui permet de distinguer un risque supportable d’un risque insupportable.
Encore faut-il s’entendre sur ce que signifient ces termes. Pour une multinationale, une perte de 10 millions d’euros pourrait être absorbée. Pour une PME, elle signerait probablement l’arrêt de mort de l’entreprise. Au-delà des pertes immédiates, les impacts indirects – image dégradée, perte de confiance, contentieux – sont souvent bien plus destructeurs que les conséquences directes.
Être réaliste, pas alarmiste
« Un pessimiste est un optimiste bien informé », écrivait Mark Twain. Cette citation illustre parfaitement l’état d’esprit nécessaire à toute approche sérieuse des risques. Il ne s’agit pas de céder au catastrophisme, ni de verser dans un optimisme béat, mais d’analyser froidement les réalités.
La communication constitue ici un levier fondamental. Il faut convaincre sans dramatiser, alerter sans désespérer, vulgariser sans édulcorer. C’est seulement ainsi que l’on parvient à entraîner toutes les parties prenantes, y compris les plus réfractaires, dans une dynamique de gestion préventive des risques.
Car en définitive, anticiper les risques n’est ni une posture de peur, ni une posture de foi. C’est une exigence de lucidité.