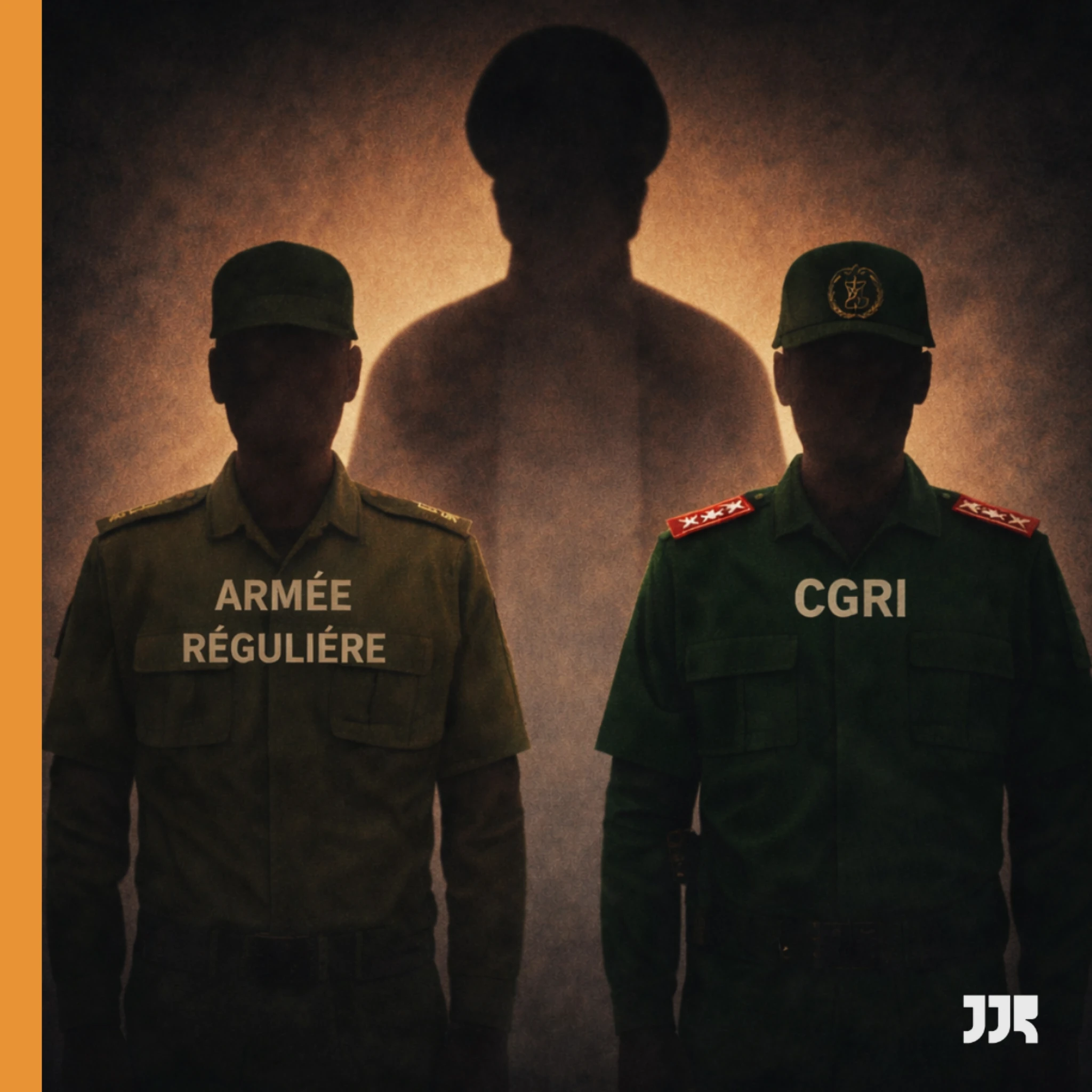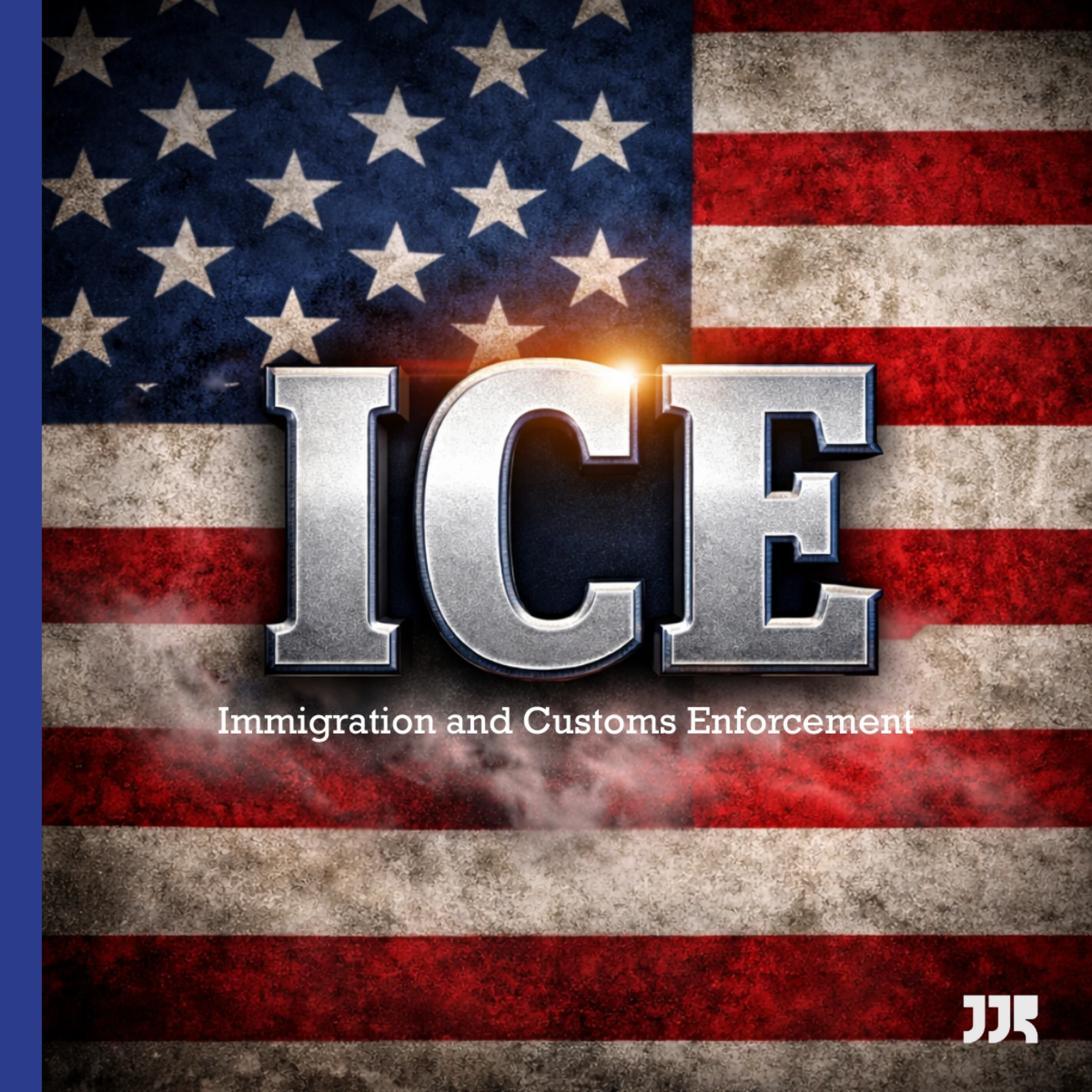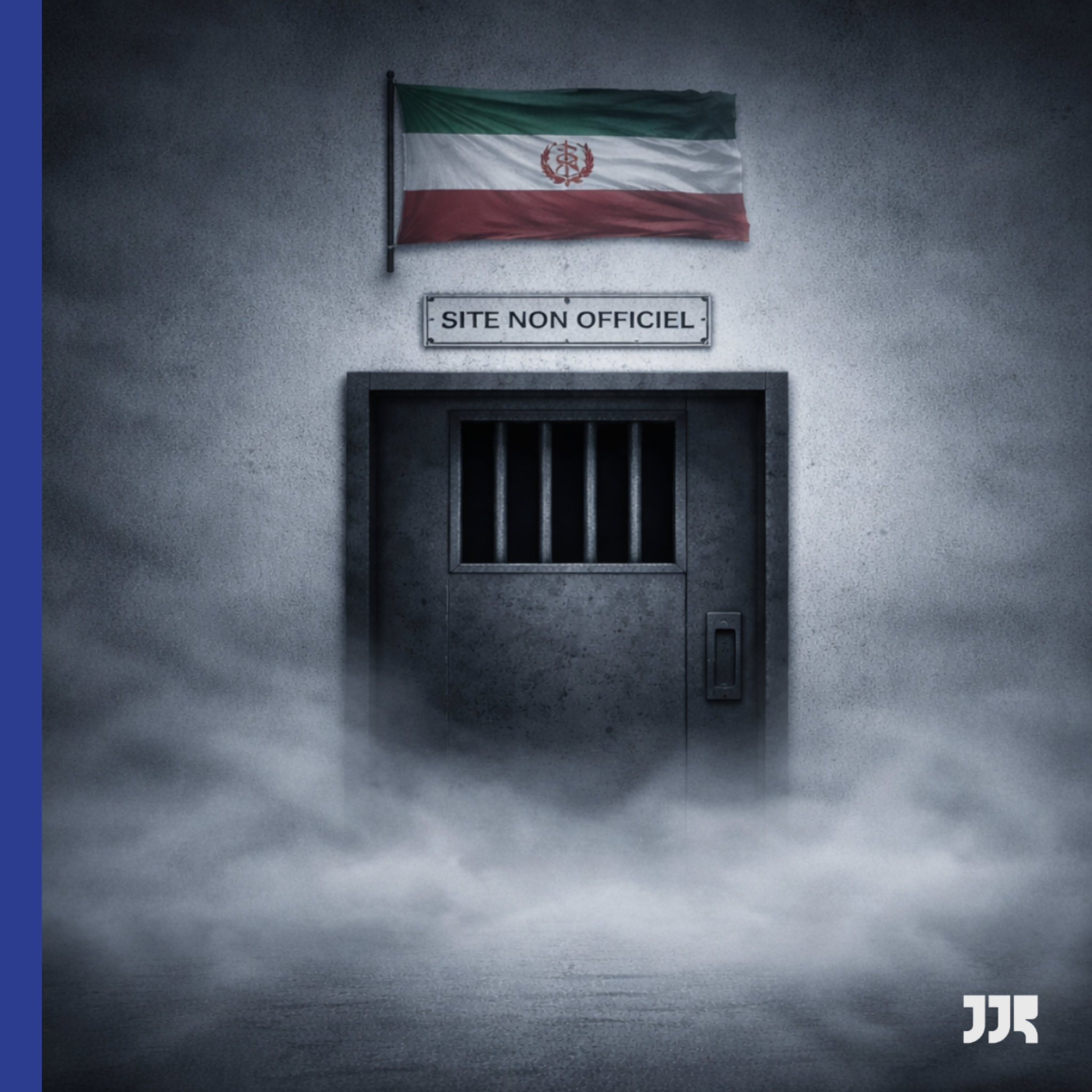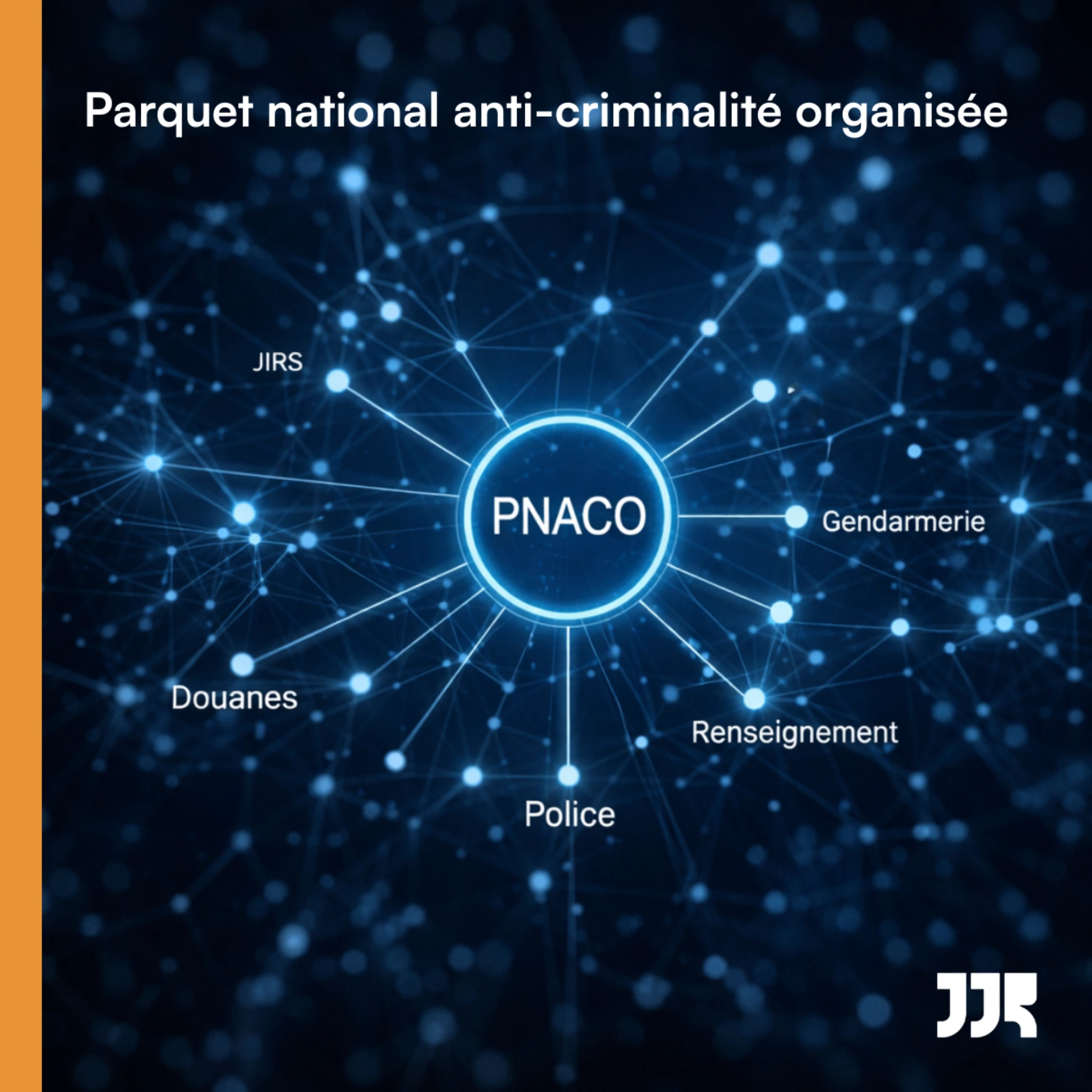Ils sont là quand plus personne ne veut l’être. Dans la rue, la nuit, et dans des lieux qui sont au bord de l’explosion. On leur demande de tenir. De garder le calme quand tout s’effondre. Et souvent, certains les critiquent, sans même les regarder. Pourtant, ce qu’ils endurent mérite qu’on s’arrête. Juste un instant.
Tenir la ligne, quoi qu’il en coûte
Ils sont les premiers à arriver, et parfois, les seuls à affronter des situations où tous les repères s’effacent. La peur, ils la connaissent, et ont appris à vivre avec. Ils l’ont même intégrée à leur quotidien. En prenant leur service, nombreux sont ceux qui se demandent de quelle manière se déroulera leur journée et à quelle scène de chaos ils auront à faire face. Mais cela ne les empêche pas d’agir.
Porter un uniforme aujourd’hui, c’est accepter de devenir une cible, et non plus une figure d’autorité. C’est partir en patrouille ou en intervention sans certitude de revenir intact. C’est serrer les dents dans un commissariat délabré. C’est entendre les cris et devoir garder le calme. Ce n’est pas du cinéma. C’est leur quotidien.
Invisibles quand ils sauvent, conspués quand ils réagissent
Quand un policier sauve un enfant d’un immeuble en feu, rares sont les personnes qui relaient ce type d’information. Quand une gendarme convainc une femme battue de porter plainte, aucun micro n’est tendu. Mais s’il y a un tir, une bavure supposée, une intervention musclée… alors les caméras arrivent. L’opinion tranche, et souvent, elle tranche mal.
Ce déséquilibre médiatique est injuste. Bien pire, il est dangereux. Car à force d’exposer uniquement les écarts, on finit par effacer le courage. À force de ne voir que l’erreur, on oublie l’abnégation.
Un métier, pas une vocation sacrificielle
Oui, ils ont choisi ce métier. Mais pas celui d’être insultés pour rien. Pas celui d’être envoyés au contact sans renfort. Pas celui d’alterner nuits blanches et tâches administratives sans relâche. Pas celui de justifier chaque geste sous l’œil d’un téléphone et sous les invectives de délinquants.
Beaucoup craquent, démissionnent, ou pire encore. Certains tiennent par instinct, par loyauté, par conscience professionnelle. Parfois, simplement parce qu’ils ne veulent pas faire autre chose. Parce que malgré tout, ils croient encore en leur mission. Même si la société, elle, n’y croit plus vraiment.
L’autorité ne tient pas sans respect
La sécurité ne repose pas que sur des textes ou des procédures. Elle repose sur des hommes et des femmes qui sont gardiens de la paix, officiers, gradés. Si l’on cesse de les respecter, on sabote la base. Le respect ne veut pas dire l’aveuglement. Il veut dire reconnaître ce que ces femmes et ces hommes endurent pour que nous puissions, nous, vivre debout.
Ils ne demandent pas des médailles, mais juste qu’on les considère à la hauteur de leur engagement, et qu’on les écoute. Mais également qu’on arrête de faire comme s’ils étaient les seuls responsables des failles d’un système qu’ils subissent autant qu’ils le représentent.
Cet article est issu des réflexions développées dans mon livre Insécurité en France : On n’est pas sorti de l’auberge ! disponible en librairie et sur les plateformes en ligne. Un ouvrage pour comprendre en profondeur les racines, les mutations et les enjeux de l’insécurité aujourd’hui.