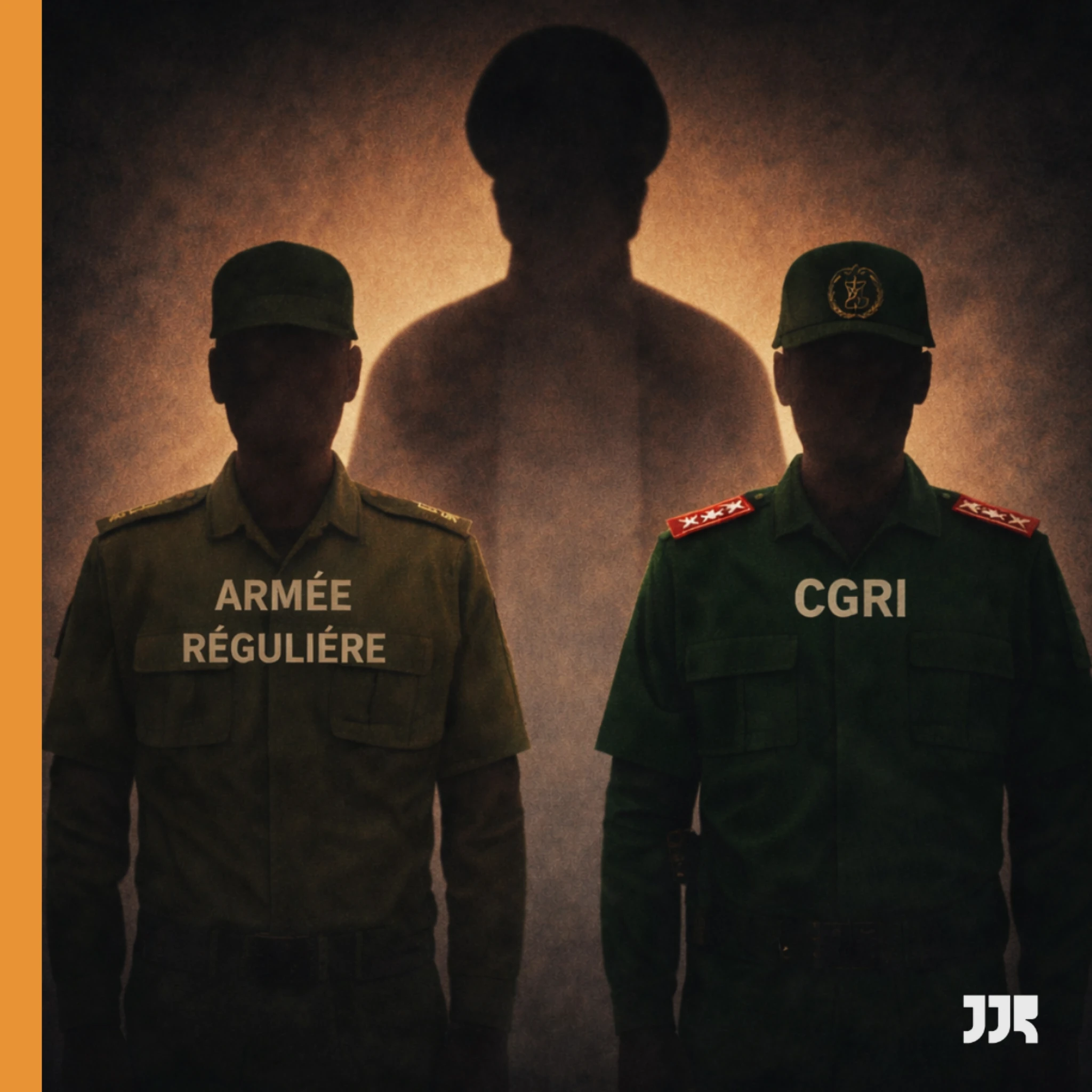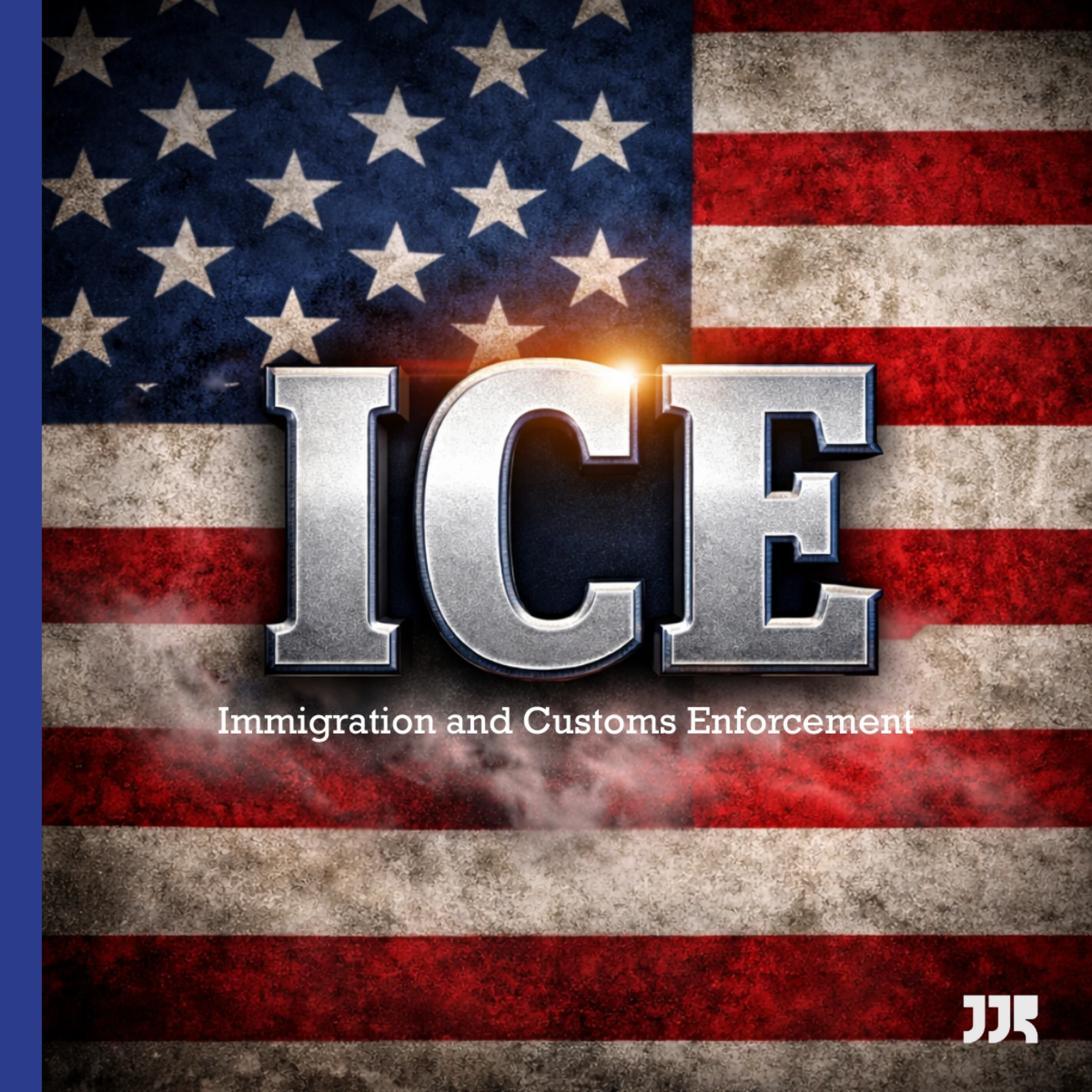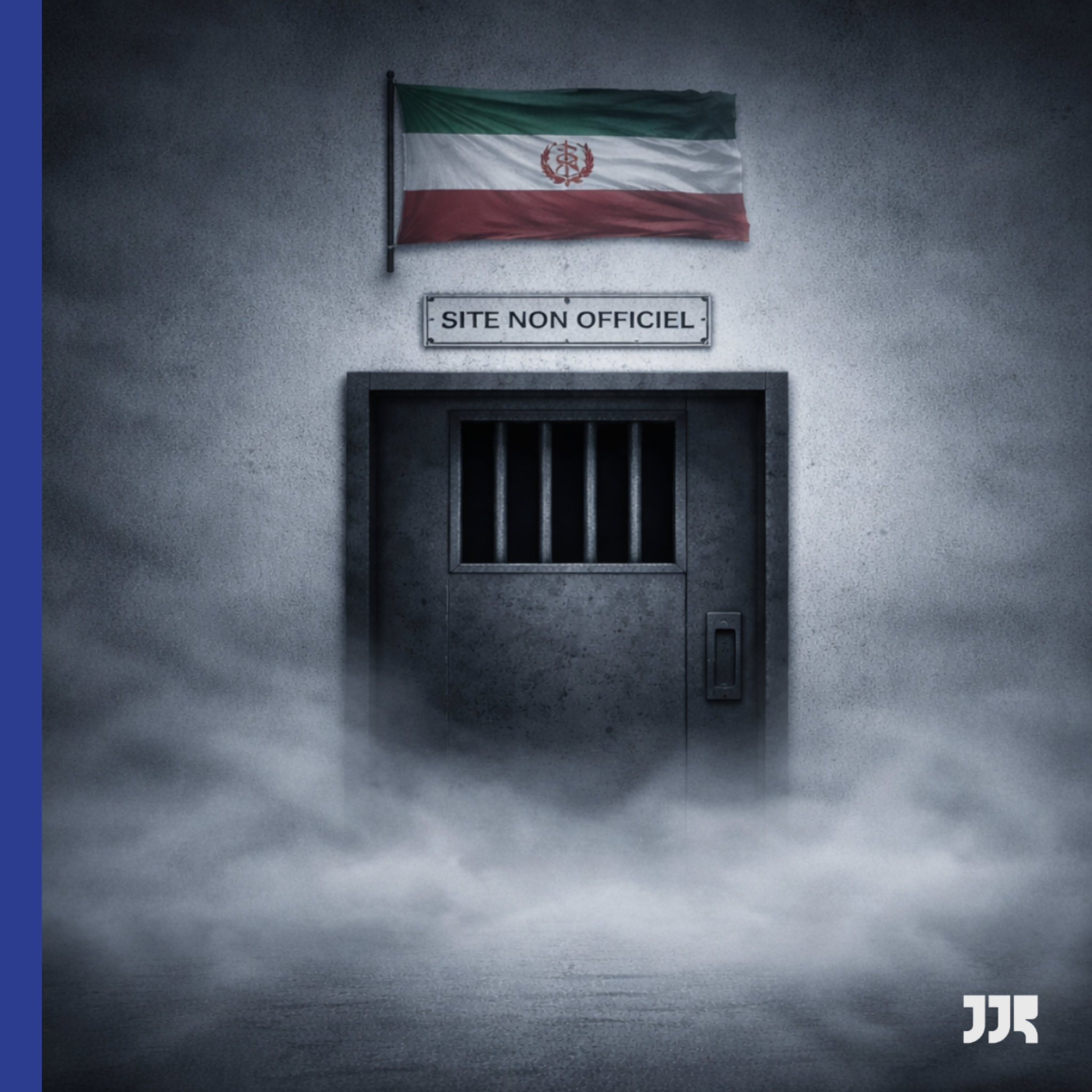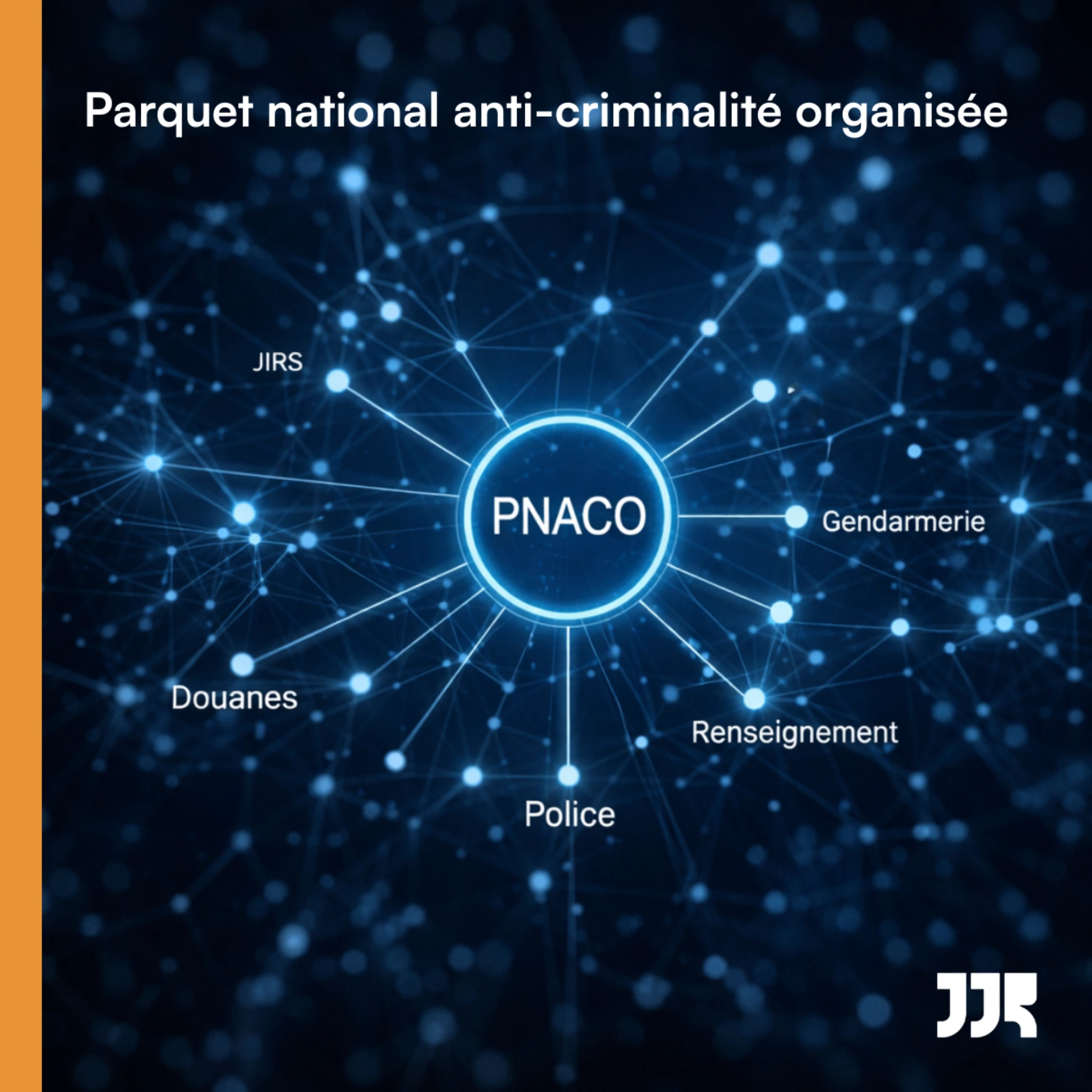Elle est rarement assumée et souvent disqualifiée. Pourtant, la peur est bien là, tapie dans chaque politique sécuritaire, chaque vote sur la justice, chaque débat sur l’ordre. Et si on cessait de la regarder comme une faiblesse ?
Une émotion discrète mais structurante
Dans les sociétés contemporaines, la peur n’a plus de place officielle. On lui préfère des termes « techniques » qui se nomment insécurité, menace, tension, ou bien encore sentiment d’abandon. Mais dans les faits, c’est bien elle qui sous-tend de nombreux choix collectifs. Peur de l’agression, peur du chaos, peur de ne plus reconnaître son propre territoire et parfois peur d’une violence extrême.
Cette peur n’est pas toujours irrationnelle et n’est pas toujours instrumentalisée. Elle naît de l’expérience vécue et d’un quotidien qui parfois est très violent physiquement ou psychologiquement. Elle s’ancre dans les regards baissés, les bus évités et autres silences gênés. Elle traverse les villes, les campagnes et perfore les esprits.
Gouverner, c’est gérer des peurs
La sécurité publique n’est pas seulement une affaire de moyens. Elle est aussi une affaire de perception et cette perception, même subjective, influence profondément les rapports sociaux. La peur n’est pas une simple lubie pour des millions de personnes. Elle est une donnée factuelle qui dépasse de très loin toutes les statistiques. Elle est une sorte de baromètre silencieux du lien entre l’État et les citoyens.
Ne pas la prendre au sérieux, c’est abandonner le terrain à ceux qui la manipulent. L’exploiter sans mesure, c’est alors la transformer en arme politique de division. Au contraire, il faut savoir l’écouter sans jamais la flatter avec pour seul objectif de la comprendre.
Une société qui a cessé d’avoir peur, ou qui la dissimule ?
Tout le paradoxe est là. Nous vivons dans des sociétés où la sécurité n’a jamais mobilisé autant de ressources, de technologies et de personnels. Et pourtant, le sentiment d’insécurité ne décroît pas, bien au contraire. Il se déplace, se transforme en méfiance et en repli sur soi.
La peur devient alors une fatigue permanente qui use les esprits. Et c’est à ce moment précis que le véritable danger s’installe, car une société fatiguée finit par ne plus réagir et par tout accepter.
Retrouver une maîtrise lucide
Reconnaître la peur, c’est ne plus la subir. C’est la transformer en levier de réflexion, non en mécanisme de panique. C’est interroger les causes et pas uniquement renforcer les verrous. C’est se donner les moyens d’y répondre, sans céder à l’obsession sécuritaire.
Cela suppose de penser autrement et de regarder la réalité droit dans les yeux. Il s’agit également de rompre avec les promesses de toutes sortes et les discours binaires. De revenir à une politique du réel, où la peur n’est ni niée, ni hystérisée simplement intégrée dans un paysage qui peut parfois être très sombre.