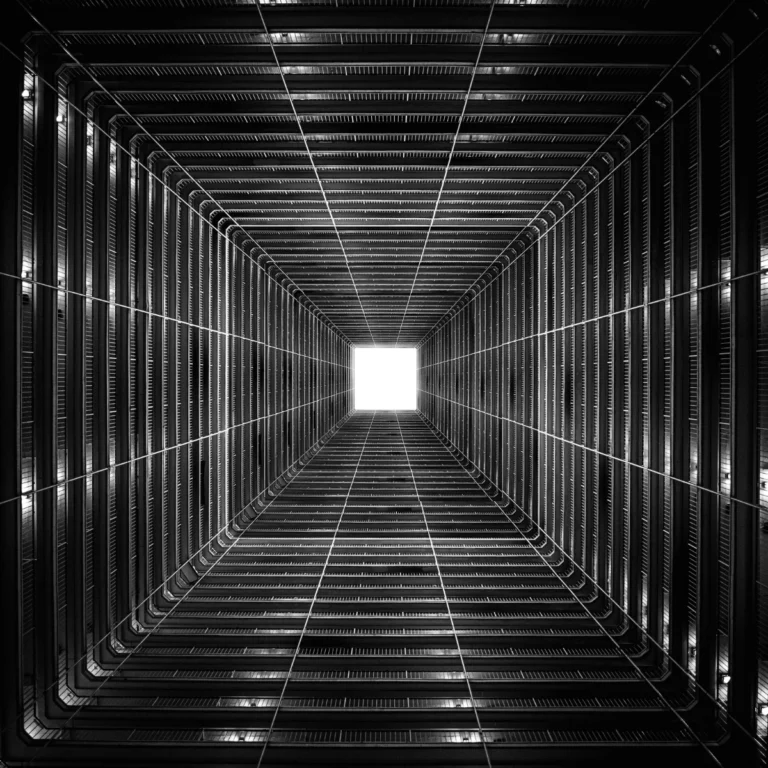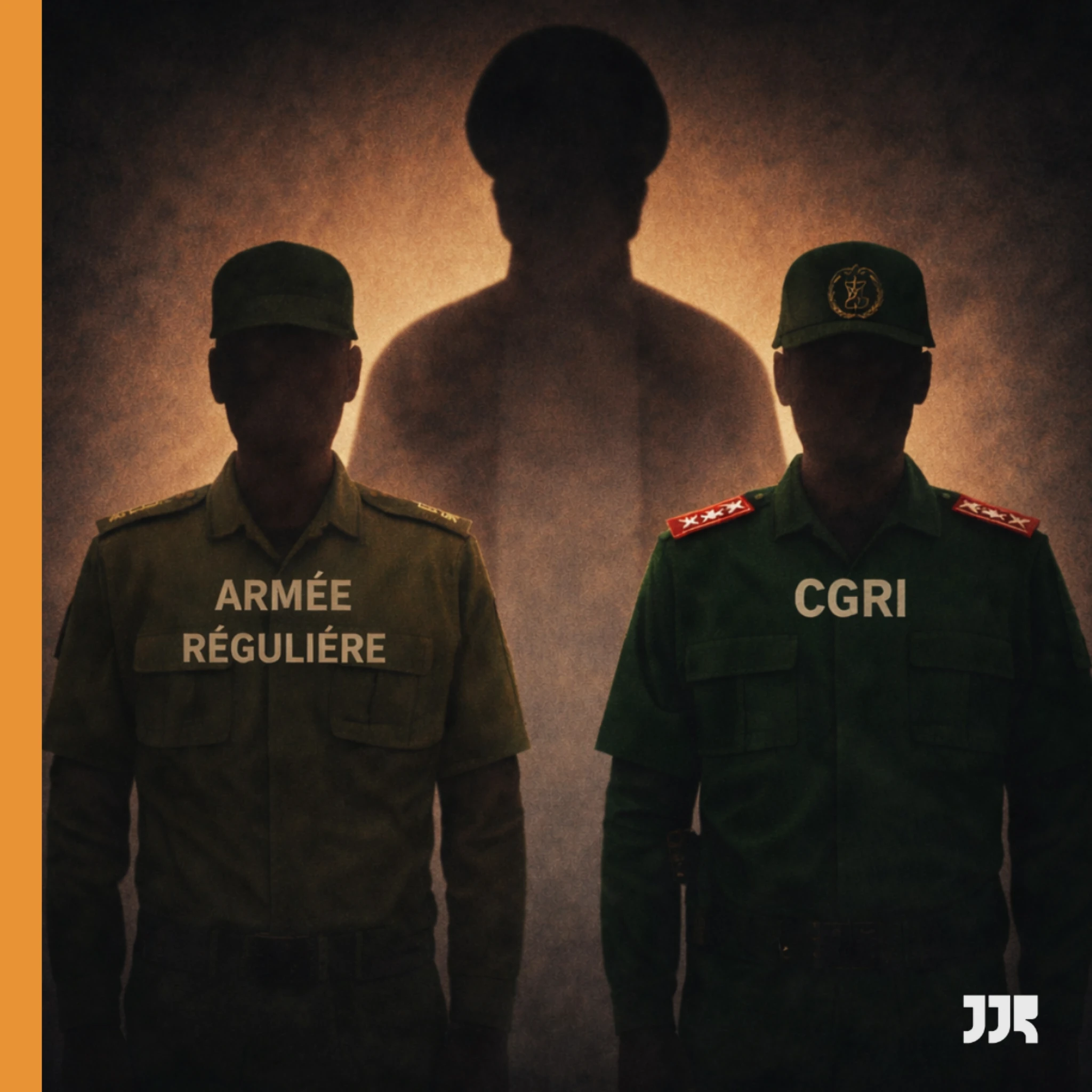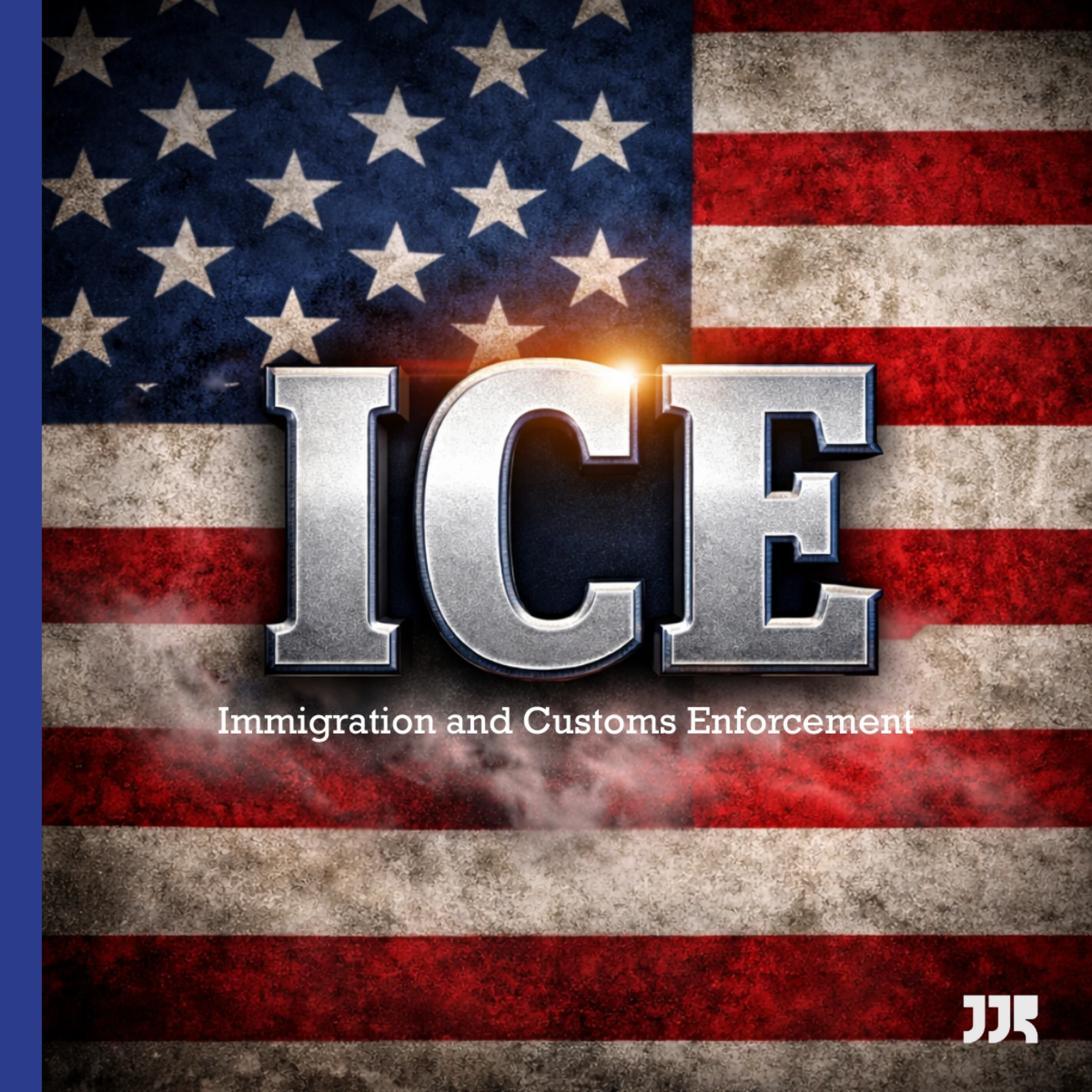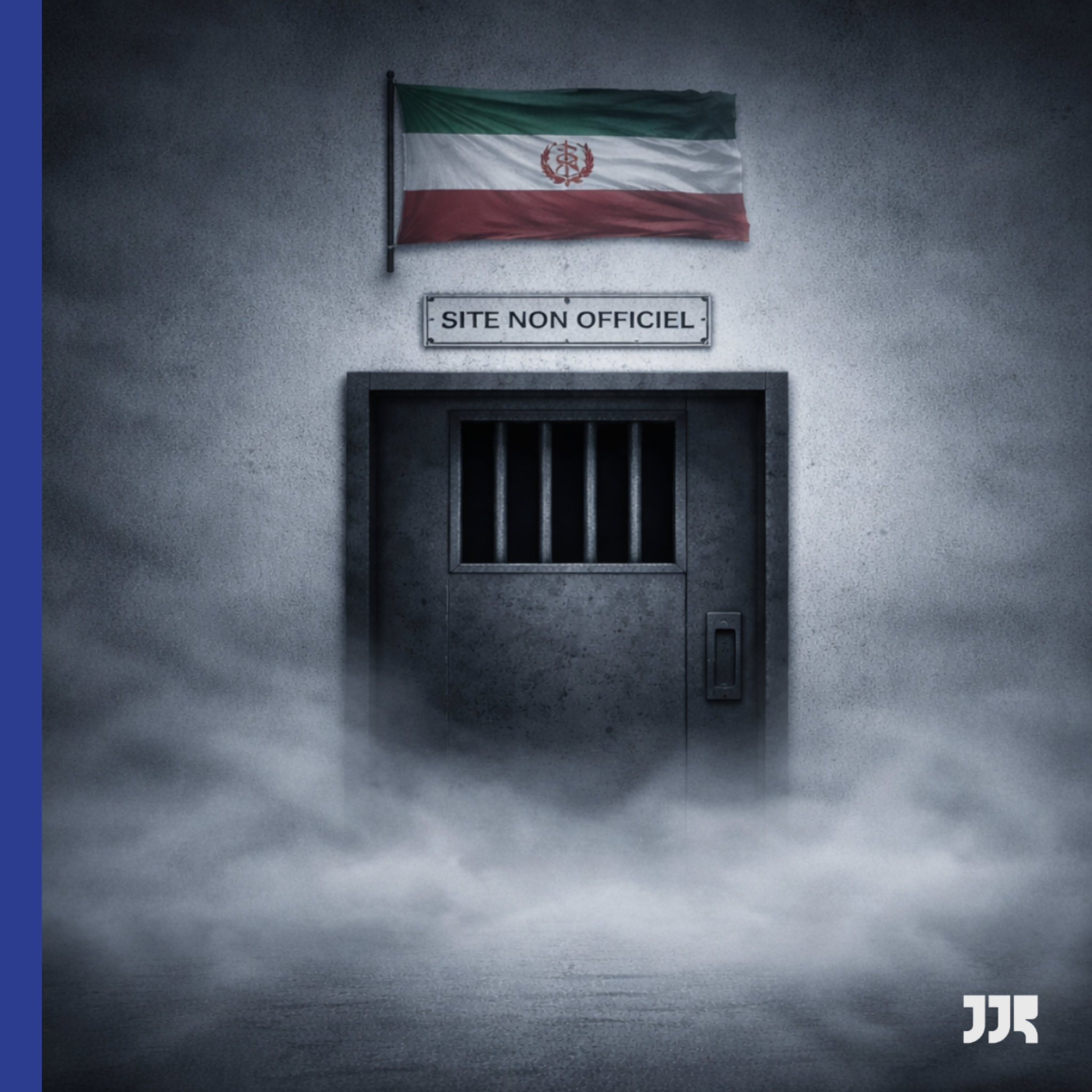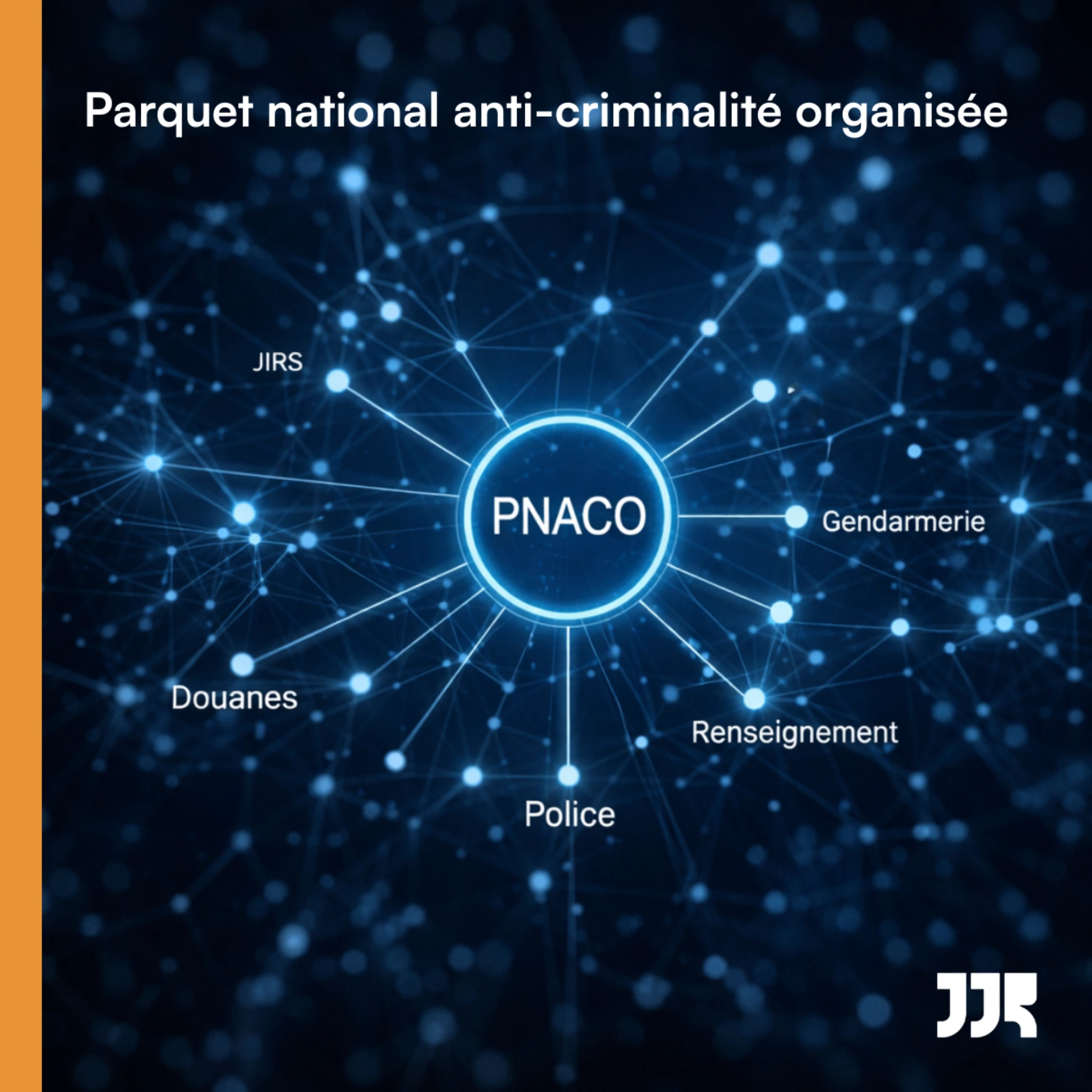À chaque tension géopolitique, les mêmes certitudes refont surface. Pourtant, dans le champ de la sécurité, l’excès de confiance est souvent le premier aveuglement.
Entre analyse et prédiction, la ligne est fine
Depuis l’annonce d’une possible riposte iranienne à une offensive américaine, les commentaires se multiplient. Représailles immédiates ? Attente calculée ? Frappe symbolique ? Chaque hypothèse trouve ses partisans. Le problème, c’est que ces projections, aussi rationnelles soient-elles, masquent une réalité plus inconfortable qui est que personne ne sait vraiment ce que fera Téhéran.
Les experts analysent, les journalistes relaient, les gouvernements spéculent. Mais tout cela repose, au fond, sur des suppositions. Des signaux faibles, des précédents historiques, des lectures culturelles… mais rarement sur des faits indiscutables. Or, en matière de conflit, l’irrationnel existe. Le paradoxe aussi.
Voir avec nos lunettes, mais pas les leurs
Le prisme occidental biaise notre lecture. Nous jugeons les choix iraniens selon notre logique politique, nos priorités économiques, notre conception de la rationalité stratégique. Ce filtre culturel souvent inconscient empêche de penser comme l’autre. Et penser à la place de l’autre, c’est déjà prendre le risque de mal anticiper.
Prenons l’exemple du détroit d’Ormuz. Un blocage total de cette voie maritime serait, pour beaucoup, un suicide économique pour l’Iran. Peut-être. Mais cela suppose que la logique économique prime sur toutes les autres. Or, dans certains contextes, la posture idéologique ou la survie du régime pèse davantage que les équilibres marchands.
Les angles morts du réel
L’histoire récente regorge de surprises stratégiques. Le 11 septembre, les attentats de janvier et novembre 2015, le 7 octobre 2023… Autant de drames que les meilleurs services de renseignement n’avaient pas su anticiper à leur juste ampleur. Non pas par incompétence, mais parce que l’événement, dans sa forme et dans son moment, échappait au cadre d’analyse dominant.
Ce n’est pas faute d’indices. C’est la confiance excessive dans les scénarios dits « plausibles » qui aveugle. L’inimaginable ne l’est qu’après coup et très généralement une fois le choc passé.
L’humilité stratégique comme posture vitale
Dans les domaines de la sécurité et de la défense, la plus grande erreur consiste à croire que l’on sait. Le danger ne vient pas forcément de ce que l’on ignore, mais de ce que l’on croit acquis. L’anticipation est nécessaire, bien sûr. Mais elle doit toujours s’accompagner d’un doute actif et du fameux « et, si ».
Accepter de ne pas savoir, c’est se donner une chance de mieux voir. Ne pas chercher à tout prévoir, mais se préparer à l’inattendu. L’analyse est précieuse, mais elle ne dispense jamais de l’humilité. Et dans un monde où l’incertain est devenu la norme, cette humilité-là est une forme de lucidité.