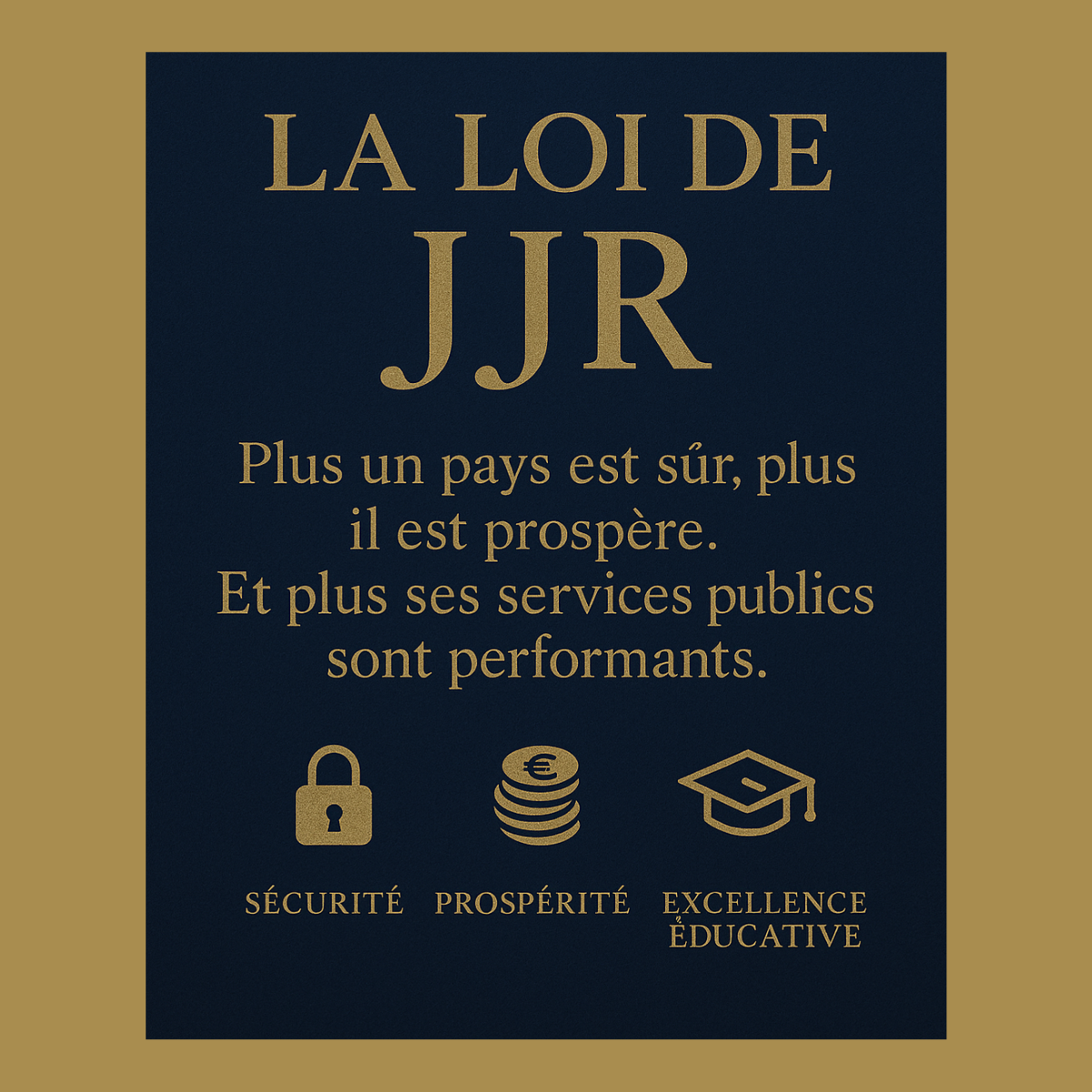Peut-on encore parler de « guerre contre les narcotrafics » en étant réaliste ? La formule rassure, donne le sentiment d’un affrontement clair entre l’État et les trafiquants. Mais la réponse honnête, froide, factuelle et lucide est non, cette guerre ne sera pas gagnée.
Ce « non » ne signifie pas que tout est joué ni que les actions publiques sont vaines. Il signifie que nous ne gagnerons jamais une guerre d’éradication. Le marché de la drogue existe avec ses producteurs et consommateurs et il ne s’éteindra pas faute de clients ou sous les coups de la puissance publique. Au mieux, nous apprendrons à gérer ce phénomène, à limiter les dégâts, à reprendre des morceaux de territoire là où ils ont déjà glissé entre les mains des trafiquants.
Un marché planétaire hors de contrôle
Pour comprendre ce marché planétaire, il est important d’avoir à l’esprit des chiffres qui donnent le vertige. Selon le Rapport mondial sur les drogues 2025 de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), la production illicite de cocaïne a atteint plus de 3 708 tonnes en 2023, soit environ 34 % de plus qu’en 2022. Dans le même temps, le nombre d’usagers de cocaïne est passé d’environ 17 millions en 2013 à 25 millions en 2023, soit une augmentation de 47 %.
Les États parlent de « guerre », alors que le marché continue de croître comme si de rien n’était. Pour arriver à ses fins, cela fait désormais bien longtemps que ce marché s’est véritablement professionnalisé, et ce, aussi bien dans ses méthodes d’acheminement, que de corruption ou de violence, sans aucune limite.
Désormais, les cartels ont des ancrages solides dans les ports, les routes maritimes, les réseaux logistiques, mais également dans des entreprises ayant pignon sur rue, et notamment dans les secteurs du BTP, de l’immobilier ou bien encore de la finance.
La France submergée : du Havre aux quartiers populaires
Une France, qui serait submergée par les trafics de drogue, n’est plus du tout une hypothèse, mais bel et bien une réalité. Le bilan consolidé des forces de l’ordre (police, gendarmerie, douanes, marine) pour l’année fait apparaître que 53,5 tonnes de cocaïne ont été saisies en 2024, soit une hausse de 130 % par rapport aux 23 tonnes, saisies en 2023.
Cette augmentation, bien plus que significative, démontre, si besoin en était, que, malgré les différentes déclarations de ces dernières années, nous ne sommes manifestement pas en train de gagner cette « guerre » contre la drogue. Bien, au contraire, cette augmentation démontre une explosion des flux de marchandises qui sont coordonnés par des réseaux de plus en plus structurés, qu’ils soient galiciens, albanophones, ou issus d’Amérique latine et des Balkans.
Les modes opératoires pour la partie transport sont très diversifiés avec l’utilisation de voiliers, de cargos au sein desquels il y a des caches sophistiquées, ou bien encore de mules. Il est très probable que, demain et à grande échelle, ces transports pourront être en partie automatisés avec l’utilisation de drones, qu’ils soient aériens, terrestres ou maritimes.
De plus, des contrôles renforcés sur les vols en provenance de Fort-de-France ont permis de mettre en exergue que 10 passagers sur 150 étaient des mules.
La situation est particulièrement préoccupante dans les territoires ultramarins et notamment en Martinique en matière de violence, puisque 16 homicides par arme à feu ont été recensés depuis le début de l’année 2025. Depuis plusieurs années l’île est devenue un lieu de transit majeur entre l’Amérique du Sud et l’Europe. Cette situation inquiète au plus haut point les élus de l’île qui parlent de risque majeur aussi bien en matière sanitaire qu’en matière de sécurité publique.
L’Europe, hub logistique et laboratoire du futur
Depuis maintenant plusieurs années, l’Union européenne est devenue l’un des principaux marchés mondiaux pour la cocaïne derrière l’Amérique du Nord, et de fait un hub logistique de premier rang.
Selon l’Agence européenne des drogues (EUDA) les États membres de l’Union européenne ont procédé à la saisie en 2023 de plus de 323 tonnes de cocaïne. Les principaux volumes sont concentrés en Belgique, en Espagne et aux Pays-Bas. Des ports comme ceux d’Anvers ou d’Amsterdam sont devenus malgré eux des plaques tournantes de ces trafics.
Dans ce contexte, les ports européens sont également devenus des lieux d’affrontement entre les organisations criminelles et les États. En effet, pour arriver à leurs fins, les organisations criminelles n’hésitent pas à corrompre des agents de l’État, à les intimider, à manipuler des systèmes d’information portuaires ou bien encore à infiltrer des chaînes logistiques.
Comme le souligne un rapport de l’Organisation mondiale des douanes, les trafiquants face aux mesures prises par les autorités ne cessent de s’adapter, et notamment en multipliant les chargements de plus petite taille, et ce, dans le but de diluer au maximum le risque.
Moins visibles, mais tout aussi déstabilisantes pour les États, les drogues de synthèse continuent leur percée. En 2023, l’EUDA surveillait plus de 950 substances psychoactives, dont 26 ont fait leur apparition cette année-là. Ces différentes molécules sont faciles à modifier, afin de permettre aux trafiquants de contourner les législations en vigueur.
Un système économique plus robuste que bien des États
Bien plus que de simples organisations criminelles, ces réseaux sont devenus des conglomérats globaux avec des organisations qui pourraient faire pâlir certains groupes industriels. La cocaïne, les méthamphétamines et autres opioïdes de synthèse sont désormais devenus des lignes comptables dans des groupes criminels qui pèsent parfois autant, sinon plus, que des sociétés de premier rang cotées en bourse.
À l’échelle mondiale, l’ONUDC comptabilise environ 316 millions d’usagers, tous produits confondus, avec une hausse linéaire de la consommation dans la plupart des régions du monde.
Pour répondre à la demande, les cartels anticipent en créant de nouveaux produits qu’ils testent à grande échelle, que ce soit en Afrique ou en Asie, et ce, en profitant des crises politiques et économiques.
En 2024, « l’Operation Orion », conduite par la Colombie avec plus de soixante pays partenaires, a permis de saisir environ 225 tonnes de cocaïne en six semaines. Toutefois, de telles opérations ne font hélas qu’amputer temporairement des stocks qui ne manqueront pas de se reconstituer très rapidement avec d’autres équipes, d’autres lieux et d’autres modus operandi.
Pourquoi la « guerre à la drogue » ne peut-elle pas être gagnée
Si l’on prend au sérieux les mots utilisés « guerre », « ennemi », « reconquête », il faut accepter de regarder en face la structure du rapport de force.
Une guerre suppose un objectif clair (vaincre et désarmer l’adversaire), une temporalité limitée et la possibilité d’un après. Or, pour le narcotrafic, ces trois conditions ne sont pas réunies.
« Eradiquer » la drogue revient à promettre quelque chose qui n’est jamais arrivé dans aucun pays du monde, y compris les plus répressifs. Ni la peine de mort pour trafic, ni la militarisation totale, ni les incarcérations massives n’ont empêché les marchés de se reconfigurer, parfois avec des niveaux de violence encore plus élevés.
Ensuite, la temporalité. La demande de stupéfiants est alimentée par des facteurs profonds qui reposent sur des inégalités sociales, des troubles psychiques, une culture festive, la pression de performance et, dans bien des cas, le désespoir. Ce mélange est explosif, et aucun plan, à ce jour, ne permettra de traiter ces différents aspects dans sa globalité. Aussi longtemps que la demande sera forte et solvable, l’offre trouvera des chemins.
Il y a, enfin, la nature même de l’adversaire. Les « cartels » ou « réseaux » ne forment pas un bloc monolithique que l’on pourrait vaincre une fois pour toutes. Il s’agit d’un écosystème mouvant de groupes, de sous-traitants, d’alliances temporaires, de microstructures familiales, le tout branché sur des marchés légaux et illégaux. On peut décapiter des réseaux, neutraliser des chefs, saisir des cargos et remporter des batailles, sans pour autant gagner la guerre.
Reconnaître cette réalité, ce n’est pas se résigner, mais plus exactement se donner une chance de concevoir des stratégies réalistes.
De la guerre permanente à la gestion lucide du risque
Alors, si la « guerre » est perdue d’avance, que reste-t-il ? Beaucoup, à condition de changer de logiciel.
Il est essentiel de procéder à une première rupture en éclaircissant l’objectif, qui ne doit plus être d’éliminer le trafic de drogue, une mission impossible, mais de se fixer des objectifs mesurables, tels que la réduction de la violence liée aux trafics, la reprise du contrôle des ports et des quartiers, la limitation des dommages sanitaires et l’impact sur le blanchiment d’argent. Certes, ces objectifs sont moins « vendables » sur un plan politique, mais beaucoup plus efficace en matière stratégique, car moins de morts, moins de tirs dans les rues, moins de jeunes enfants recrutés par des organisations criminelles sont autant de victoires concrètes.
La deuxième rupture consiste quant à elle à ne plus tout miser sur la répression, mais au contraire, à investir massivement sur la prévention, qu’il s’agisse de l’accès aux soins, de la prévention dans les établissements scolaires, ou bien en matière d’éducation. Comme le souligne l’ONU dans différents rapports, ce type d’approche apporte des résultats bien plus durables que le 100 % répressif.
Enfin, la troisième rupture est politique, puisque le narcotrafic prospère du fait de nombreux angles morts, qu’il s’agisse de ports qui sont mal contrôlés, de quartiers laissés à l’abandon, de territoires en outre-mer qui sont oubliés, d’une justice qui est saturée et de membres des forces de l’ordre qui sont épuisés. Aussi longtemps que ces vulnérabilités ne seront pas corrigées, les réseaux de trafiquants resteront les maîtres du jeu.
La disparition des drogues n’aura pas lieu et imaginer le contraire serait faire preuve de beaucoup de naïveté. Alors non, et, en ce sens, nous ne pouvons gagner cette « guerre » mais nous pouvons gagner bien des batailles en réduisant fortement les dommages.
Pour conclure et à titre d’exemple, le port du Havre laisse passer plus de 99 % des conteneurs sans qu’ils fassent l’objet de contrôles physiques ou électroniques, alors même que ce port est le plus contrôlé et surveillé de France.