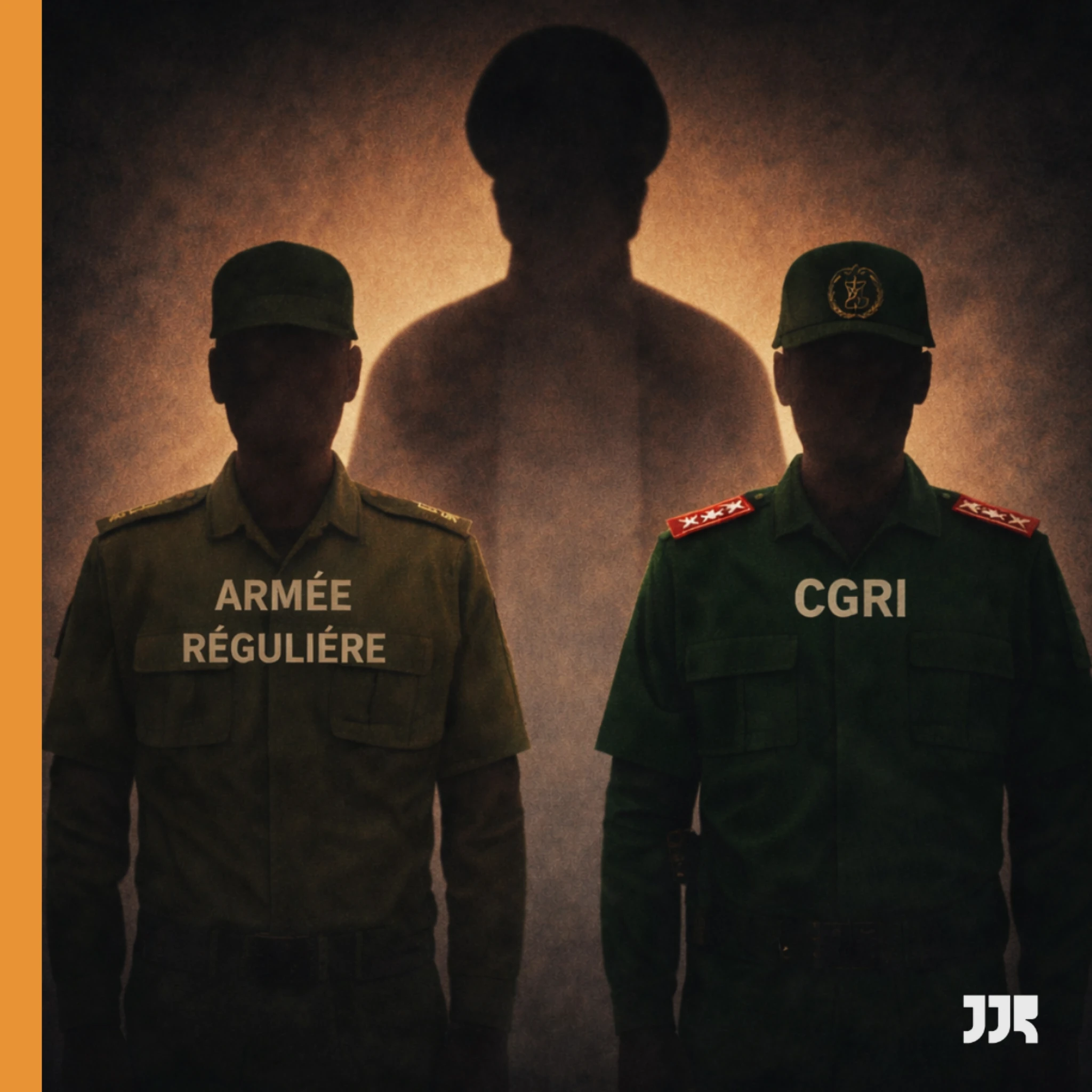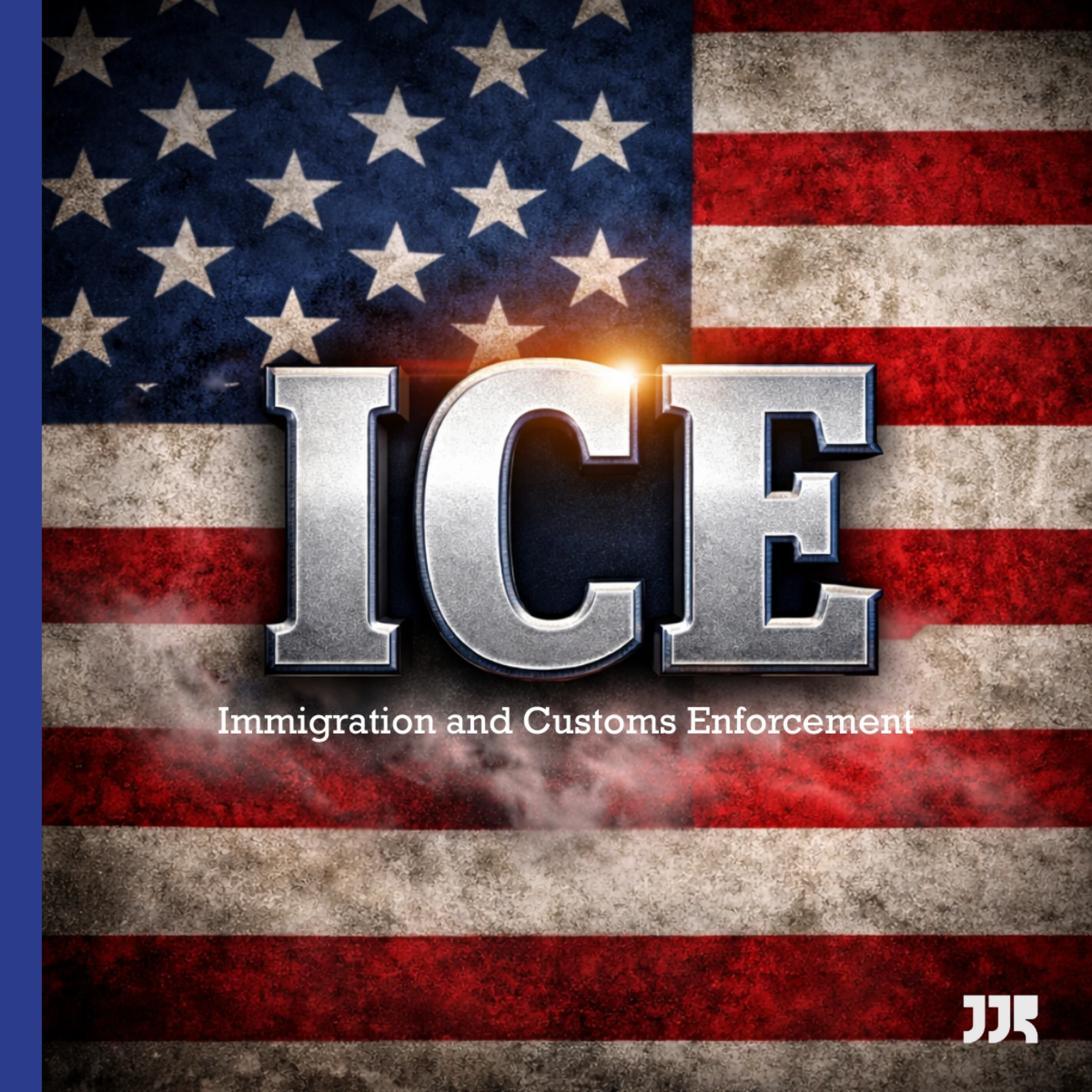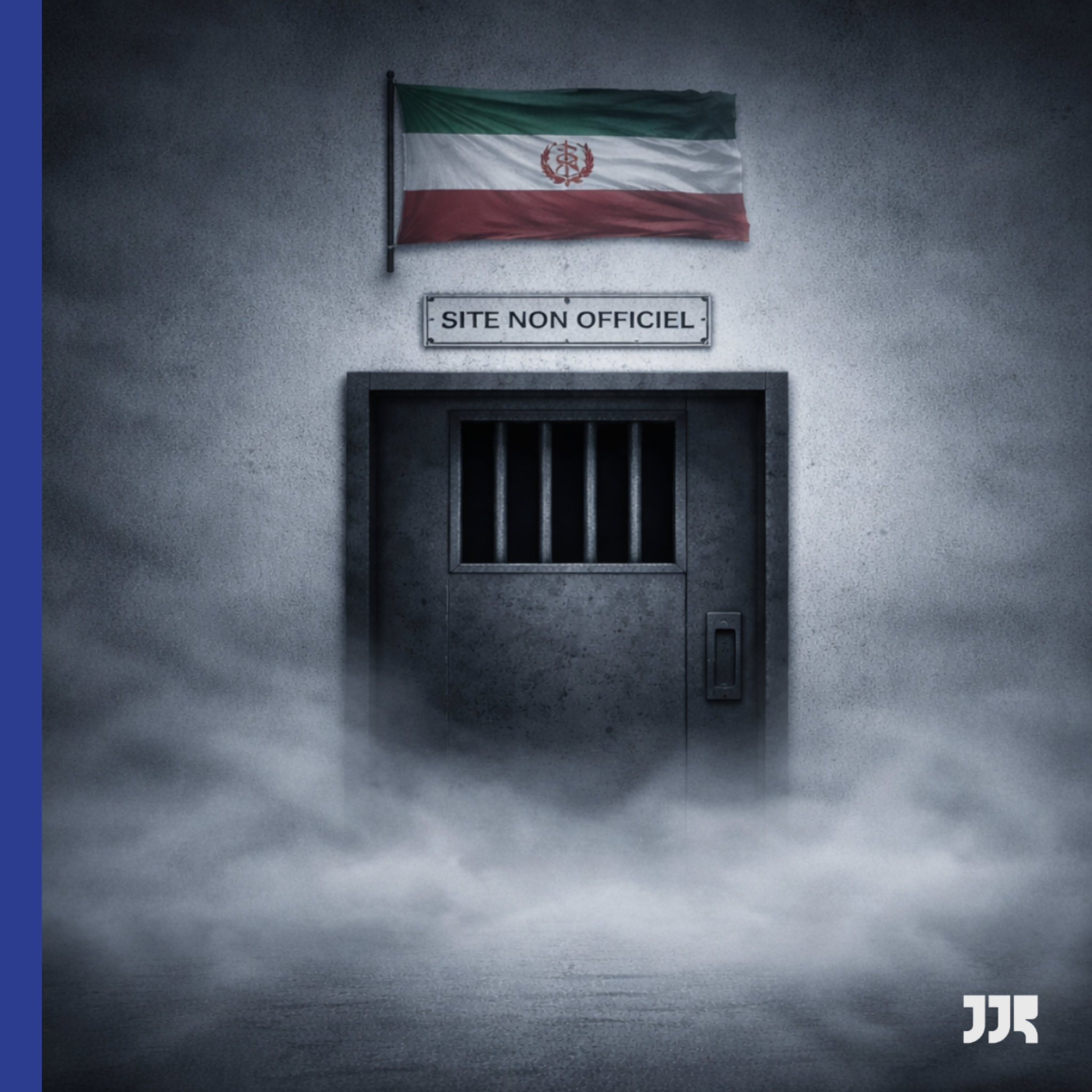Comprendre le syndicalisme dans la magistrature, c’est entrer dans un paysage bien plus nuancé qu’on l’imagine. Ni totem ni tabou. Un fait institutionnel, utile quand il défend l’indépendance ; problématique s’il griffe l’impartialité.
Un paysage pluriel, une majorité silencieuse
En France, les magistrats peuvent se syndiquer. C’est légal et classique dans l’administration. Le décor est relativement stable : l’Union syndicale des magistrats (USM) reste majoritaire, sur une ligne réputée plus « institutionnelle » ; le Syndicat de la magistrature (SM) est plus revendicatif, historiquement ancré à gauche ; Unité Magistrats est plus minoritaire, dans l’orbite FO. Les ordres de grandeur admis par la profession situent l’USM autour de deux tiers des voix, le SM autour d’un tiers, Unité Magistrats à un niveau plus faible. Mais le facteur le plus décisif est ailleurs : une part importante du corps (généralement entre la moitié et les trois quarts) qui ne se syndique pas. Cette abstention relative pèse sur la représentation et rappelle que la majorité des magistrats n’entend pas parler au nom d’un sigle.
Liberté syndicale, devoir d’impartialité : la ligne jaune
Le droit est très clair. La liberté syndicale existe, mais elle ne dissout ni le devoir de réserve ni l’exigence d’impartialité. Le statut de la magistrature (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, notamment l’article 10) fixe des impératifs : indépendance, dignité, apparence d’impartialité. Tous les manquements relèvent de la discipline, devant le Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Autrement dit, on peut participer au débat professionnel, mais influencer une procédure ou menacer la neutralité ou son apparence, c’est clairement non. La frontière n’est pas théorique, car elle s’évalue à l’aune des dossiers, des prises de position publiques, des contextes locaux.
Le standard européen : l’impartialité comme boussole
La référence dépasse l’Hexagone. En Europe, la Convention européenne des droits de l’homme — article 6 — érige l’impartialité en principe cardinal. La justice est indépendante et apparente comme telle. Le Conseil de l’Europe l’a rappelé dans la Recommandation CM/Rec(2010)12 sur les juges : l’indépendance n’est pas un privilège du corps, c’est une garantie pour le justiciable. Même logique pour l’ONU qui rappelle que les principes de base relatifs à l’indépendance de la magistrature soulignent la même obligation de neutralité, de protection contre toute pression, et de sanction en cas d’atteinte à la probité. Le message est constant. La liberté d’expression existe, mais doit se concilier avec l’autorité, l’impartialité et la confiance du public.
Pressions, menaces et État de droit
Les pressions existent sur les magistrats avec des campagnes d’invectives et des menaces directes. Ces menaces sapent la confiance et visent à intimider. En Europe comme ailleurs, l’indépendance des juges résiste d’abord par des garanties statutaires, ensuite par une protection effective et des poursuites contre les auteurs de menaces. Sans sécurité des magistrats, la sécurité du droit vacille. Ce point n’appelle pas de discussion et toute personne qui menace un juge doit être recherchée, interpellée, jugée, condamnée. C’est l’État de droit qui se défend.
Thémis, grammaire d’une justice exigeante
Thémis n’est pas un bibelot mythologique. La balance dit l’équilibre : peser le droit et les faits, sans céder à l’humeur du moment. Le glaive rappelle la force de la loi : sanctionner quand il le faut, et seulement quand il le faut. Le bandeau, enfin, préserve le regard : juger sans tenir compte du rang, de la notoriété, du bruit ambiant. Cette triade demeure l’éthique concrète de la fonction.
Un pluralisme utile, une impartialité non négociable
Le pluralisme syndical fait respirer l’institution et il met sur la table les moyens, les conditions d’exercice, la charge des contentieux, l’organisation du service public de la justice. Mais l’oxygène de la Justice reste l’impartialité. Elle n’est ni une posture ni un slogan. C’est une pratique quotidienne, un cap juridique, un standard européen, et une ligne disciplinaire tracée par le statut et le CSM. Qu’elle vienne à manquer ou à paraître manquer et l’édifice chancelle. Voilà le cœur du sujet.