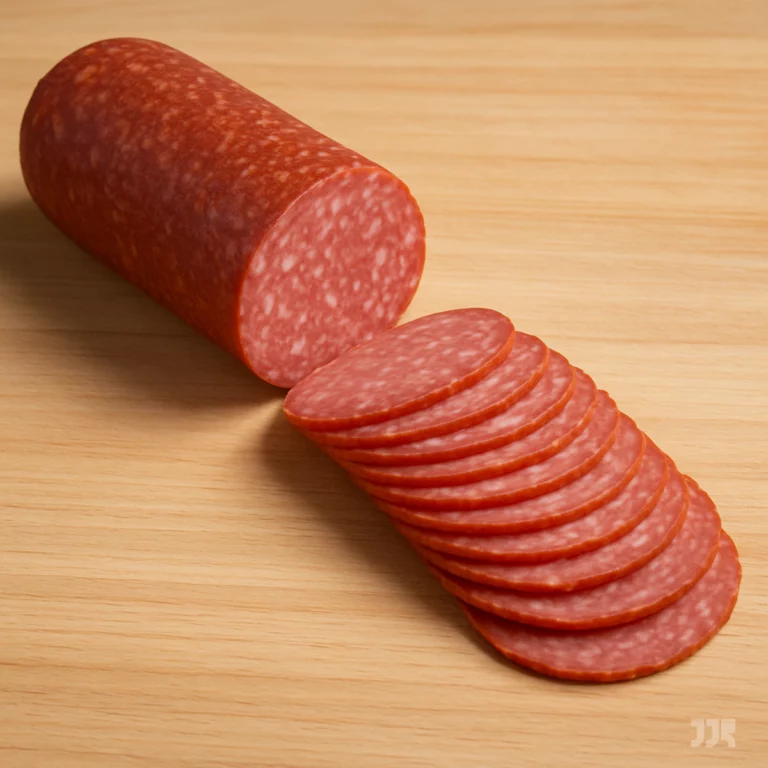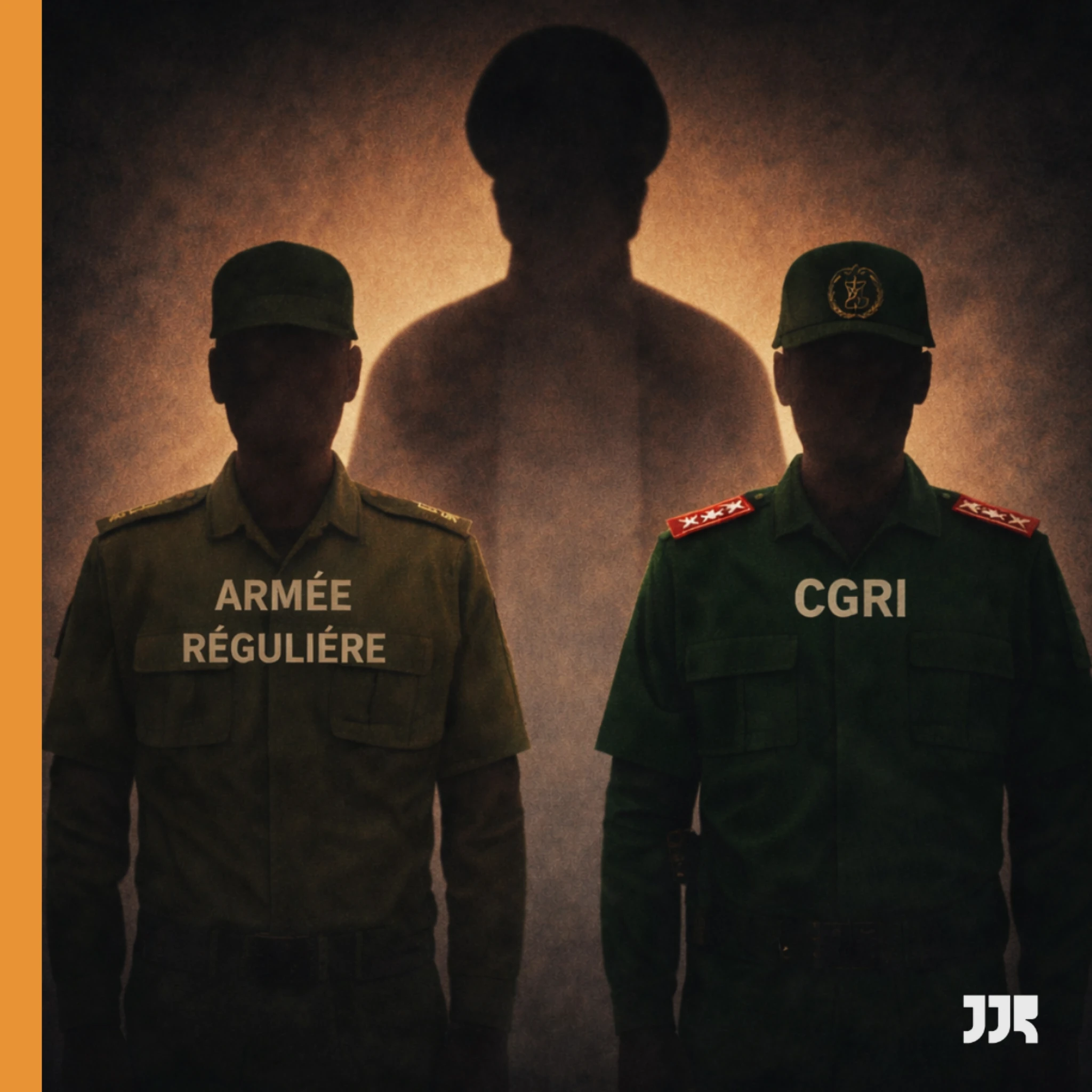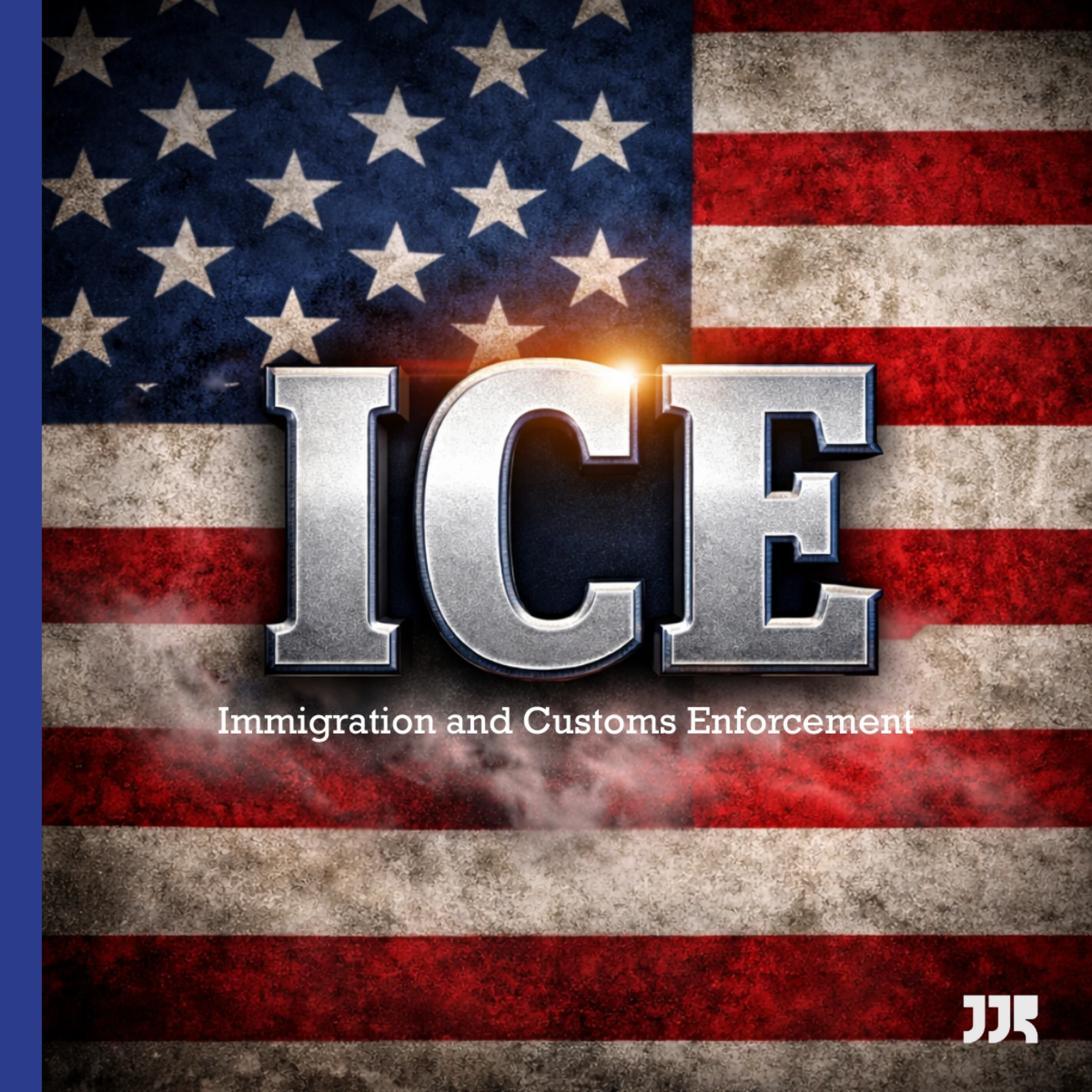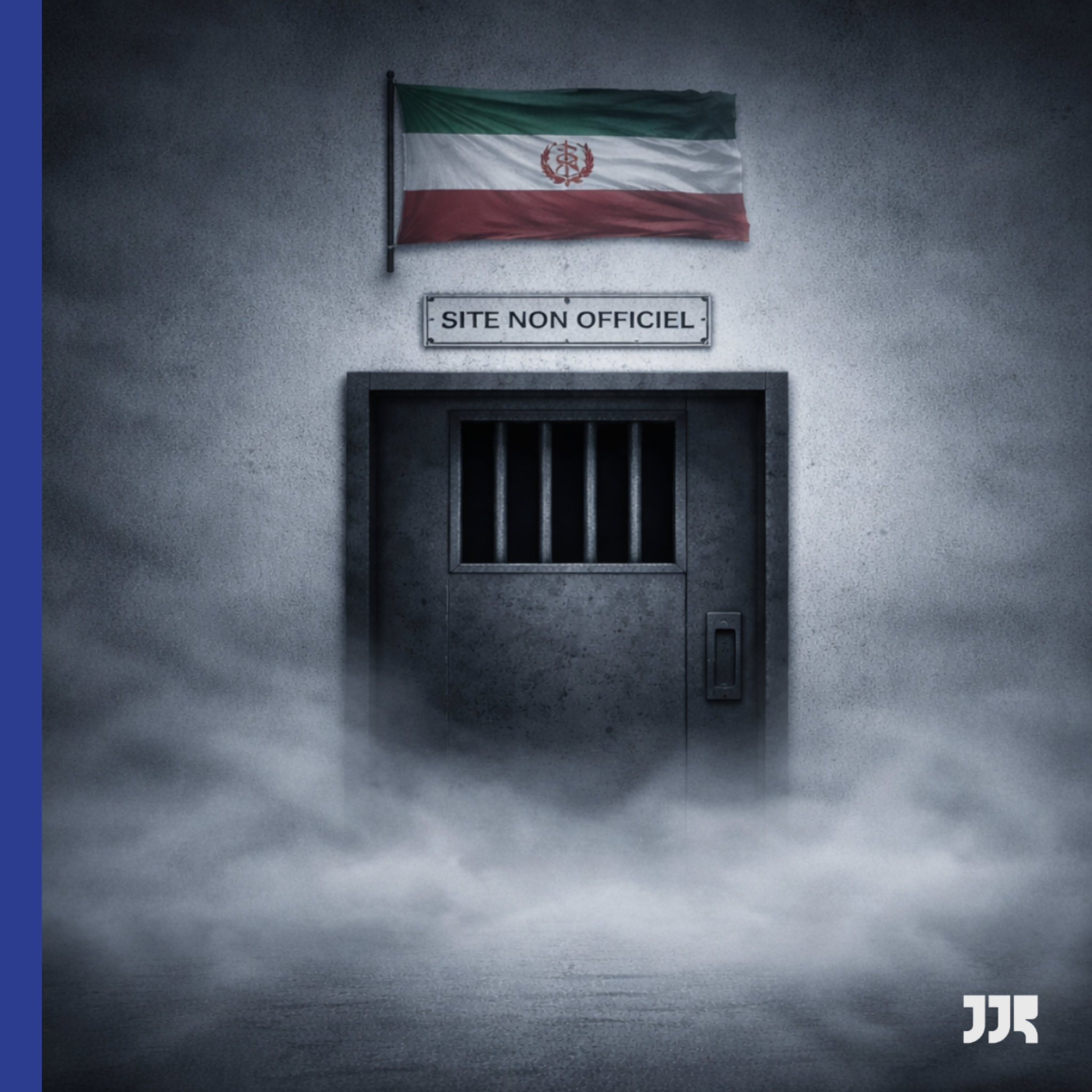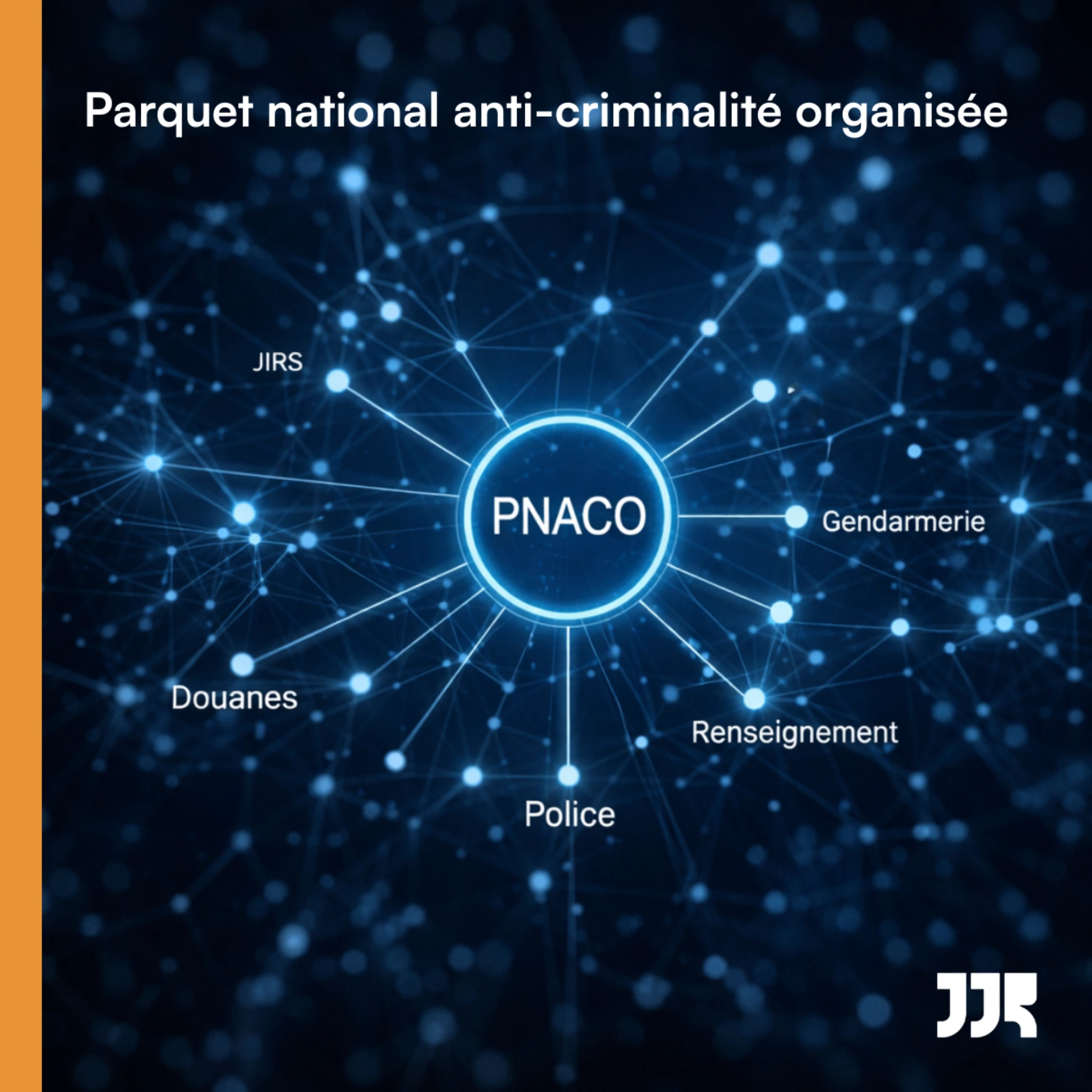Elle avance sans tambour ni fracas, un territoire, puis un autre et encore un autre. Une réforme ici, un « fait accompli » là-bas. Depuis plus de vingt ans, Vladimir Poutine perfectionne une méthode vieille d’un peu moins d’un siècle à savoir la stratégie du salami. Une manière d’imposer ses vues par petites tranches, sans provoquer l’explosion immédiate, et ça fonctionne.
Un concept forgé dans l’ombre de la Guerre froide
Le terme « stratégie du salami » est attribué à Mátyás Rákosi, dirigeant communiste hongrois des années 1940-50. Il décrivait comment « trancher » progressivement l’opposition jusqu’à la faire disparaître. Pas de coup d’éclat, pas d’offensive frontale, mais une série d’avancées minimes et régulières. Comme le rappelle l’historien Timothy Snyder (On Tyranny, 2017), cette tactique repose sur un principe simple à savoir que les sociétés tolèrent plus facilement des changements progressifs qu’un choc brutal.
Vladimir Poutine en a fait un outil central de sa politique extérieure.
Géorgie 2008 : le coup d’essai
En août 2008, Moscou intervient militairement en Géorgie sous prétexte de « protéger » les populations d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie. En cinq jours, les forces russes repoussent l’armée géorgienne et prennent le contrôle des deux territoires. Selon l’International Crisis Group (rapport août 2008), ces régions sont depuis occupées et administrées de facto par la Russie, malgré les résolutions de l’ONU condamnant l’atteinte à l’intégrité territoriale de la Géorgie.
Crimée 2014 : le changement par l’ordinaire
En mars 2014, des troupes sans insigne les « petits hommes verts » apparaissent en Crimée. L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) rapporte que l’opération, menée sans combats majeurs, a conduit à un référendum non reconnu par l’ONU, avant l’annexion officielle par la Russie. L’absence d’affrontements massifs a permis à Moscou de présenter cette prise de contrôle comme un processus « normalisé ».
Donbass 2014-2021 : l’usure comme arme
Entre 2014 et 2021, la Russie soutient un conflit de basse intensité dans l’est de l’Ukraine. L’Office du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (OHCHR) estimait en 2019 le bilan à environ 13 000 morts. Moscou nie toute implication directe, tout en fournissant armements, conseillers et propagande aux forces séparatistes. Cette guerre « gelée » maintient un levier stratégique sur Kiev, selon un rapport onusien de décembre 2021.
Ukraine 2022 : la tranche finale… ou pas
L’invasion à grande échelle du 24 février 2022 peut sembler rompre avec la logique graduelle. Pourtant, comme le souligne le think tank britannique Chatham House (analyse du 4 mars 2022), elle s’inscrit dans une décennie de micro-avancées : interventions locales, annexions partielles, tests de réaction occidentale. Même après l’offensive, certaines zones sont intégrées par étapes, via décrets administratifs et référendums organisés sous occupation.
Une méthode au-delà du militaire
La stratégie du salami s’exprime aussi dans le champ informationnel. Les services de renseignement américains (rapports 2017 et 2021) ont documenté l’ingérence russe dans plusieurs processus électoraux occidentaux, via des campagnes numériques fragmentées mais persistantes.
Dans l’énergie, l’Agence internationale de l’énergie (IEA) souligne que Moscou a réduit progressivement ses livraisons de gaz vers l’Union européenne avant de les couper presque totalement après 2022, accentuant les divisions et pressions économiques.
Des limites et des risques
Cette méthode repose sur la prudence adverse. Mais elle a ses failles. En effet, la succession de petites avancées peut finir par provoquer un sursaut massif, comme l’illustre l’ampleur des sanctions adoptées par l’UE, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et d’autres pays après février 2022. Et à mesure que les « tranches » se rapprochent des intérêts vitaux d’un adversaire, le risque d’escalade devient plus élevé.