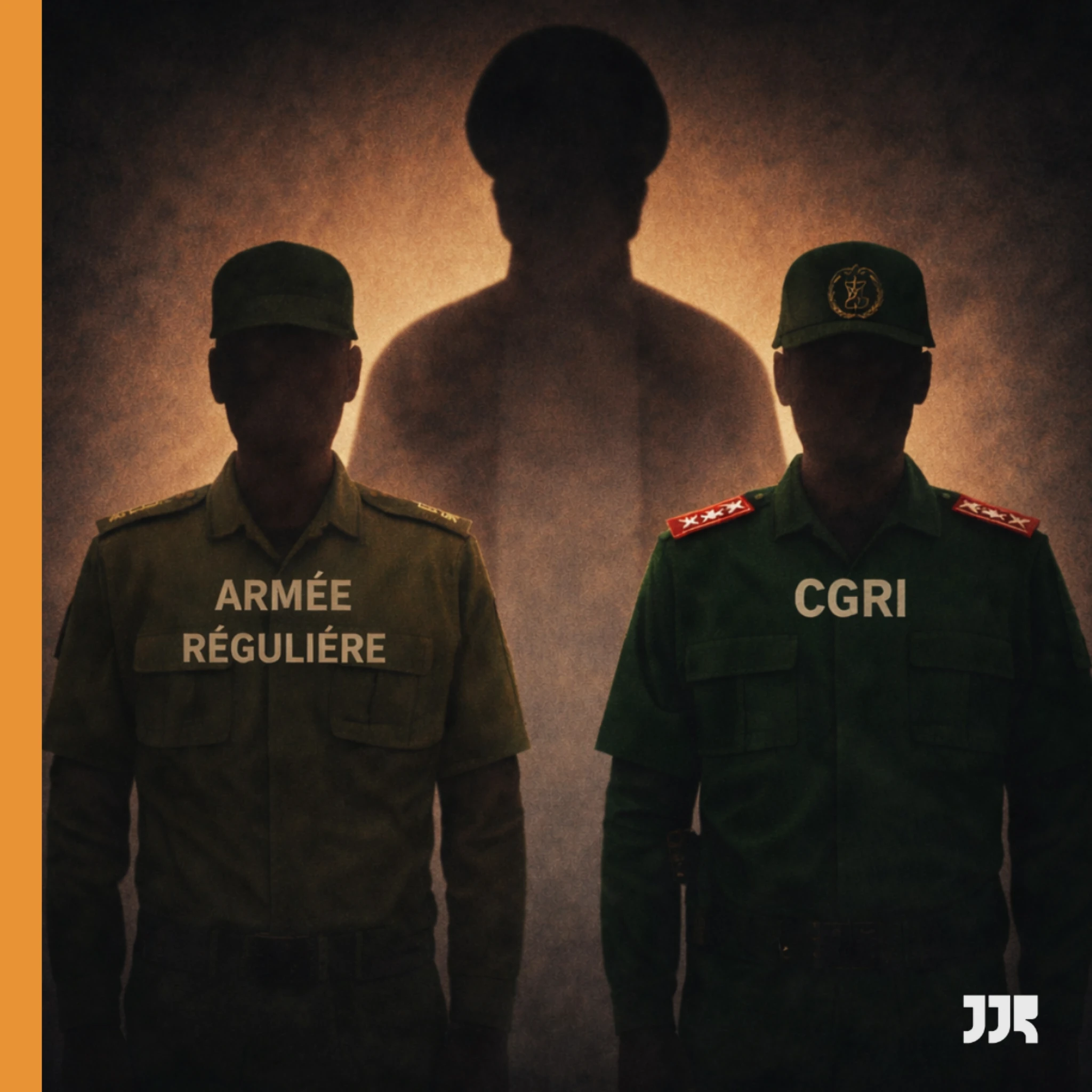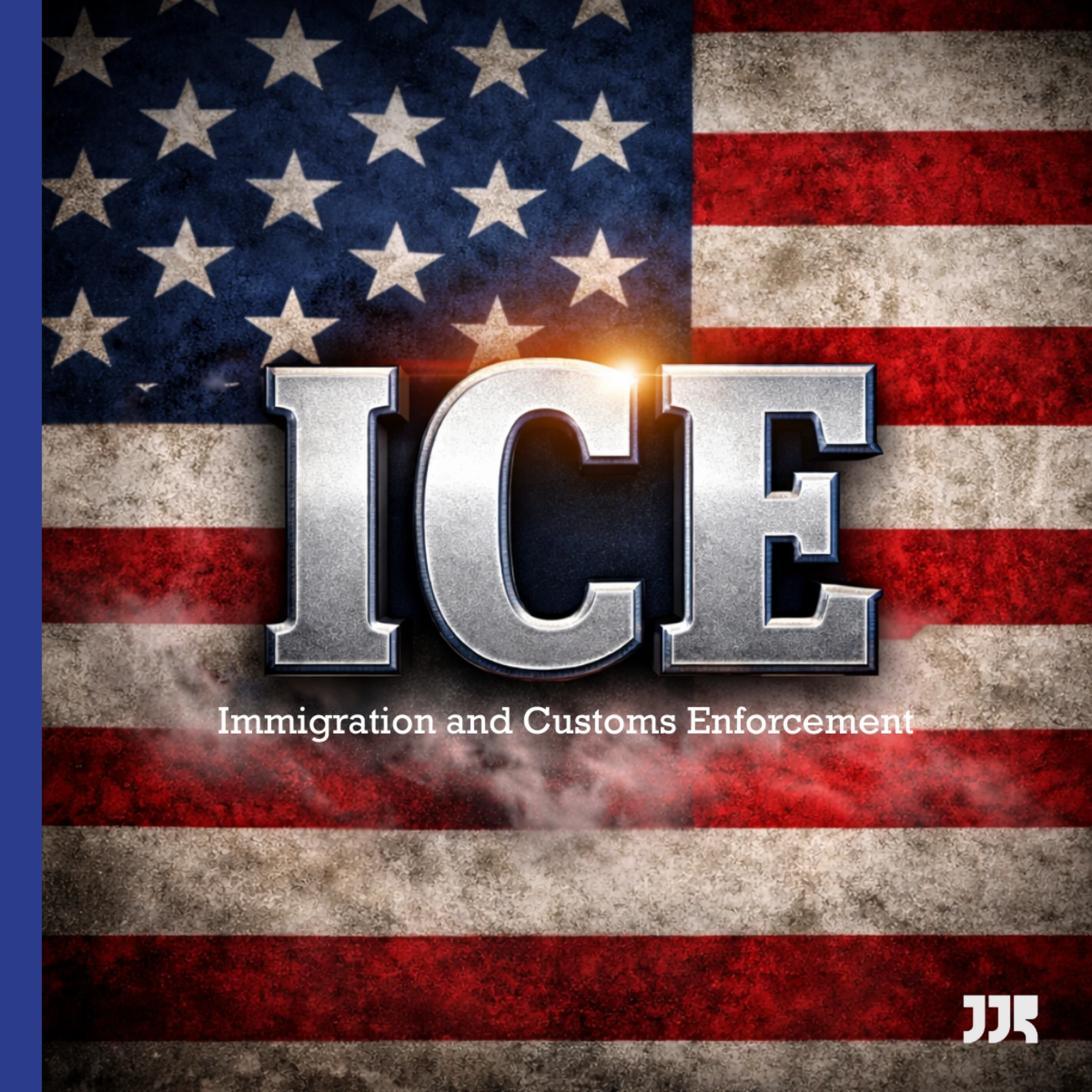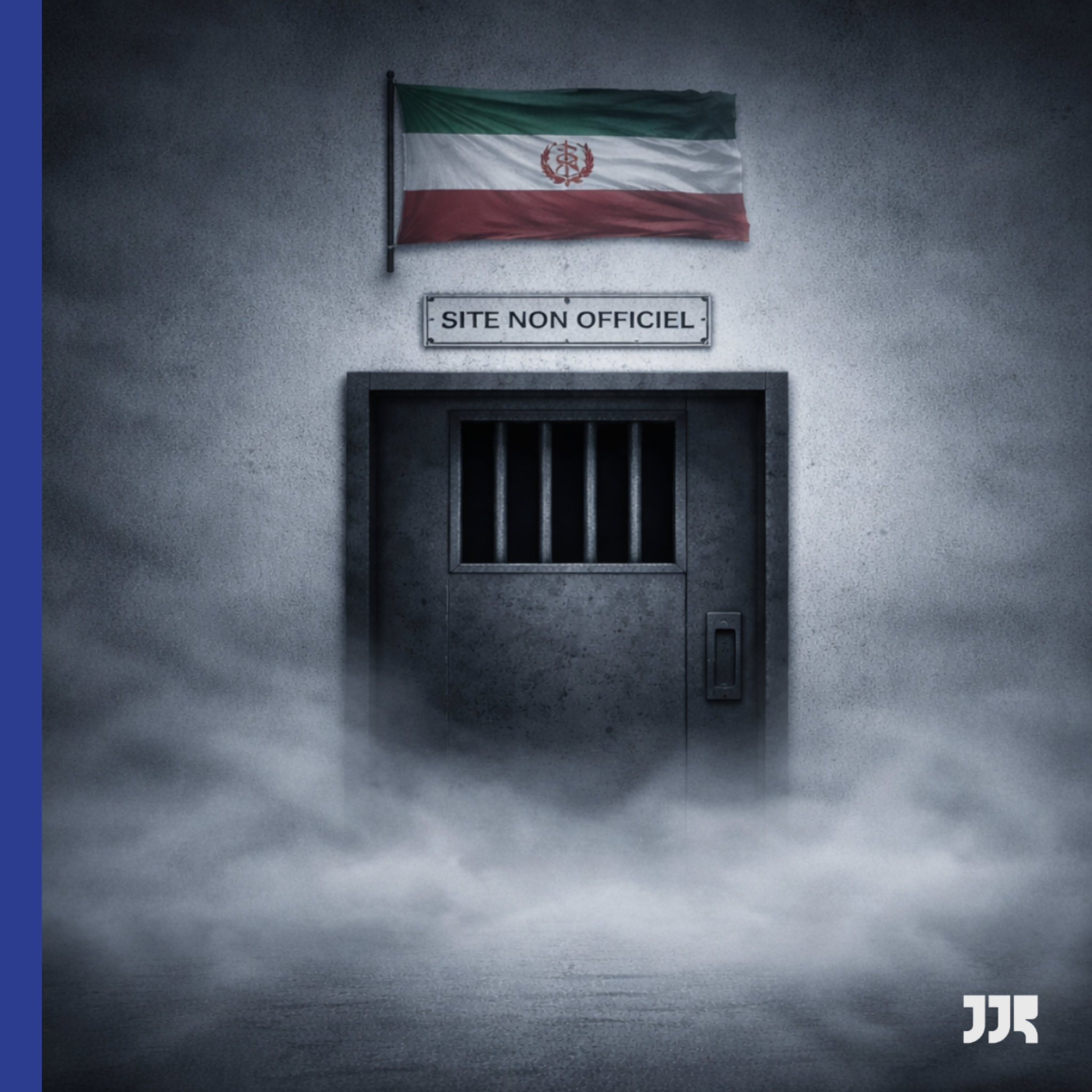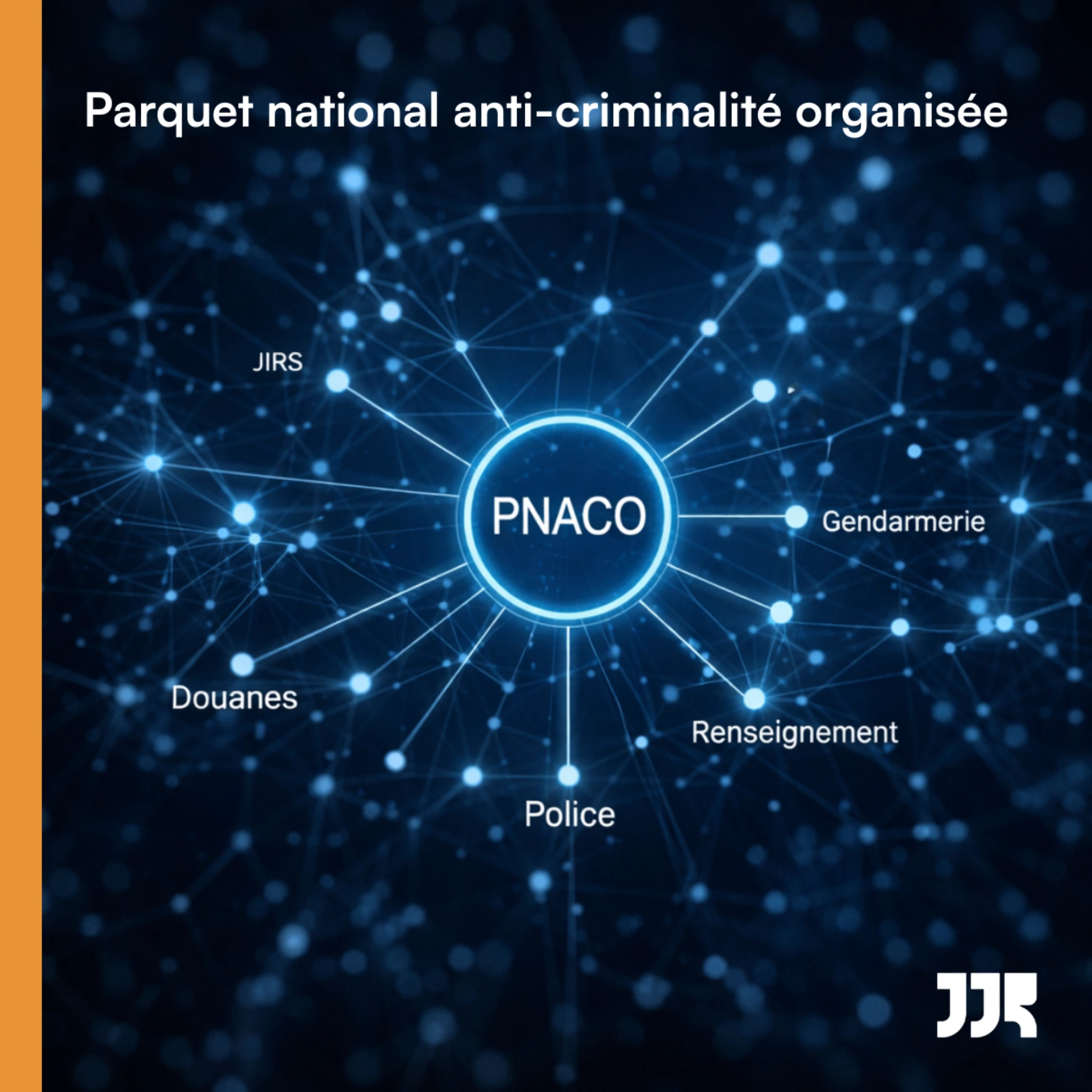On les désigne en voyous. On les traque ou on les fantasme. Mais qui prend encore le temps de comprendre ce que sont réellement les bandes ? Derrière l’hostilité, il y a souvent la survie, et, derrière la violence, une quête de reconnaissance et parfois même d’existence.
Ni mafia ni gang : une structure à part
Les bandes de jeunes en France n’ont ni la rigueur quasi militaire des mafias ni la structuration des gangs américains. Ce sont des groupes mouvants, parfois informels, parfois organisés. Leur cohésion repose rarement sur la hiérarchie. Elle tient à l’origine commune, au quartier partagé, à l’hostilité perçue de l’extérieur. Ensemble, ils se sentent moins vulnérables, et plus visibles.
Une réponse à l’invisibilité sociale
Grandir dans un quartier dit sensible, c’est souvent évoluer dans un monde à part, avec ses codes, ses règles, ses injustices. L’école peine à accrocher les jeunes et les familles se battent bien souvent pour survivre. L’État, quand il apparaît, le fait généralement en uniforme. Dans ce contexte, la bande devient un refuge et surtout un moyen de briser l’anonymat en revendiquant une place dans la société et d’exister, enfin.
La violence comme langage commun
Là où les mots ne suffisent plus, les actes prennent le relais. Une agression, un vol, un règlement de compte ne sont pas toujours prémédités. Ils traduisent parfois une frustration devenue insupportable. Une manière, aussi brutale soit-elle, de s’imposer dans un monde qui ne vous reconnaît pas. Ce n’est nullement une excuse, mais une description de la psychologie de ces jeunes gens.
La peur comme lien identitaire
Appartenir à une bande, c’est partager un vécu, mais également, une défiance envers les institutions et notamment « les flics ». Une expérience commune de la rue et, souvent, une peur partagée qui est celle de disparaître, de ne pas s’en sortir, de rester coincé dans un monde sans horizon. Cette peur lie les membres. Elle les pousse à défendre un territoire, une réputation, un soi-disant sentiment de loyauté ou de respect, jusqu’à l’absurde et très souvent de manière monstrueuse. Très nombreux sont ces jeunes qui n’ont plus aucune limite.
Des politiques toujours en retard
Depuis des décennies, les réponses officielles oscillent entre répression et prévention molle et autres tentatives d’achat d’une paix sociale. Clubs de sport, médiateurs, campagnes de communication… Autant de rustines apposées sur des plaies qui sont extrêmement profondes. Les projets à long terme sont des mirages alors qu’ils devraient permettre de mettre en place une véritable stratégie alliant prévention, répression et réinsertion.
Cet article est issu des réflexions développées dans mon livre Insécurité en France : On n’est pas sorti de l’auberge ! disponible en librairie et sur les plateformes en ligne. Un ouvrage pour comprendre en profondeur les racines, les mutations et les enjeux de l’insécurité aujourd’hui.