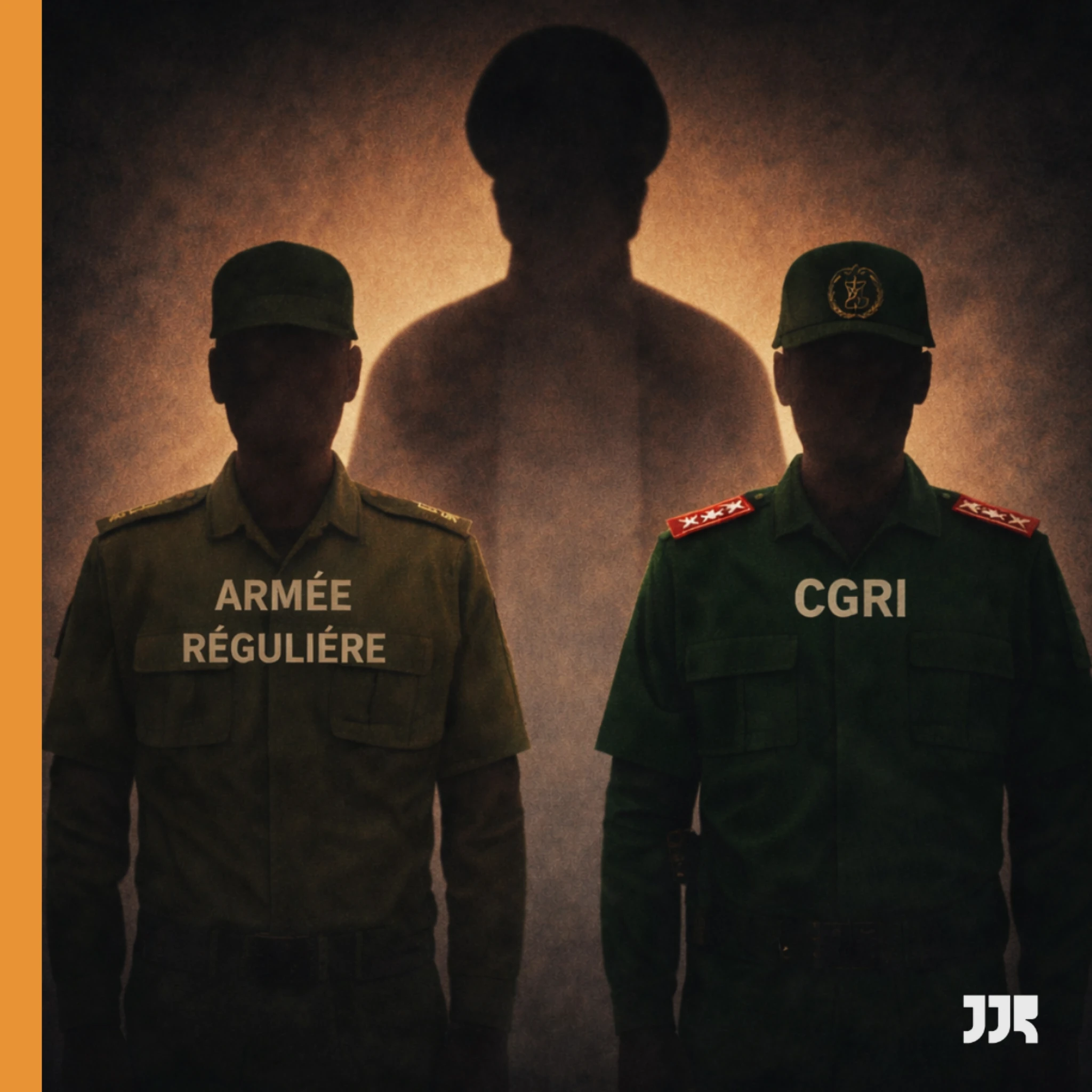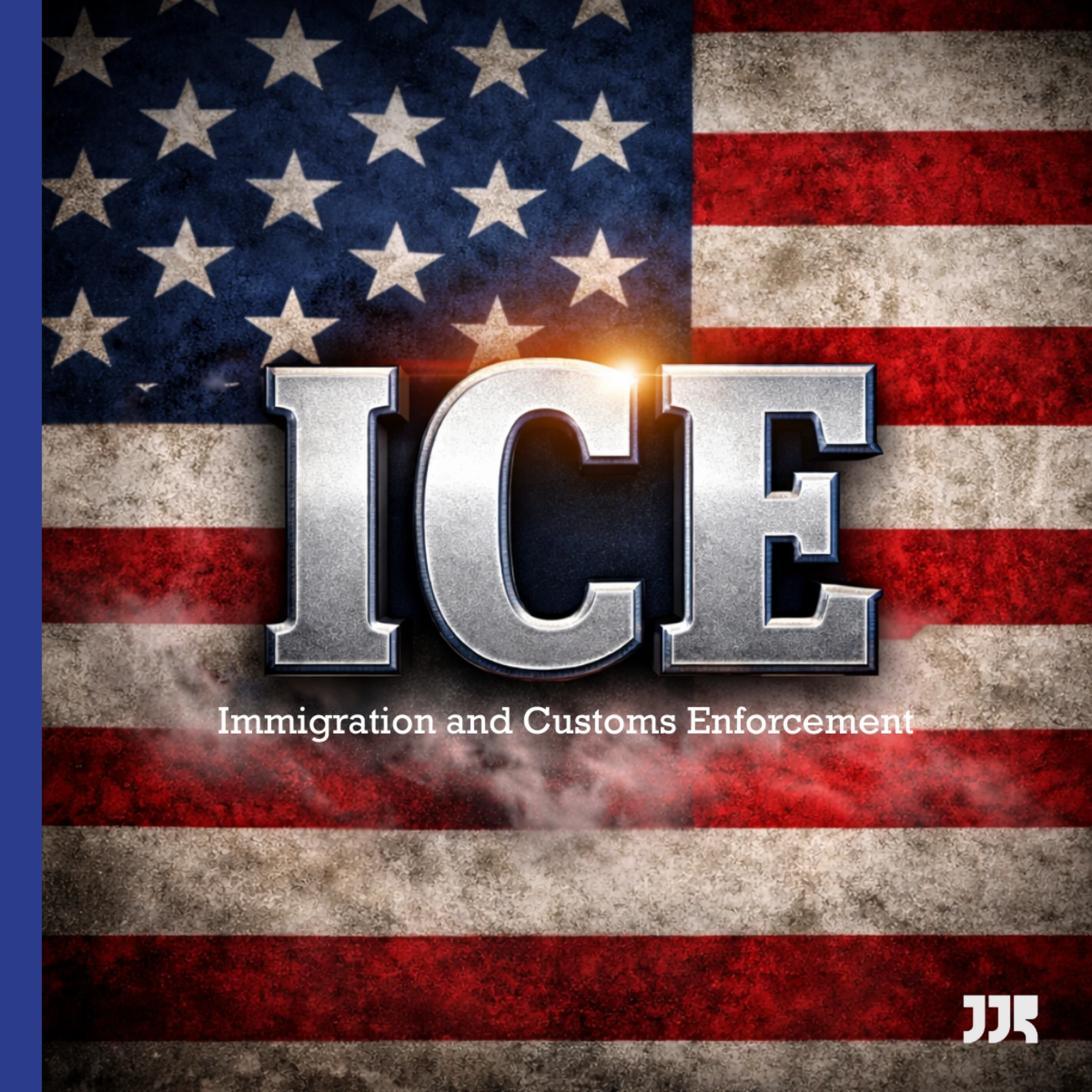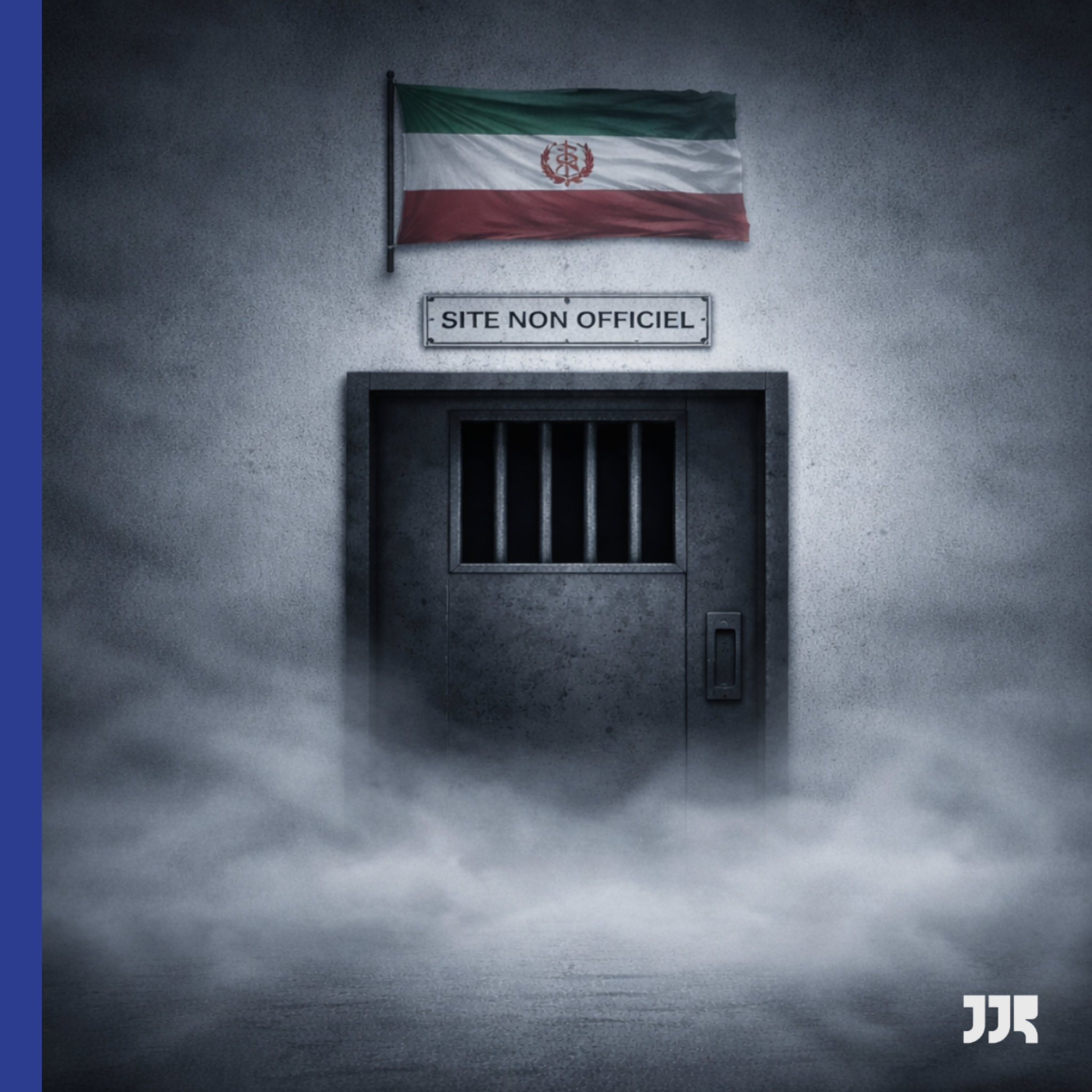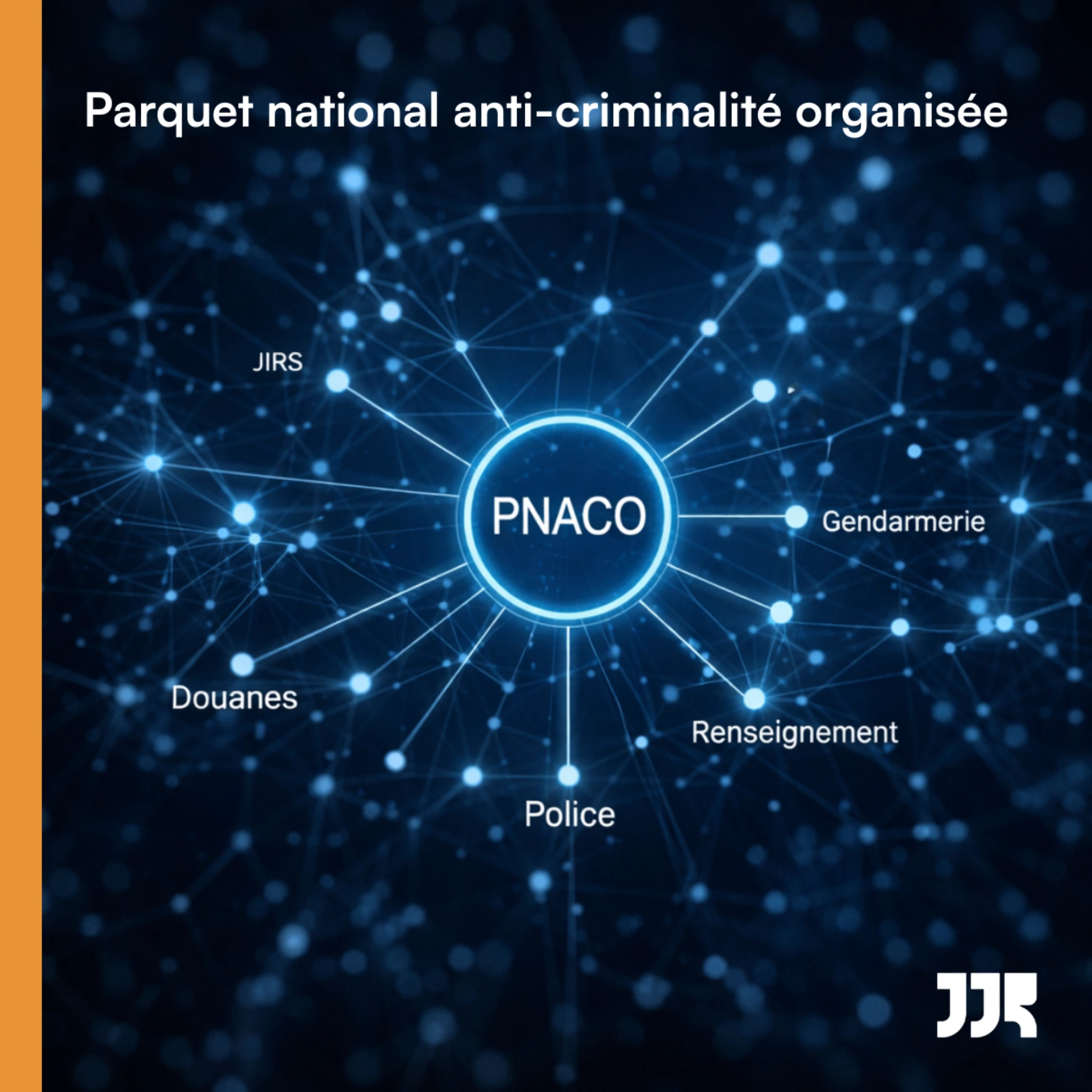On ne bâtit pas une politique de sécurité sans des capacités financières importantes. En tout cas, pas sérieusement, et certainement pas sur le long terme. Pourtant, le lien entre sécurité et économie reste trop souvent sous-estimé. Comme si on pouvait sécuriser une nation à coups de slogans et de bricolage budgétaire.
Des ambitions sans moyens
Les discours sont fermes, les intentions chez certains politiciens très claires. Plus de policiers, de meilleures formations, du matériel moderne, davantage de magistrats, plus de prisons… Mais derrière chaque promesse, il y a une réalité toute simple qui est que tout cela coûte. Et pour reprendre une formule désormais célèbre, cela coûte « un pognon de dingue ».
Or, une économie fragile comme cela est le cas pour la France aujourd’hui ne peut pas financer un haut niveau de sécurité capable de répondre à tous les défis posés. Non, une stratégie de sécurité ne peut pas reposer uniquement sur le volontarisme de ses acteurs. Elle exige des moyens colossaux, très largement supérieurs aux budgets actuels des ministères de l’Intérieur et de la Justice.
Sécurité et politique d’investissement
Chaque euro investi dans la prévention, la formation, la rénovation des commissariats ou la lutte contre la cybercriminalité n’est pas une dépense, mais un investissement pour l’avenir. Car l’insécurité a un prix. Ce prix est tout d’abord, direct avec des émeutes, des dégâts, des procédures, des hospitalisations ou bien encore avec les frais de justice. Mais ce coût est également indirect à travers le décrochage scolaire, la perte d’attractivité ou la montée d’une défiance.
Quand la violence s’installe dans un quartier ou une ville, les commerces ferment, les habitants fuient, le chômage grimpe, l’économie locale s’écroule. La sécurité, c’est aussi une condition de prospérité.
L’effet boomerang du sous-financement
On croit faire des économies en rognant sur les effectifs, en repoussant les projets, en différant les rénovations. Mais à l’arrivée, ces « économies » coûtent plus cher que les investissements qu’on n’a pas osé faire. L’inaction coûte toujours et souvent, elle coûte très cher.
Combien de services du ministère de l’Intérieur ou de la Justice sont aujourd’hui à bout de souffle ? Combien de personnels épuisés, de systèmes dépassés, d’équipements hors d’usage ? Tout cela produit de la lenteur, de l’inefficacité, du découragement… et donc plus d’insécurité. En matière de sécurité, les miracles n’existent pas. Sans socle économique solide, aucune politique publique ne tient.
Sécuriser la France, c’est aussi investir en France
Renforcer la sécurité, c’est acheter du matériel. C’est générer des marchés publics, des retombées pour l’industrie, les PME ou le numérique. Ce n’est pas une ligne de dépense mais un levier de croissance à la condition de le penser comme tel.
Mais pour cela, il faut sortir de la logique du court terme. Celle qui consiste à faire “le minimum visible” pour calmer l’opinion. Il faut entrer dans une logique de transformation qui sera obligatoirement longue, exigeante, coûteuse, mais tellement indispensable.
La question n’est donc pas de choisir entre sécurité et économie. La seule vraie question, c’est celle-ci : comment mobiliser l’économie au service d’un projet sécuritaire ambitieux ? Et surtout : comment éviter que l’insécurité ne vienne, demain, miner toute relance économique ?
Cet article est issu des réflexions développées dans mon livre Insécurité en France : On n’est pas sorti de l’auberge ! disponible en librairie et sur les plateformes en ligne. Un ouvrage pour comprendre en profondeur les racines, les mutations et les enjeux de l’insécurité aujourd’hui.