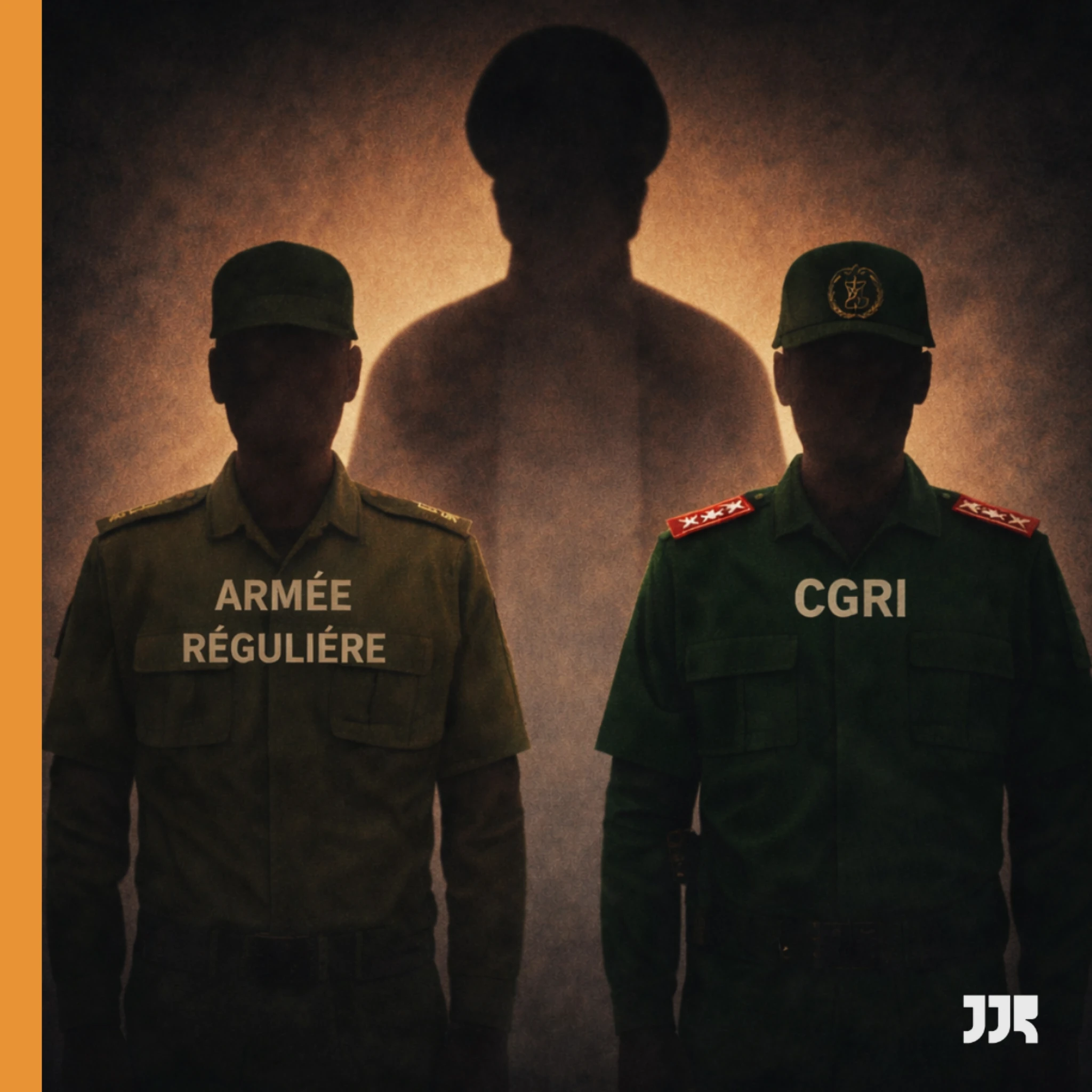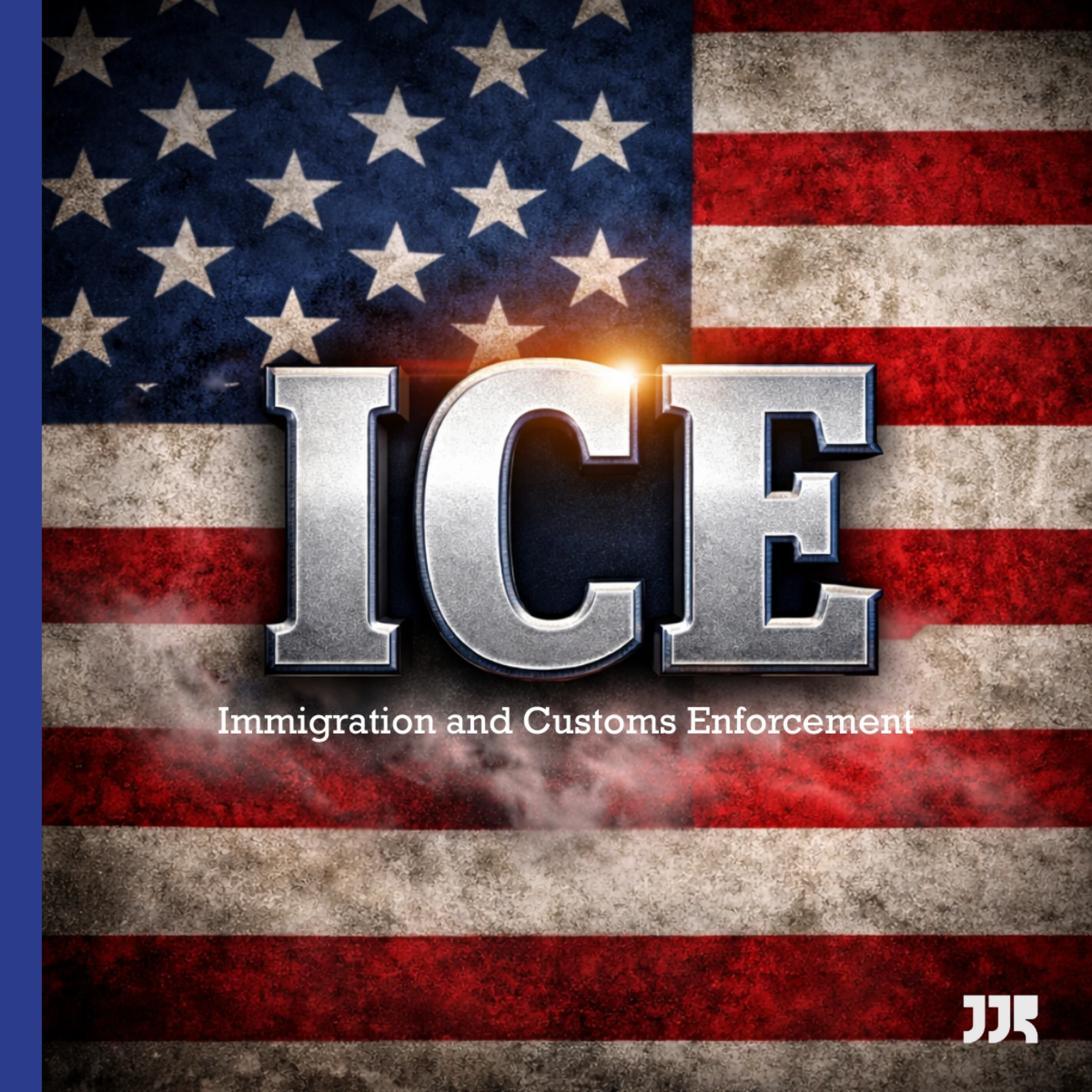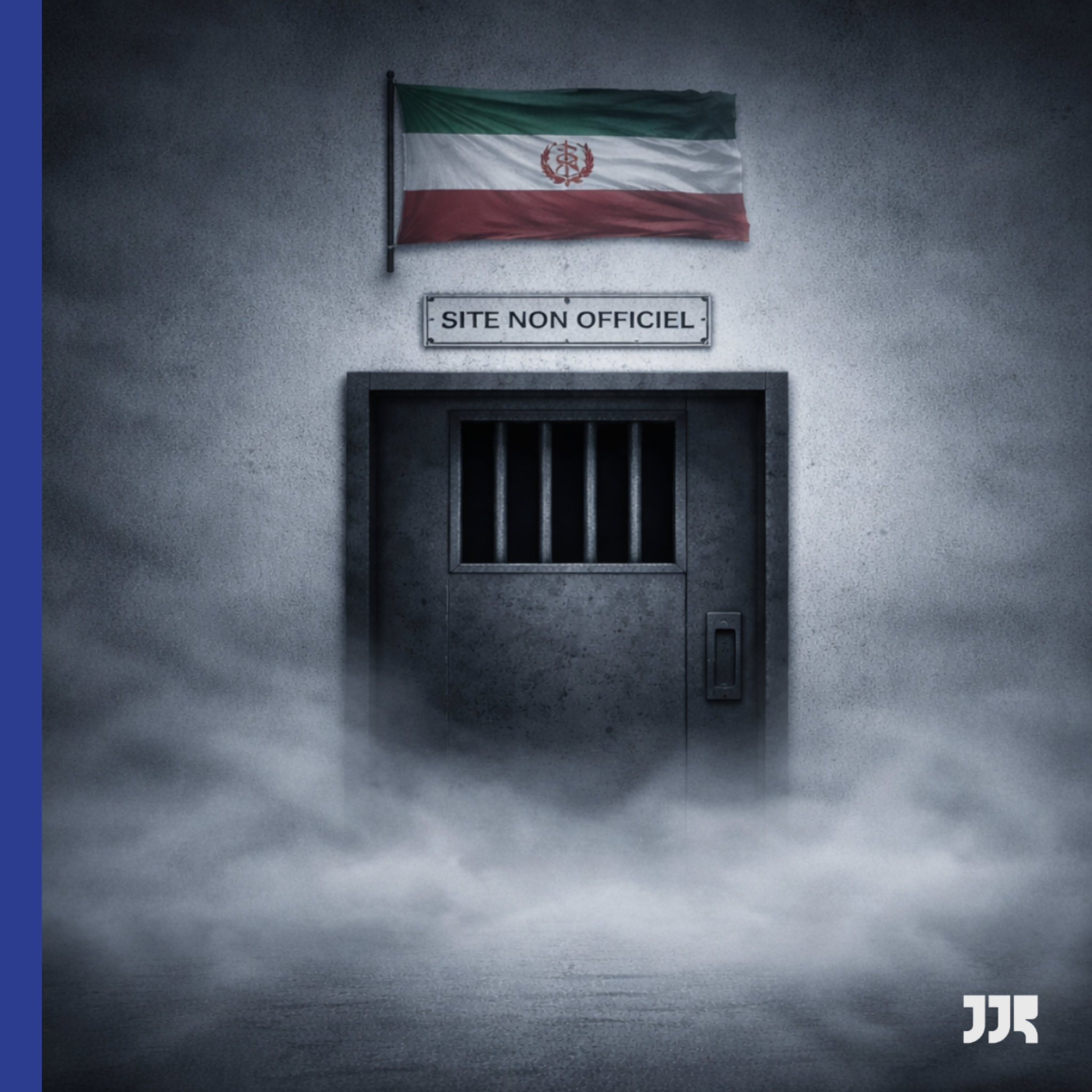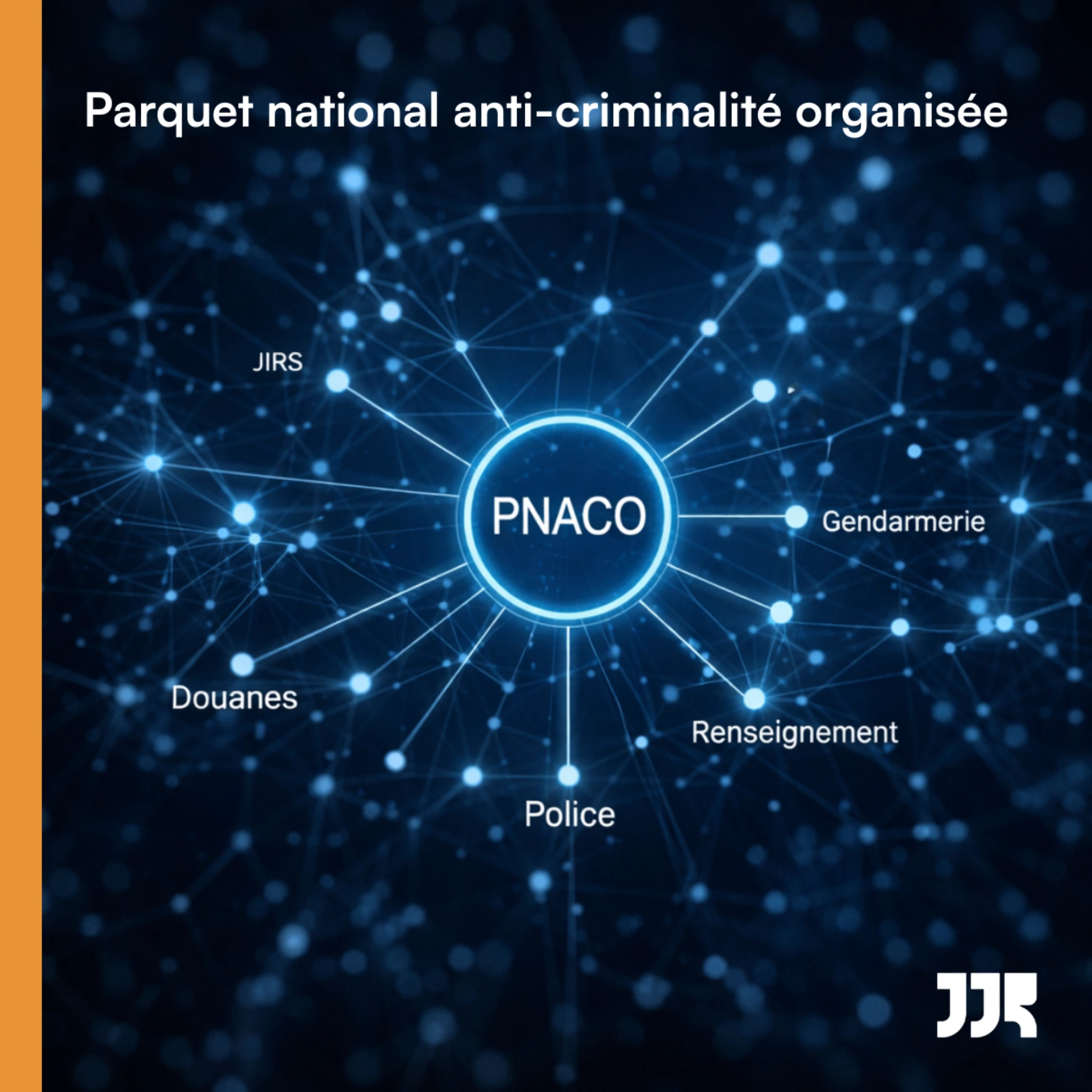À Saint-Étienne, un projet d’attentat a été déjoué. Un jeune homme de 18 ans, influencé par une idéologie née dans les recoins sombres d’internet, s’apprêtait à passer à l’acte. Une première en France et sans doute pas une dernière.
Une radicalisation silencieuse
Il s’appelait Timothy G., il avait 18 ans, pas de casier judiciaire, pas de passé trouble. Mais dans son téléphone et dans sa tête, un poison s’était lentement distillé. Celui de la communauté « incel », contraction de involuntary celibate. Un courant virulent, profondément misogyne, où la frustration sexuelle se transforme en haine de genre.
Il ne portait aucun uniforme pas plus que de drapeau ou de slogan. Il avait « juste » un projet qui était de tuer des femmes à l’arme blanche. Frapper au hasard, au nom d’une revanche personnelle, nourrie d’un ressentiment global. Ce mardi, la police antiterroriste l’a arrêté juste à temps. Le Parquet national antiterroriste (PNAT) s’est saisi de cette affaire une première dans un dossier lié explicitement à l’idéologie « incel ».
La haine algorithmique comme terreau
Ce type de radicalisation ne suit pas les schémas classiques. Elle ne passe pas par une cellule, un mentor ou une idéologie structurée. Elle germe dans les fils TikTok, les forums Reddit, les sous-cultures numériques aux contours flous. Une vidéo, un mème, un commentaire provocateur et l’engrenage se met en marche.
Timothy n’a pas été endoctriné à coup de discours politiques. Il a été happé par des contenus anodins en apparence, puis progressivement immergé dans un discours de haine déguisé en fatalisme. Les « incels » ne revendiquent pas un monde meilleur. Ils le vomissent tel qu’il est, et en veulent à celles qui, selon eux, les en ont exclus.
Une menace encore sous-estimée
En France, cette mouvance reste peu visible médiatiquement. Moins spectaculaire que le djihadisme, moins organisée que l’ultra-droite radicale ou l’ultra-gauche, elle évolue dans une zone grise. Mais elle n’en est pas moins dangereuse. Elle frappe sans logique apparente, sans revendication politique classique. Et c’est justement ce flou qui rend sa détection si difficile.
Derrière un écran, des adolescents nourrissent des fantasmes violents, enrobés de références à des tueurs célèbres comme Elliot Rodger ou Alek Minassian. Ils se construisent une mythologie toxique, faite de solitude, de ressentiment et de haine. Et certains, un jour, décident de basculer dans l’acte.
Prévenir l’invisible, former à l’impensé
Ce n’est pas seulement une affaire de police ou de renseignement. C’est une question de société. Comprendre cette nouvelle grammaire de la haine, c’est accepter qu’elle ne prend plus toujours les formes d’hier. Elle s’adapte, elle infiltre, elle transforme. Elle se nourrit des failles psychologiques, des isolements sociaux, des logiques de communauté numérique.
Il faut former, prévenir, décrypter. Sortir ces radicalités de l’angle mort. Les écoles, les plateformes, les médias doivent apprendre à détecter ces signaux faibles. Parce que ce type de passage à l’acte n’est pas une anomalie. C’est une alerte.
Et c’est maintenant qu’il faut y répondre.