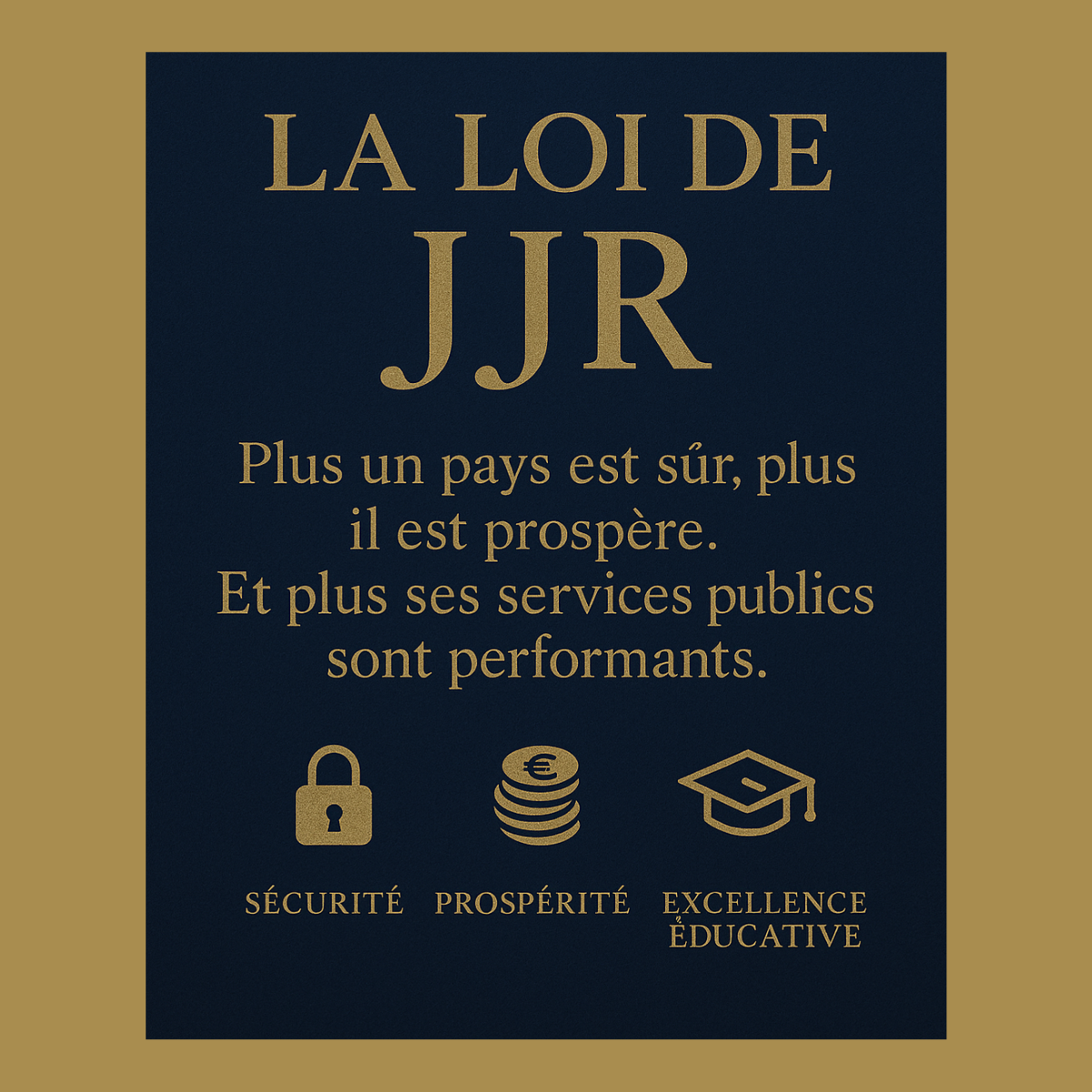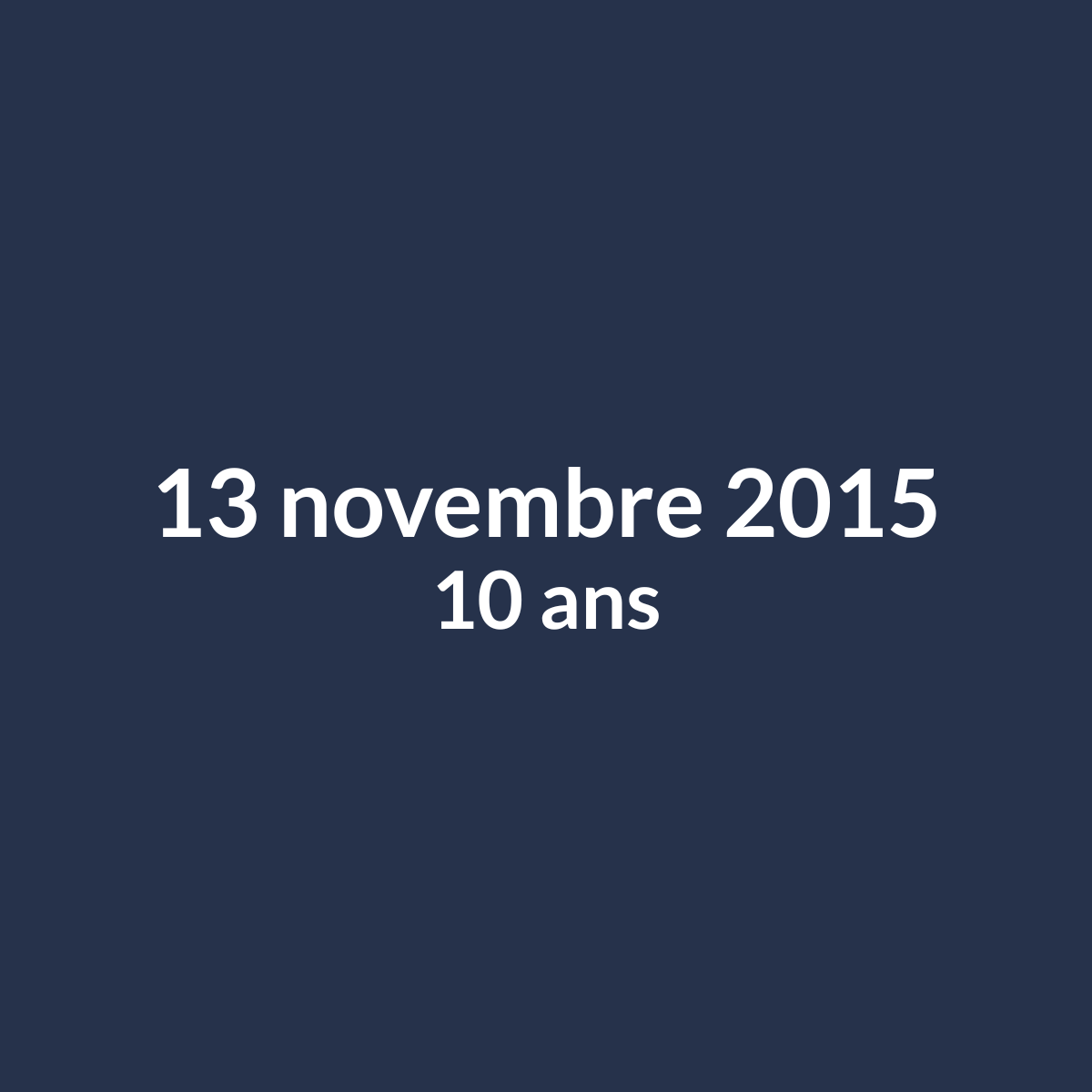Apparu dans les années 1990 pour tenter de relativiser une situation sécuritaire complexe, le « sentiment d’insécurité » n’a cessé de croître dans l’opinion publique, renforcé par la médiatisation massive des faits divers et la perception d’une justice trop laxiste.
Une évolution contrastée des délits et crimes
Entre 2016 et novembre 2023, les chiffres officiels (source SSMSI) traduisent une situation en demi-teinte :
- Homicides (y compris coups et blessures volontaires suivis de mort) : +19,49 % ⬆️
- Coups et blessures volontaires (personnes de 15 ans ou plus) : +53,89 % ⬆️
- Violences sexuelles : +118,49 % ⬆️
- Destructions et dégradations volontaires : +22,37 % ⬆️
- Escroqueries : +37,27 % ⬆️
À l’inverse, d’autres infractions ont enregistré une baisse :
- Vols avec armes : -30,16 %
- Vols violents sans arme : -47,12 %
- Cambriolages de logements : -18,65 %
- Vols de véhicules : -22,76 %
Si la diminution des vols est réelle, la forte augmentation des atteintes aux personnes pèse lourdement sur le climat d’insécurité ressenti par la population.
L’impact des médias et des réseaux sociaux
À l’ère de l’information en continu et des réseaux sociaux, chaque fait divers, chaque drame, prend une ampleur inédite.
Des affaires comme l’homicide du jeune Thomas à Crépol auraient, il y a trente ans, eu un écho limité. Aujourd’hui, elles envahissent l’espace public, alimentant l’émotion collective et renforçant la perception d’une insécurité omniprésente.
Un paradoxe historique
Sur le plan strictement statistique, le taux d’homicides en France pour 100 000 habitants a été divisé par deux entre 1993 et 2023.
Il est aujourd’hui bien moins dangereux de vivre en France qu’en 1946.
Cependant, l’époque contemporaine n’accepte plus ce que l’obscurité médiatique d’hier dissimulait.
La tolérance collective aux atteintes aux personnes a chuté, portée par une exigence croissante de justice, de transparence et de protection.
L’injustice, ferment du malaise sécuritaire
Le véritable moteur du sentiment d’insécurité n’est plus seulement la délinquance en elle-même, mais l’impression d’impunité et la dislocation de la chaîne pénale.
Les Français n’acceptent plus que policiers et gendarmes interpellent des délinquants pour que, trop souvent, la justice ne suive pas avec la rigueur attendue.
Restaurer la confiance passe par une réponse judiciaire rapide, ferme et équitable, sans distinction de classe sociale ou d’origine.
Le ministère de la Justice, plus encore que celui de l’Intérieur, détient aujourd’hui la clé pour inverser cette spirale du doute et de la défiance.