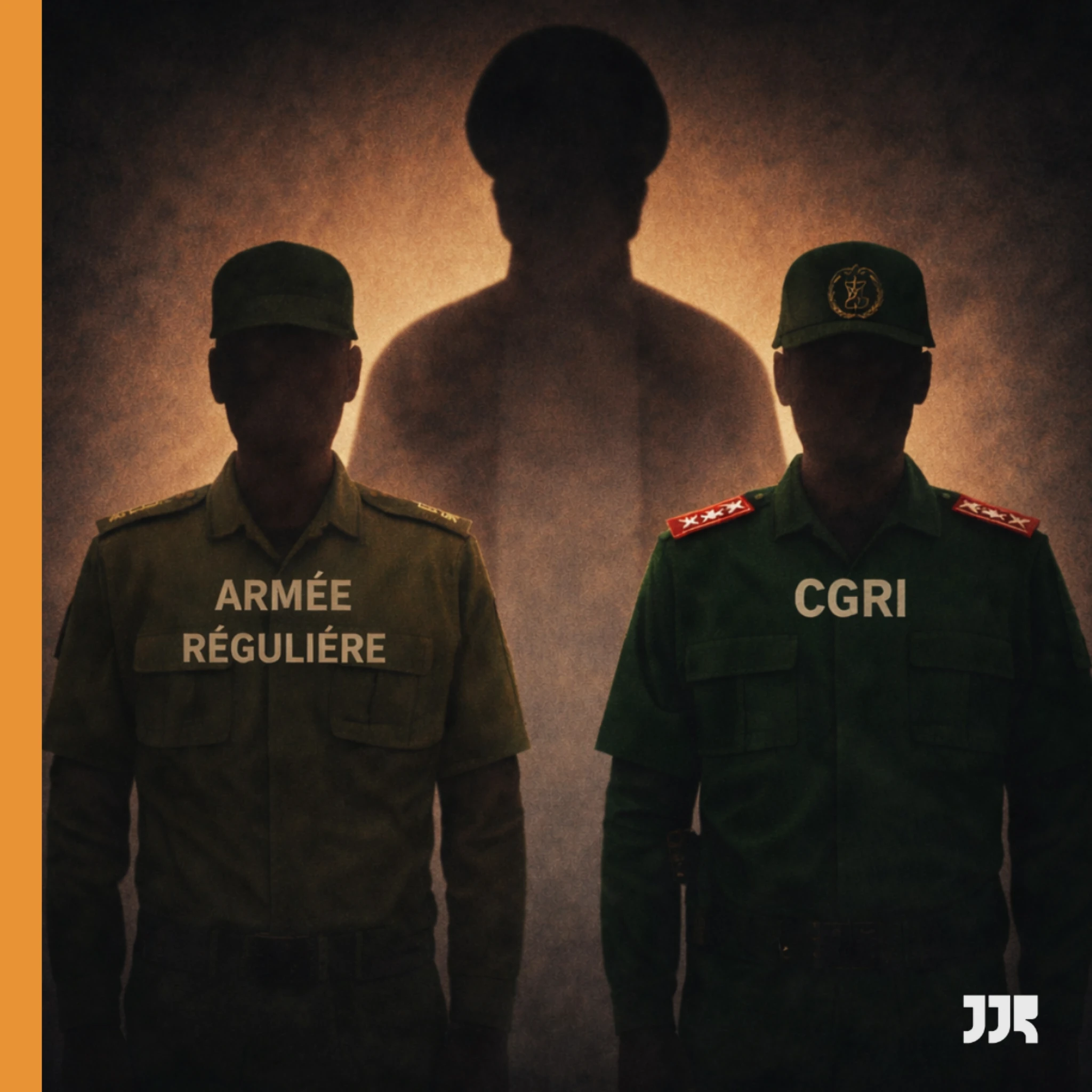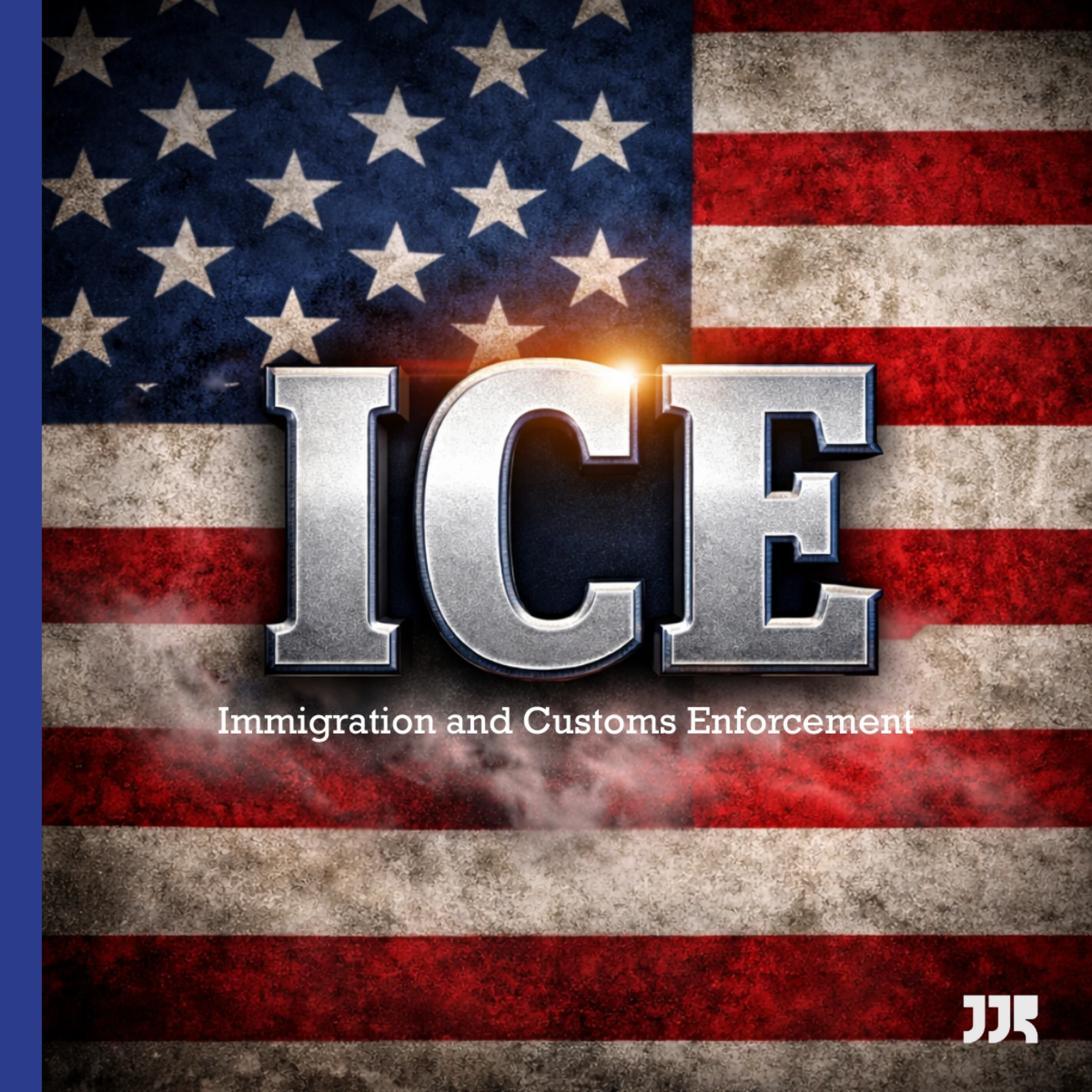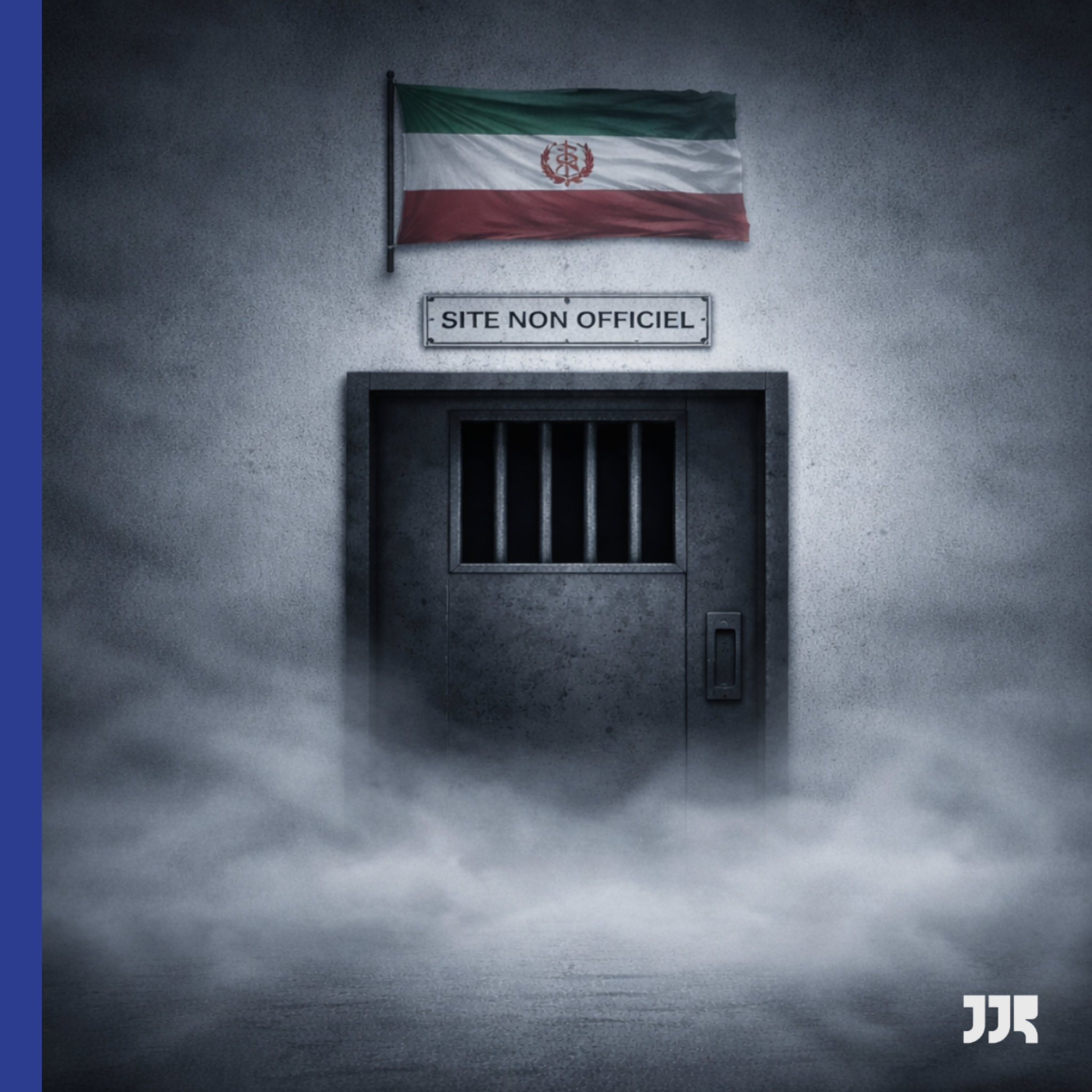Siffler. Suivre. Commenter le corps d’une inconnue.
Ce n’est pas un flirt. Ce n’est pas un malentendu.
C’est une pression. Une intrusion. Une domination banalisée.
Une violence quotidienne largement invisibilisée
En 2024, plus de 80 % des femmes déclarent avoir été victimes de harcèlement dans l’espace public, selon le Baromètre sexisme 2024.
Pourtant, seuls 5 % de ces faits donnent lieu à une plainte.
Ce décalage traduit un phénomène insidieux.
On doute. On minimise. On s’habitue.
La peur se glisse dans le quotidien, silencieuse, jusqu’à devenir une composante ordinaire de la vie publique.
Des mots qui blessent autant que des actes
Le harcèlement de rue n’est pas « juste des mots ».
C’est une insécurité globale : physique, mentale, sociale.
C’est l’impossibilité de marcher librement.
C’est l’angoisse de changer de trottoir.
C’est le besoin instinctif de surveiller ses arrières, de raccourcir son trajet, d’éviter certains regards.
Chaque sifflement, chaque remarque, chaque pas de trop est une atteinte à la liberté.
Une banalisation qui empêche l’action
Banaliser le harcèlement de rue, c’est valider la domination dans l’espace public.
C’est accepter que certaines voix comptent moins que d’autres.
C’est renoncer, en silence, à l’égalité fondamentale entre les individus.
Rompre ce cercle vicieux impose de reconnaître pleinement la gravité de ces agressions.
Et d’agir avec détermination pour restaurer un droit élémentaire : celui d’exister dans l’espace public sans peur.