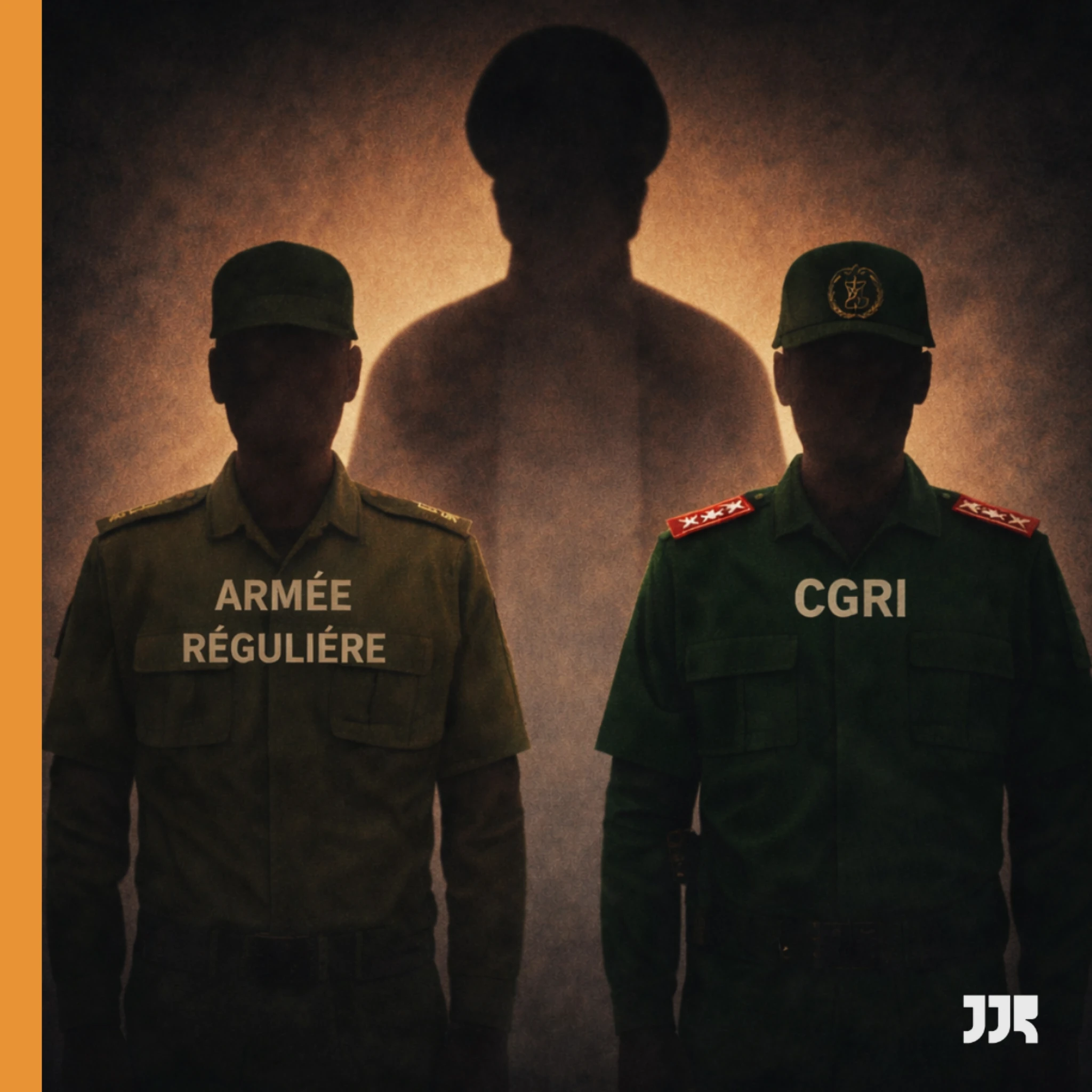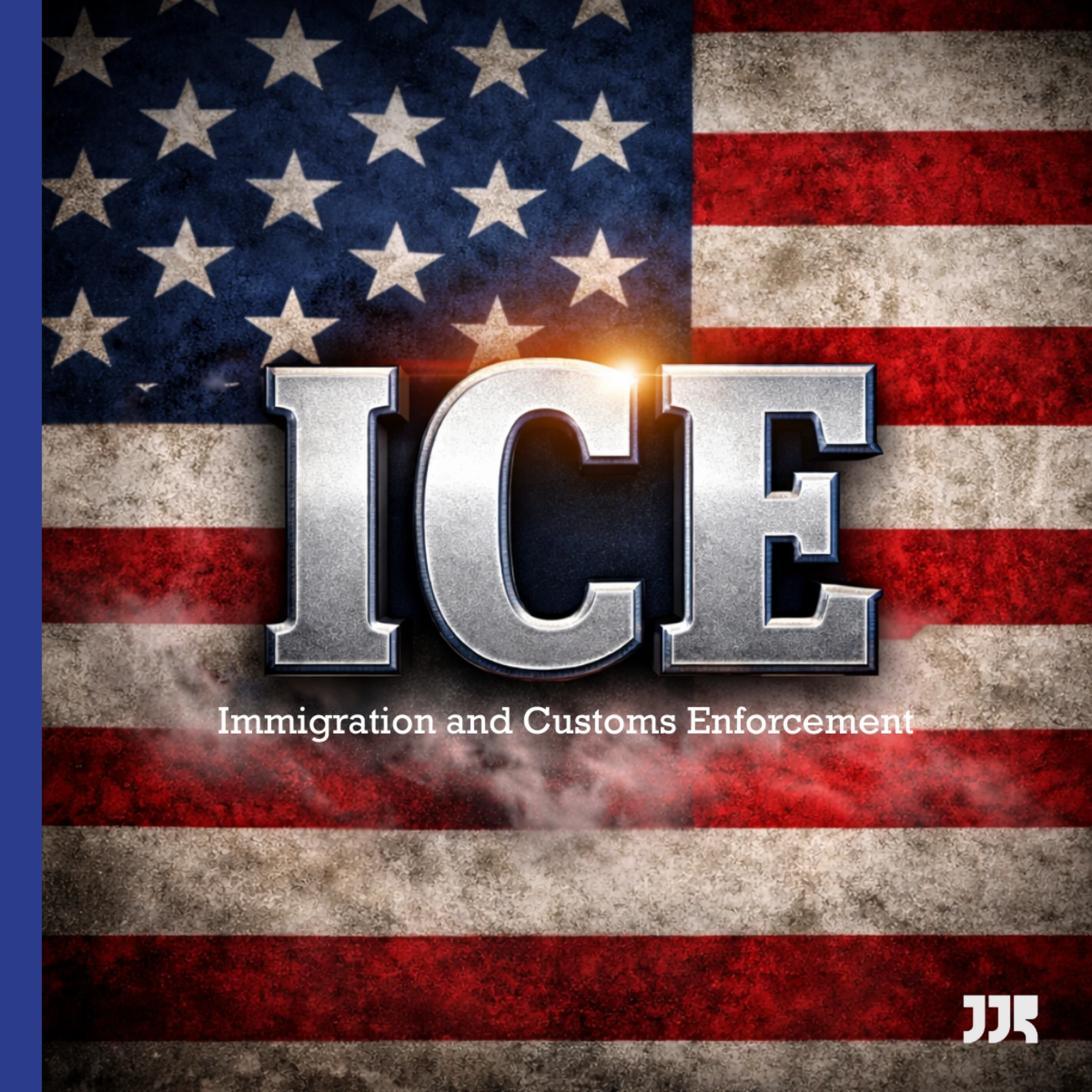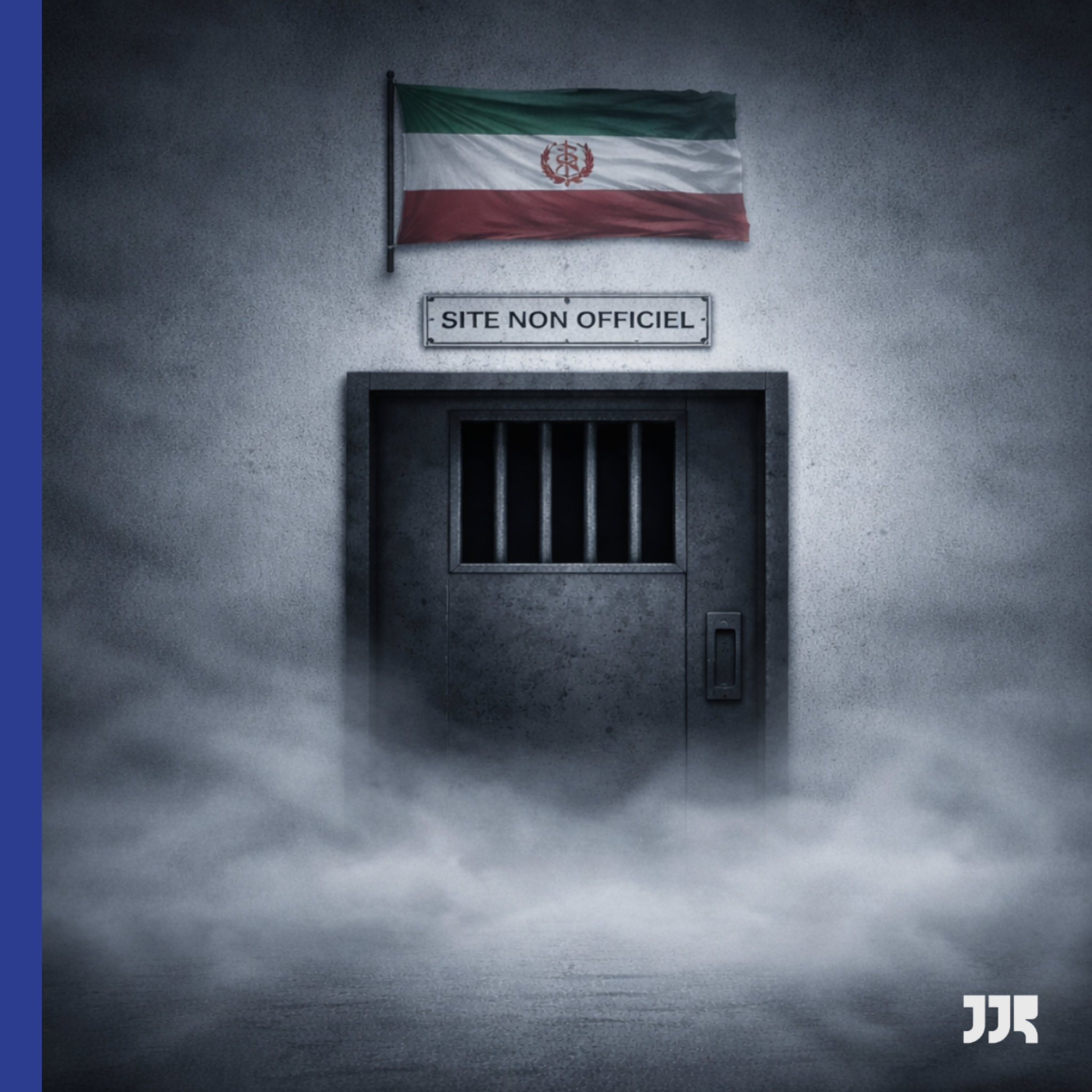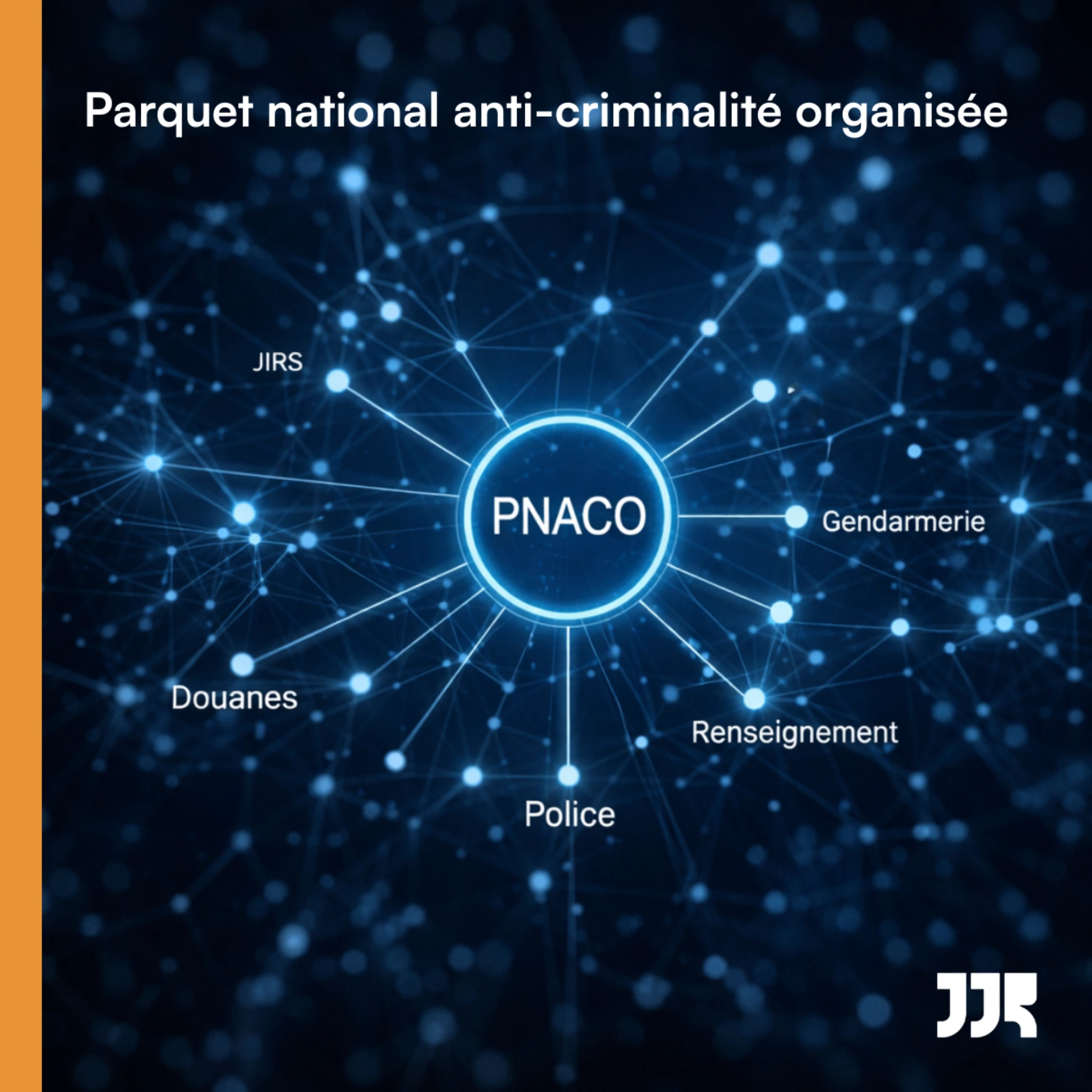Elle ne fait pas de bruit. Elle n’a pas toujours de cause précise. Mais elle s’installe. Peu à peu et de manière silencieuse. Le sentiment d’insécurité s’insinue dans les gestes simples, comme choisir un siège dans une rame de métro, éviter une rue, garder la main en permanence sur son sac. Ce sentiment d’insécurité est sourd, surtout quand personne ne veut l’entendre.
Une peur floue, mais ancrée
On la dit subjective et elle l’est. Et pourtant, elle dicte souvent bien plus que les chiffres ne le laissent croire. Dans une allée sombre ou un train vide, elle surgit sans prévenir. Pas besoin d’un événement pour la justifier. Elle suffit à elle-même. Elle fonctionne à l’image, au souvenir, à l’instinct.
Ce n’est pas de la paranoïa, mais une réaction humaine qui est trop souvent dénigrée. On la classe dans les “ressentis”. Comme si ça la rendait moins légitime.
Trop d’info tue la perception
Avant, ce qui arrivait à l’autre bout du pays restait une rumeur vague. Aujourd’hui, c’est dans notre poche de manière instantanée et de la manière la plus brute qui soit. Chaque fait divers devient universel. Chaque vidéo violente amplifie l’angoisse. Ce n’est plus la rareté qui inquiète, c’est la répétition.
Et quand tout semble violent, même l’exception paraît la norme. L’insécurité n’a plus besoin d’être réelle pour peser. Elle est omniprésente dans l’esprit de beaucoup.
Un thermomètre que l’on refuse de lire
On aime les chiffres, car ils rassurent et ordonnent. Mais ils ne disent rien de ce qui se passe à l’intérieur. Car le sentiment d’insécurité ne se range pas dans un tableau. Il est irrégulier, mouvant, personnel. Il dépend d’un vécu. D’un trajet. D’un âge, d’un genre, de détails qui ne sont pas classifiables. Et ça, les chiffres ne savent pas le lire.
Alors, certains méprisent ce sentiment intangible. On le traite comme un caprice ou une peur irrationnelle. Mais une telle approche est une erreur grave, car ce sentiment oriente les choix de vie. Il fait voter, fuir, renoncer. Il agit en profondeur et très souvent dans le silence le plus total.
Ce n’est pas une affaire de statistiques
Une femme qui change de trottoir n’a pas besoin d’un graphique pour savoir pourquoi elle le fait. Un père qui ne laisse plus ses enfants aller seuls à l’école non plus. L’insécurité perçue ne se débat pas, mais se ressent. Et elle parle d’un malaise plus large qui est celui d’une société qui ne sait plus rassurer. Qui a perdu le fil du commun. Et qui, trop souvent, ne croit plus ce que ses citoyens vivent intérieurement.
Entendre sans juger
Pour lutter contre le sentiment d’insécurité, il ne suffit pas de répondre avec des chiffres. Il faut entendre ce qui se dit à voix basse. Ce “je n’ai rien vécu, mais j’ai peur”. Ce “je sais que ça n’arrive pas partout, mais je ne suis pas tranquille”. Ces phrases-là, si on continue à les ignorer, on finira par en payer le prix, et ce, de manière collective.
Cet article est issu des réflexions développées dans mon livre Insécurité en France : On n’est pas sorti de l’auberge !, disponible en librairie et sur les plateformes en ligne. Un ouvrage pour comprendre en profondeur les racines, les mutations et les enjeux de l’insécurité aujourd’hui.