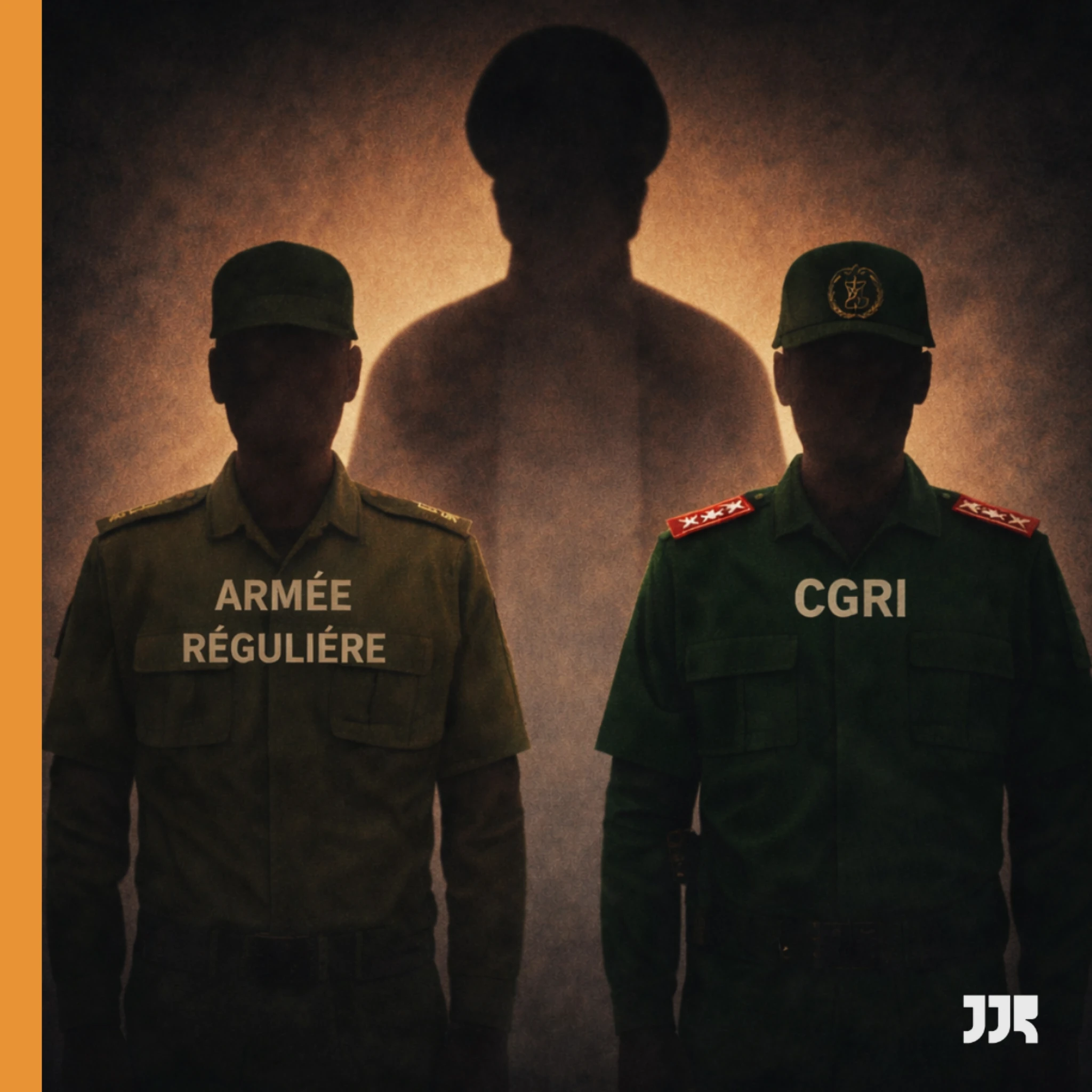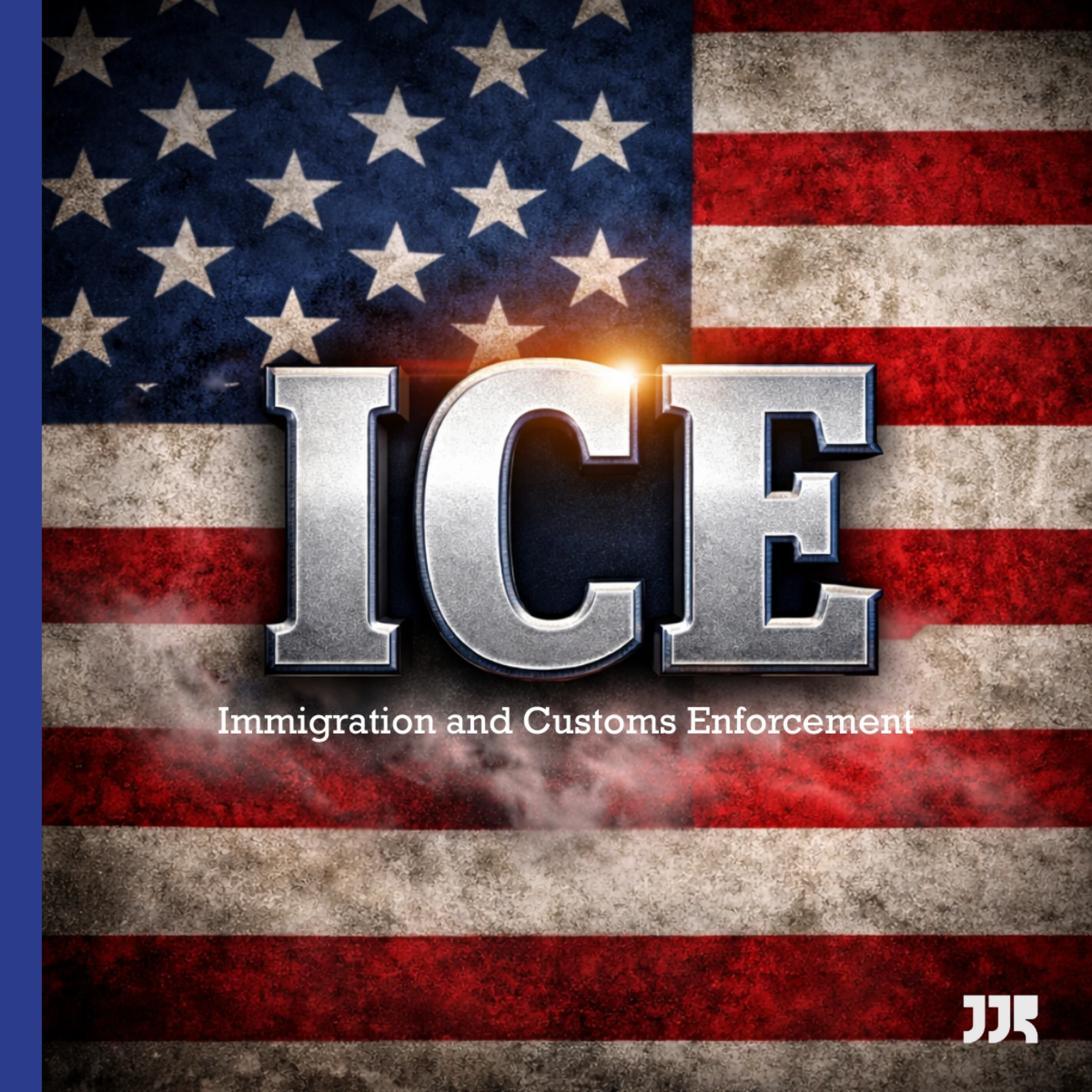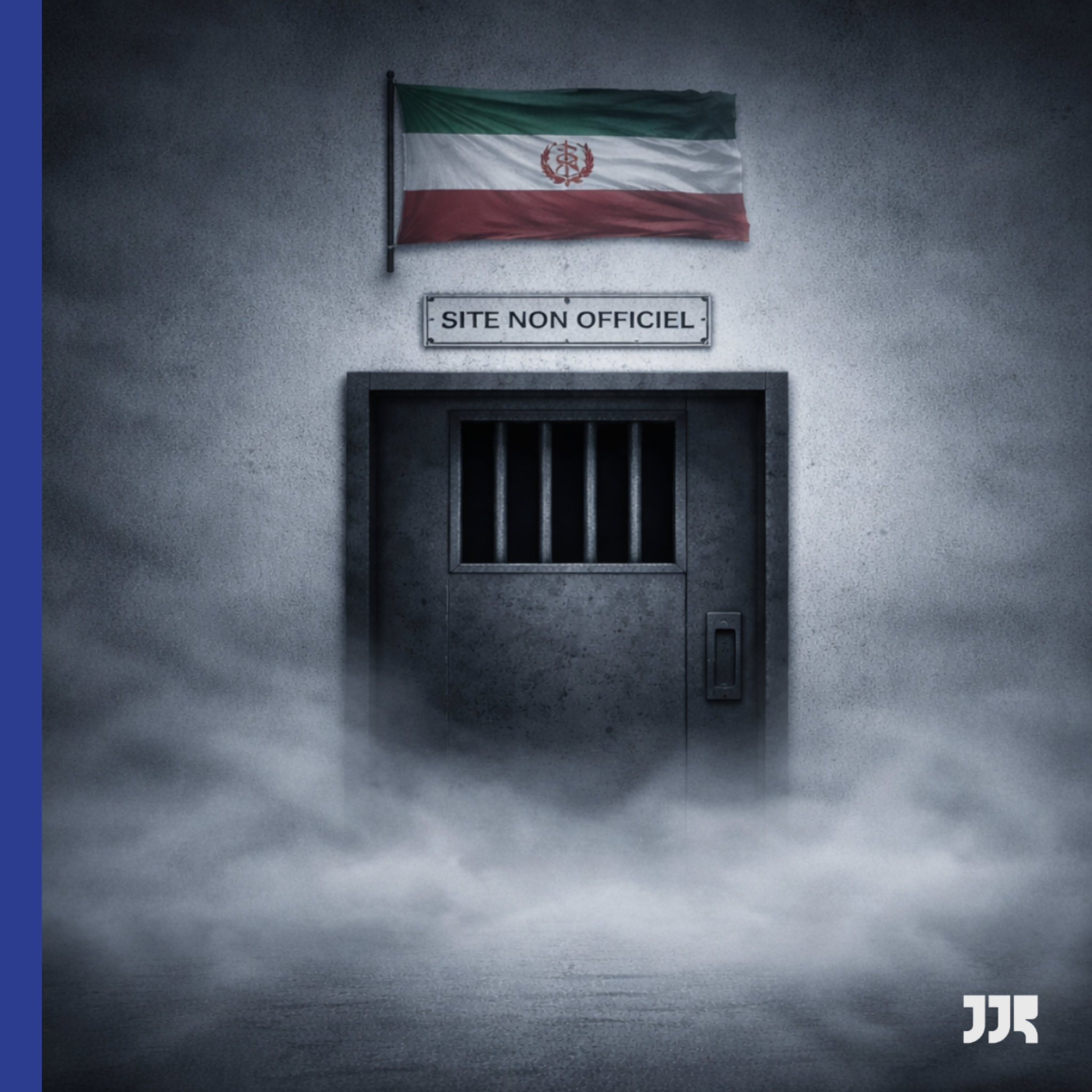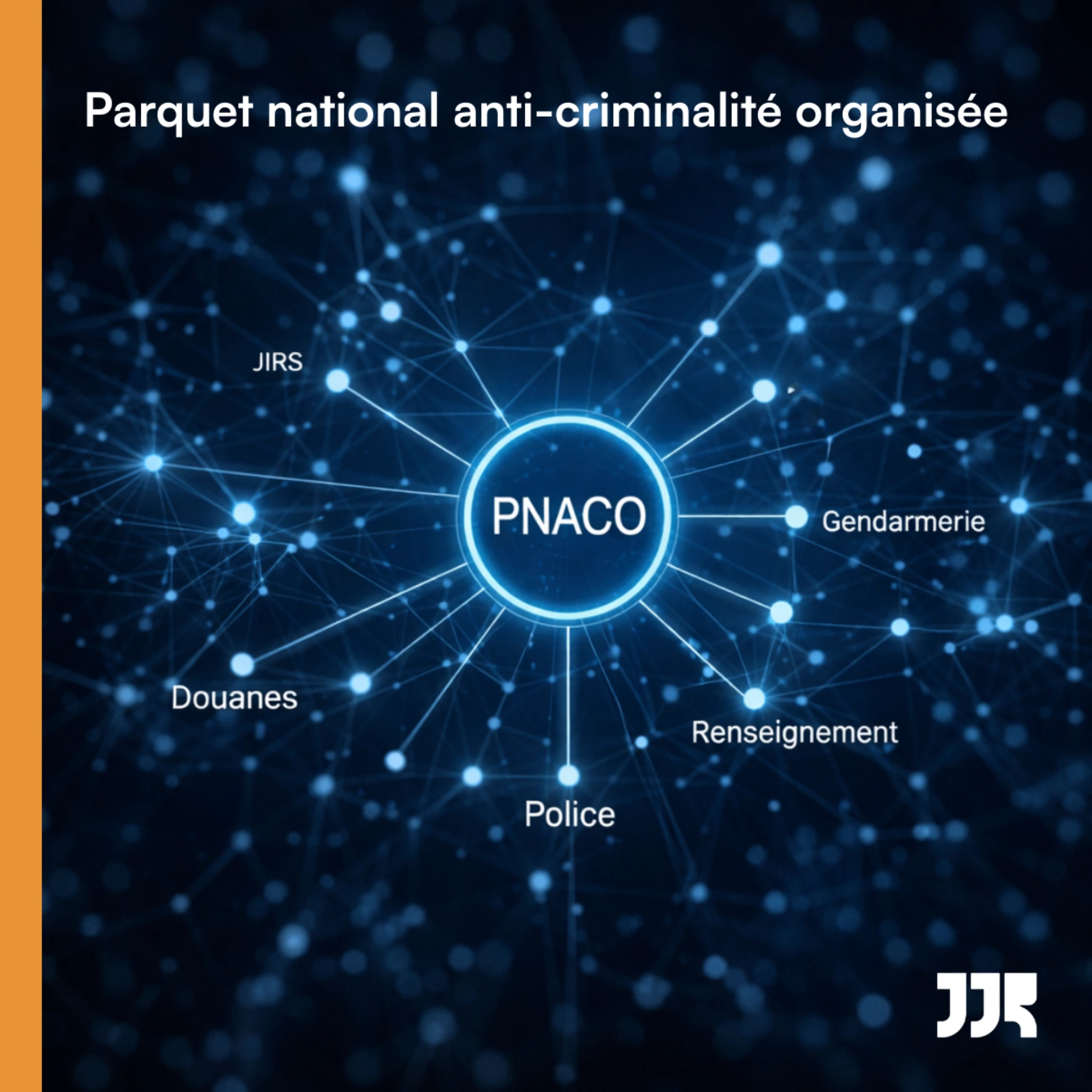Face aux crises, certains improvisent, d’autres fuient et rares sont ceux qui réparent. Et pourtant, c’est bien cette dernière voie la plus exigeante qui trace l’unique ligne de flottaison viable dans un monde sous pression.
L’illusion des réparations d’urgence
Quand un navire prend l’eau, le réflexe est immédiat à savoir boucher les brèches. On rafistole, on écoperait presque avec les mains. Dans ce cas, l’urgence dicte la manœuvre. On sauve ce qui peut l’être. Mais on sait aussi, au fond, que ça ne tiendra pas bien longtemps. C’est du court terme pur ou plus exactement de la survie maquillée en décision.
Transposé à la conduite de l’État, cela donne ces politiques à la petite semaine avec des budgets recousus à coups d’amendements tardifs, de lois votées dans la précipitation ou de communication de crise érigée en stratégie de fond. Mais, ce n’est pas cela gouverner. Ce n’est que du bricolage permettant de rester à flot en espérant que la mer reste calme.
Quitter le navire, fuir la tempête
Une deuxième option est de tout abandonner. Jeter les plans, saborder l’existant et promettre un nouveau départ. Sur le papier, cela sonne presque héroïque. En réalité, c’est souvent un aveu d’échec. Construire autre chose, plus robuste, plus moderne ? Peut-être. Mais avec quels moyens ? Quel temps ? Et quelle garantie que ce nouveau bateau ne prendra pas l’eau à son tour ?
Les discours qui annoncent des réformes totales sans jamais en assumer les coûts ni les délais relèvent plus de l’incantation que de la transformation. On oublie que l’équipage c’est-à-dire nous tous restons à bord, vulnérable aux manœuvres improvisées.
Préparer, c’est assumer la responsabilité
Il existe une troisième voie. Elle n’a rien de spectaculaire. Pas d’effets d’annonce. Pas de promesse de lendemain chantant. Juste une exigence froide celle de réparer et de revoir chaque pièce du navire, de tester sa résistance, de retarder le départ s’il le faut. Cela demande du temps. Et du courage. Celui d’assumer que l’on n’est pas prêt. Et que l’on doit, méthodiquement, le devenir.
Dans les champs économiques comme en matière de sécurité publique, cette rigueur est la seule option qui tienne. Elle consiste « tout simplement » à ne pas courir après les urgences et de ne pas céder à la panique. Et surtout, ne pas se lancer dans la tempête avec un navire bancal, sous prétexte qu’il est neuf ou joliment repeint.
Le courage, ce n’est pas l’élan. C’est la discipline.
Il faudra bien, tôt ou tard, cesser de confondre vitesse et précipitation. Arrêter d’applaudir ceux qui foncent sans cap, au nom d’un prétendu volontarisme. Le courage politique, le vrai, commence dans le doute. Il se forge dans la préparation. Il se prouve dans la capacité à dire non à l’improvisation.
Un pays ne traverse pas les crises à l’instinct. Il les traverse parce qu’il s’est donné les moyens d’y faire face. Les dirigeants qui refusent de voir cela n’échouent pas seulement. Ils compromettent l’équipage tout entier.
Et il se pourrait que la tempête, elle, n’attende plus très longtemps.