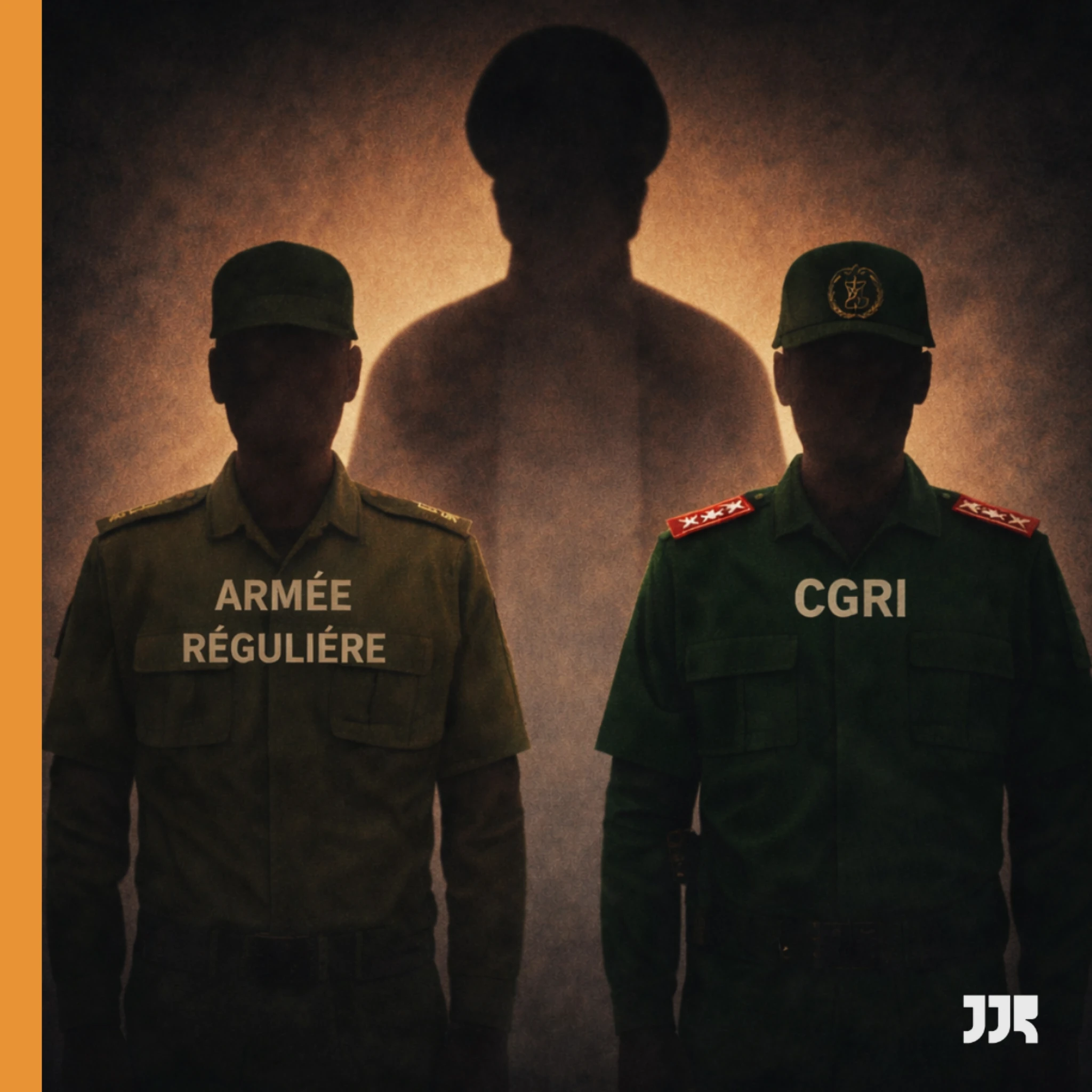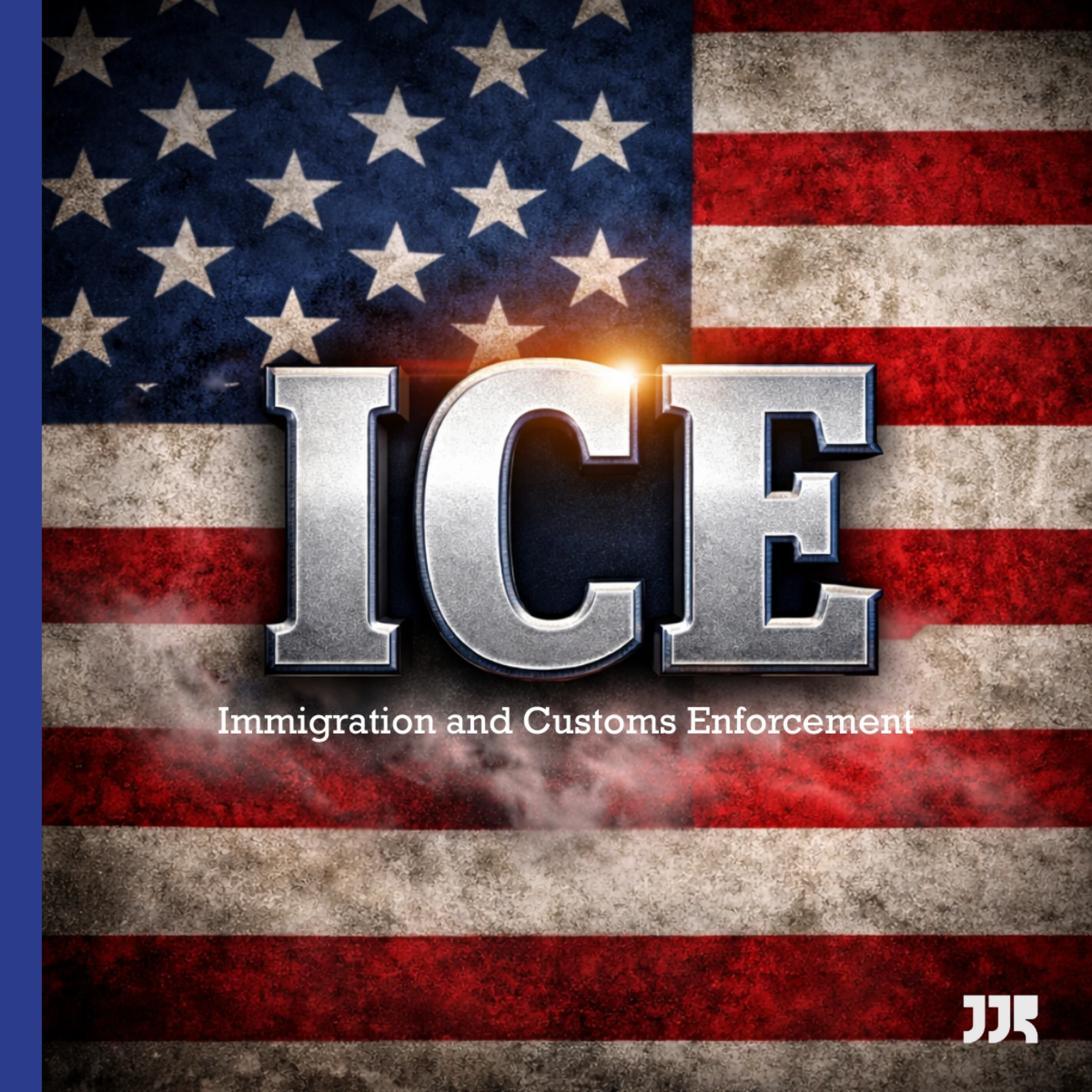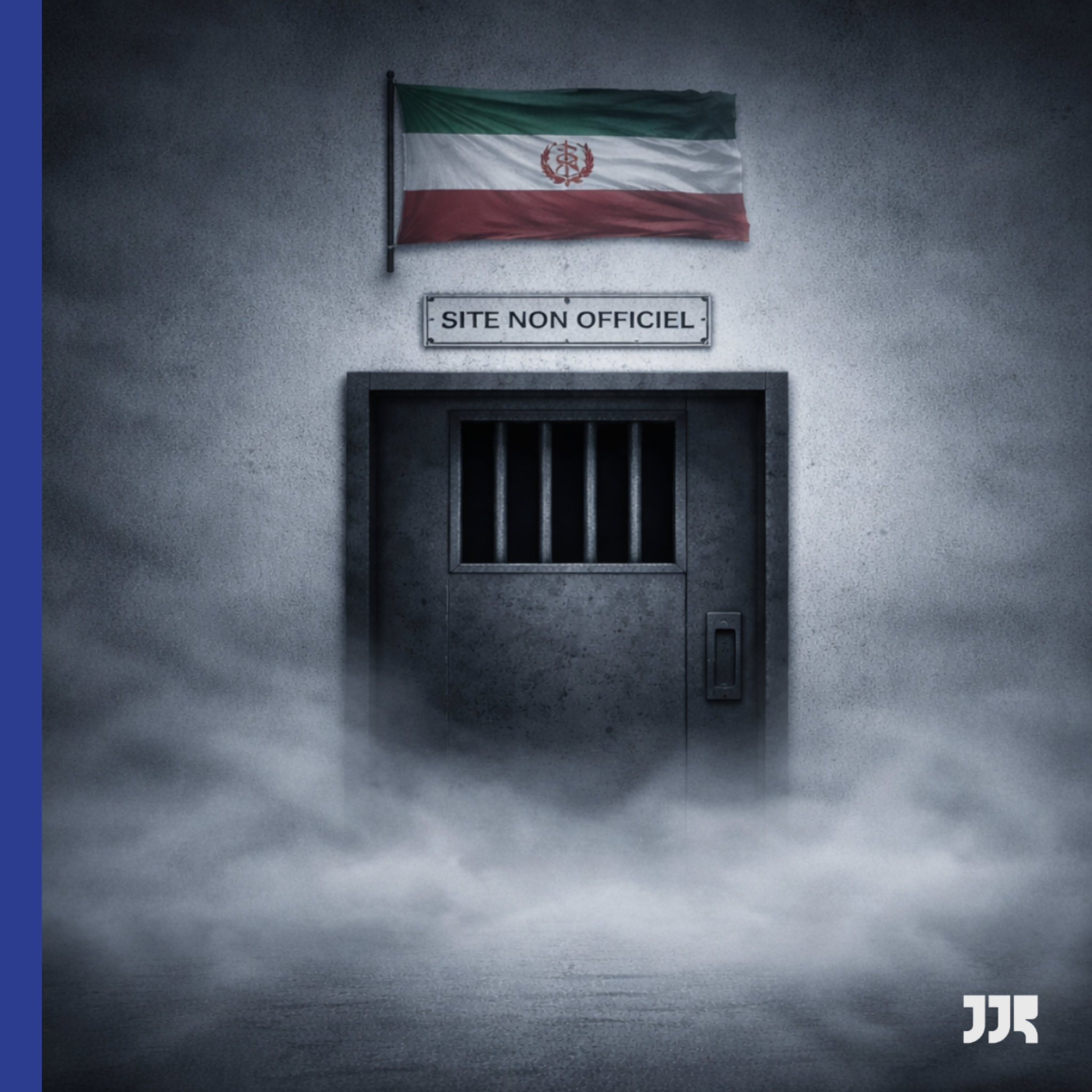Il y a des formules qui claquent, des phrases qui marquent. Et puis il y a celles qui confondent lucidité et sensationnalisme. Récemment (13/05/25), Éric Ciotti a publié sur son compte X une vidéo accompagnée d’un commentaire pour le moins abrupt : « Medellín ? Non, Paris sous Macron ! » Un parallèle aussi tranché que trompeur, qui mérite d’être confronté à la réalité des faits.
Une déclaration qui frappe plus qu’elle n’éclaire
La sortie d’Éric Ciotti intervient dans un contexte marqué par une forte médiatisation des faits divers à Paris. Loin de chercher à comprendre ou à expliquer, cette comparaison repose sur une équivalence implicite : Paris serait devenu, sous l’effet du laxisme politique, une zone de non-droit comparable à l’ex-capitale mondiale du narcotrafic.
Medellín. Le simple nom suffit à évoquer une ville marquée au fer rouge par les cartels, les assassinats ciblés, les enlèvements et la terreur organisée. Dans les années 1980, le taux d’homicides dépassait les 380 pour 100 000 habitants. À l’époque, la ville était aux mains du cartel de Pablo Escobar. Ce contexte historique, largement documenté, n’a rien à voir avec la situation actuelle de Paris, aussi préoccupante soit-elle sur certains plans.
Des chiffres qui remettent les pendules à l’heure
En 2024, la Colombie a enregistré 13 393 homicides, pour une population de 52 millions d’habitants. Le taux national s’établit ainsi à 25,4 pour 100 000. La France, elle, a connu 980 homicides la même année. Rapporté à sa population, le taux est d’environ 1,4 pour 100 000.
Concernant les enlèvements, les données sont moins accessibles. Néanmoins, les rapports des forces de sécurité indiquent environ un enlèvement par jour en Colombie, souvent liés à des groupes armés encore actifs. Au Mexique, la moyenne grimpe à cinq ou six par jour. En France, on recense également un enlèvement quotidien, dans des contextes très différents, majoritairement intrafamiliaux.
Autrement dit : si Paris est le nouveau Medellín, alors un croissant devient l’équivalent d’une empanada.
L’art de détourner l’attention
Ce type de comparaison n’est pas neutre. Elle n’éclaire pas. Elle désigne un coupable, l’État, le président, le système sans proposer autre chose qu’un slogan. L’objectif n’est pas d’informer mais de frapper, d’associer des images fortes pour provoquer une réaction immédiate.
Pourtant, les enjeux de sécurité exigent tout le contraire : de la précision, de la mesure, une lecture rigoureuse des données. Et surtout, une volonté sincère de comprendre les ressorts de la violence et de proposer des réponses cohérentes, durables, humaines.
Une urgence de méthode, pas de rhétorique
La France a ses failles, ses zones de tension, ses drames. Personne ne les nie. Mais elle n’est ni Medellín, ni Tijuana, ni Caracas. Elle est un pays démocratique qui cherche, dans la complexité de son époque, à concilier sécurité et libertés, prévention et répression, autorité et justice.
La tentation de comparer Paris à Medellín n’a rien d’innocent. Elle ne révèle pas une lucidité, mais un abandon du discernement au profit du raccourci. Une façon d’attiser l’émotion sans nourrir le débat. De détourner les citoyens de ce qu’ils attendent réellement : des solutions fondées, claires, applicables.
Ce n’est pas en caricaturant la réalité qu’on la changera. C’est en la regardant en face, avec exigence, mais aussi avec rigueur.