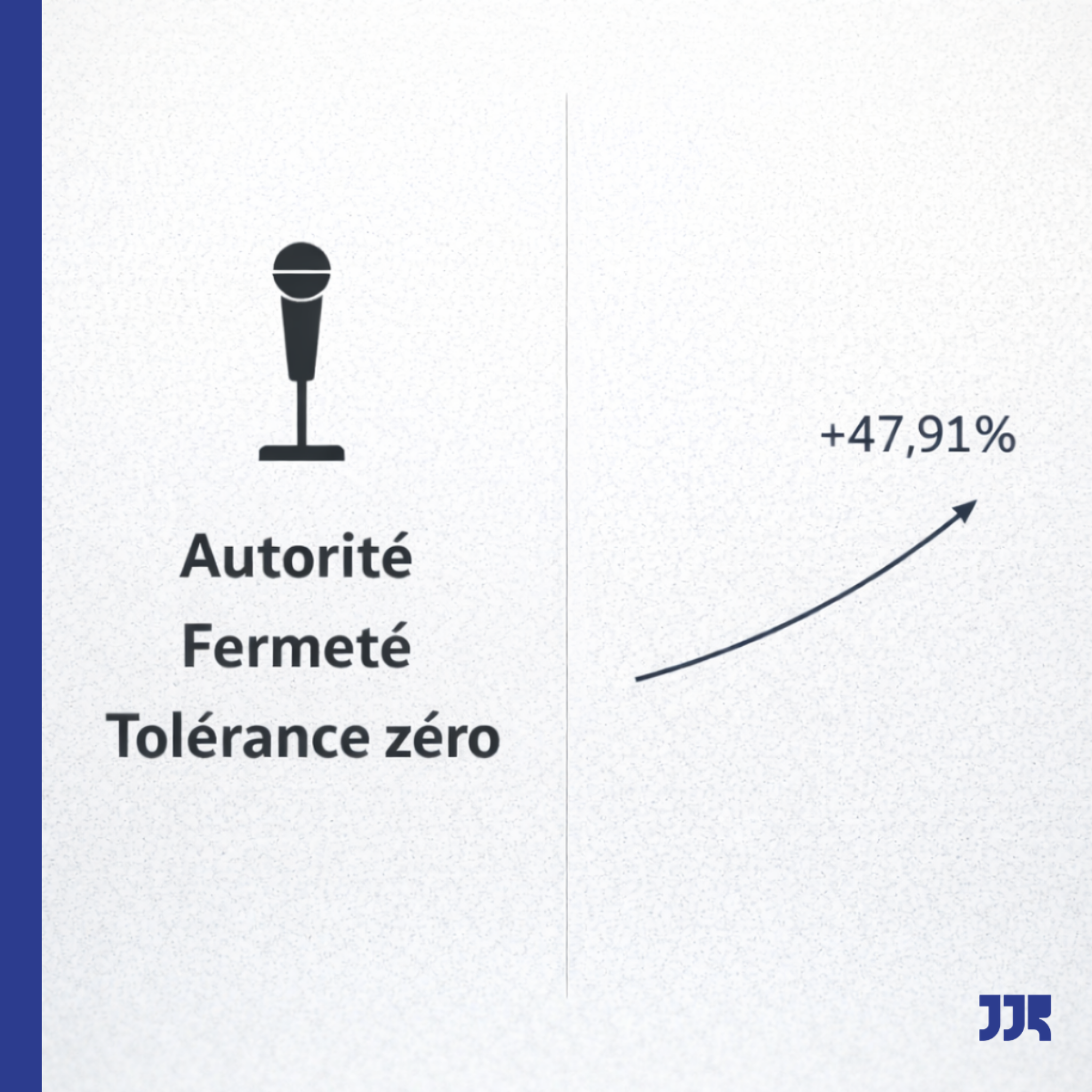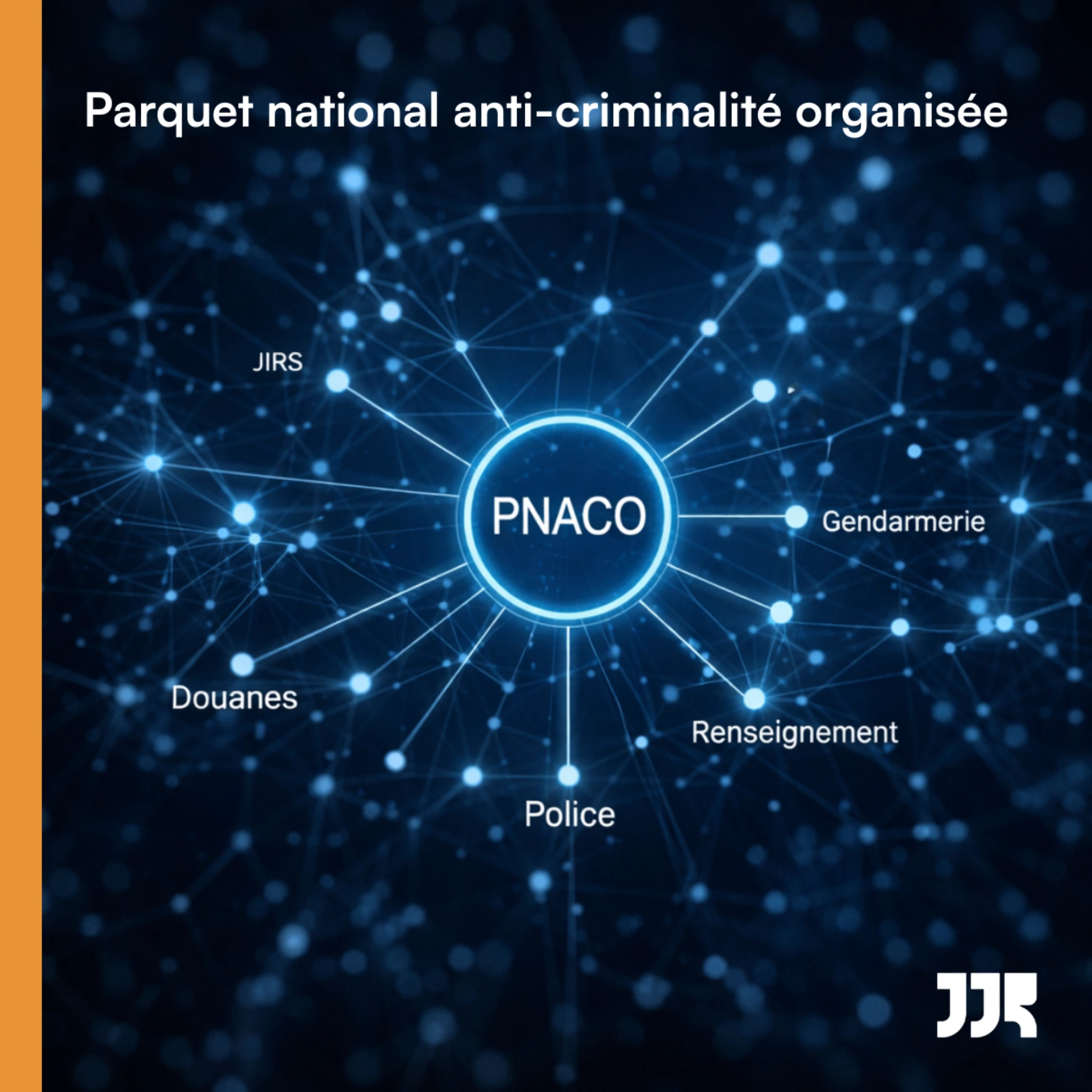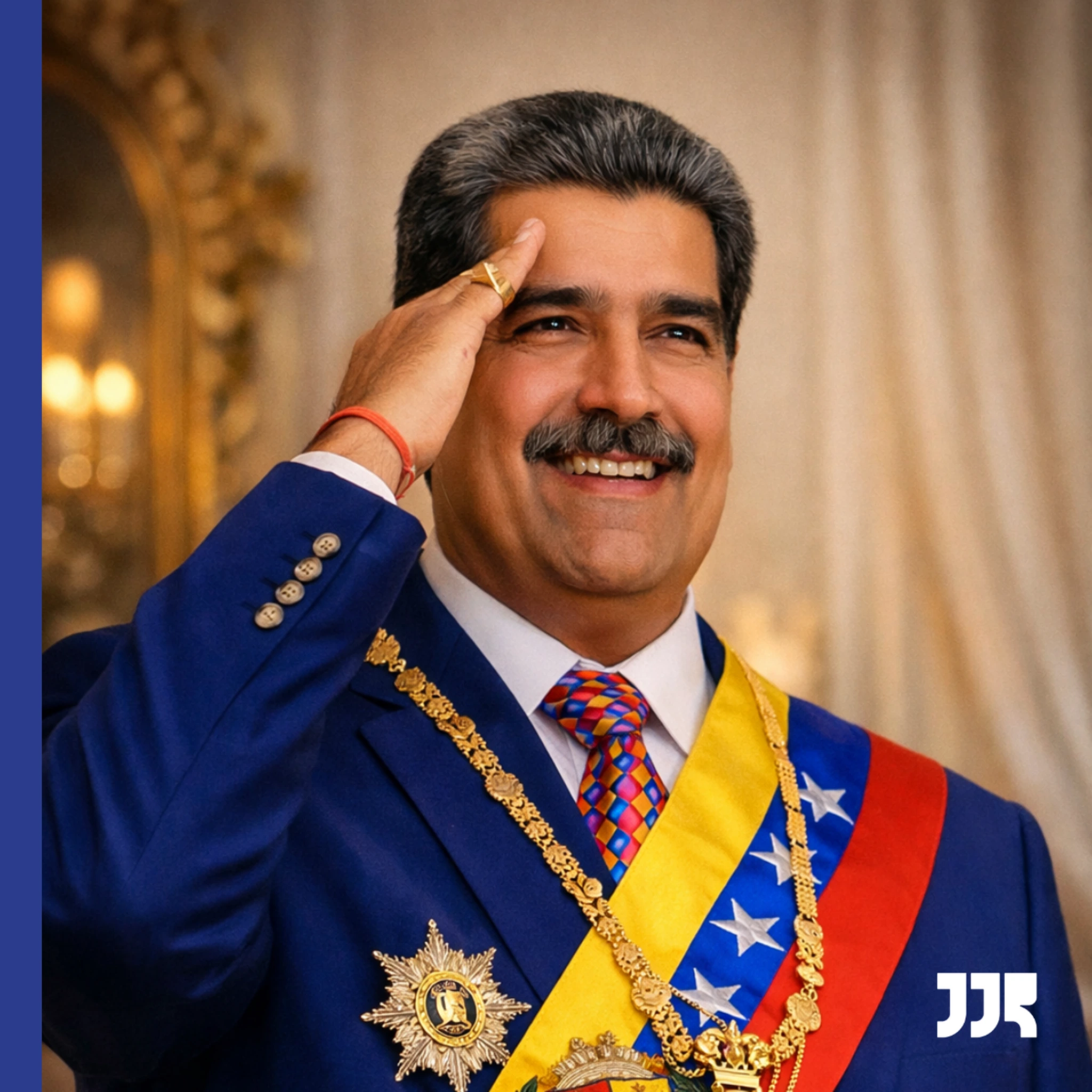Dans les étendues désertiques du Sahel, un nom s’est imposé par la terreur, la patience et l’adaptation : Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI). Héritière des luttes sanglantes des années 1990 en Algérie, cette organisation a su se transformer pour devenir l’un des principaux foyers du djihadisme contemporain.
De la guérilla locale au djihadisme international
AQMI trouve ses racines dans la Guerre civile algérienne. D’abord connu sous le nom de Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC), il naît d’une scission avec le Groupe islamique armé (GIA), marqué par une violence indiscriminée qui avait fini par aliéner la population.
À partir de 2007, le GSPC prête allégeance à Al-Qaïda et devient Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ce changement d’appellation marque une évolution stratégique : AQMI élargit son ambition au-delà de l’Algérie, visant désormais l’ensemble du Maghreb et du Sahel.
Une stratégie d’adaptation au cœur du désert
Contrairement à d’autres mouvements djihadistes, AQMI adopte une stratégie de long terme. L’organisation investit le territoire en profondeur, tissant des liens avec les populations locales, notamment les Touaregs, et exploitant les failles des États sahéliens.
Le désert devient son sanctuaire. AQMI s’y dissimule, s’y renforce et en fait une base arrière pour ses opérations : attaques contre des forces militaires, enlèvements d’Occidentaux, trafics divers. La mobilité et la connaissance du terrain compensent largement le déficit de moyens matériels.
Le djihad économique : prises d’otages et trafics illicites
AQMI a compris très tôt que la survie passe par l’autonomie financière. L’organisation se spécialise dans les enlèvements contre rançon, générant des millions de dollars pour financer ses activités. Elle participe également au trafic de drogues, d’armes et de migrants à travers les routes sahariennes.
Ce pragmatisme économique lui confère une résilience remarquable face aux opérations militaires internationales, en particulier celles menées par la France à travers l’opération Barkhane.
Une influence en recomposition
Depuis l’émergence de groupes plus radicaux, comme l’État islamique dans le Grand Sahara (EIGS), AQMI a vu son autorité contestée. Pourtant, loin de disparaître, elle se repositionne en fédérant plusieurs factions sous la bannière du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), dirigé par Iyad Ag Ghaly.
Aujourd’hui, AQMI ne se contente plus d’un djihad de conquête territoriale. Elle s’inscrit dans une guerre d’usure contre des États fragiles, en s’appuyant sur une stratégie mêlant terrorisme, ancrage communautaire et économie clandestine.