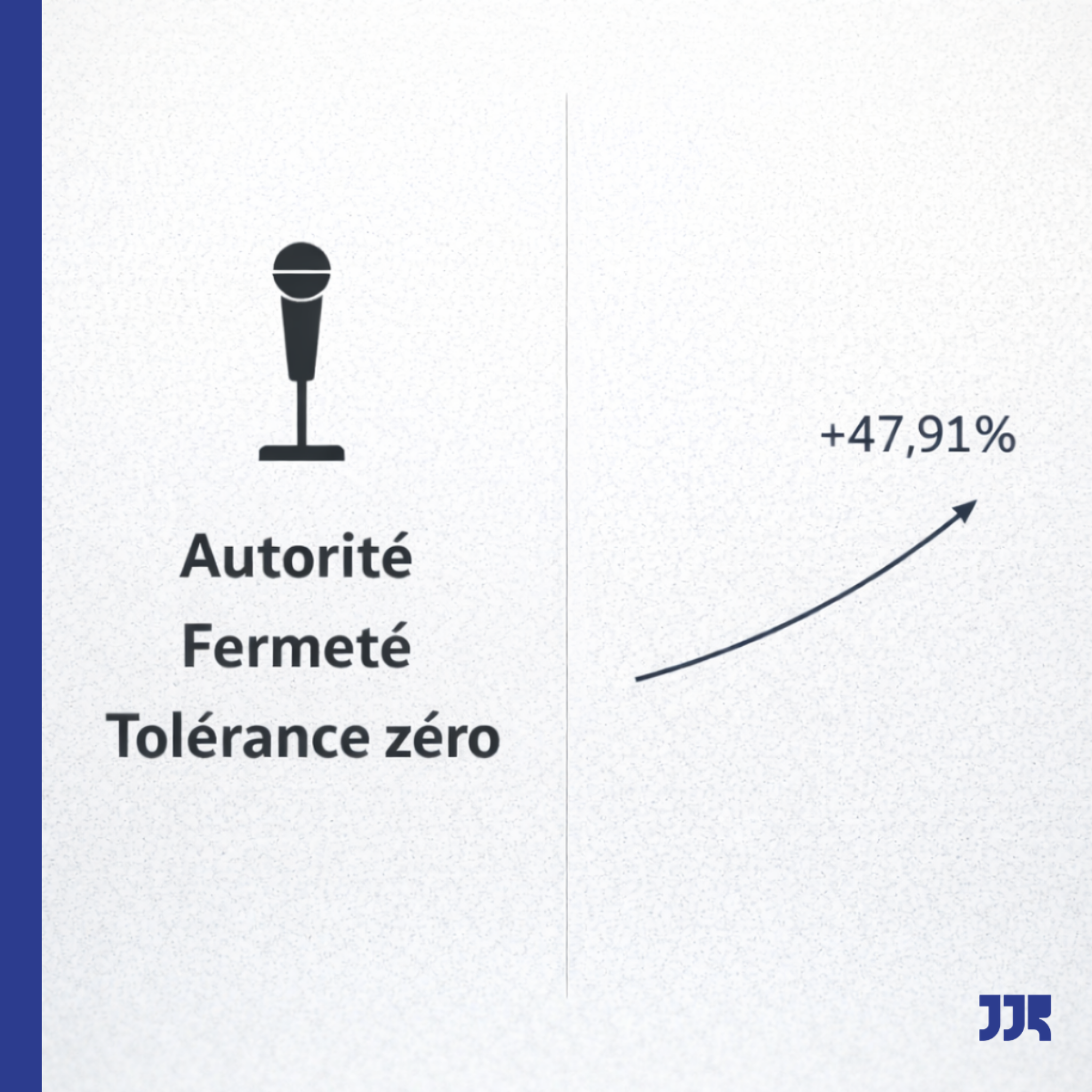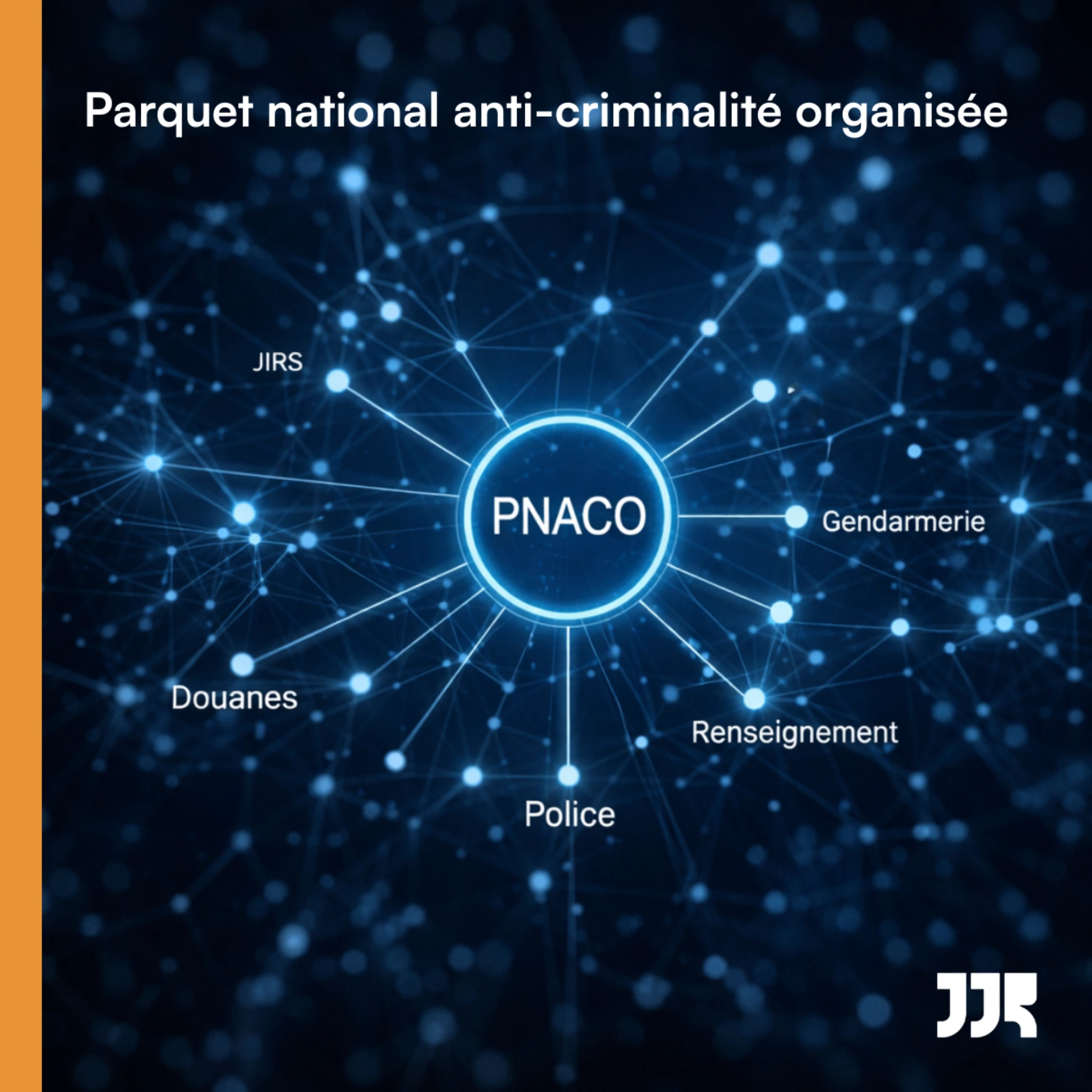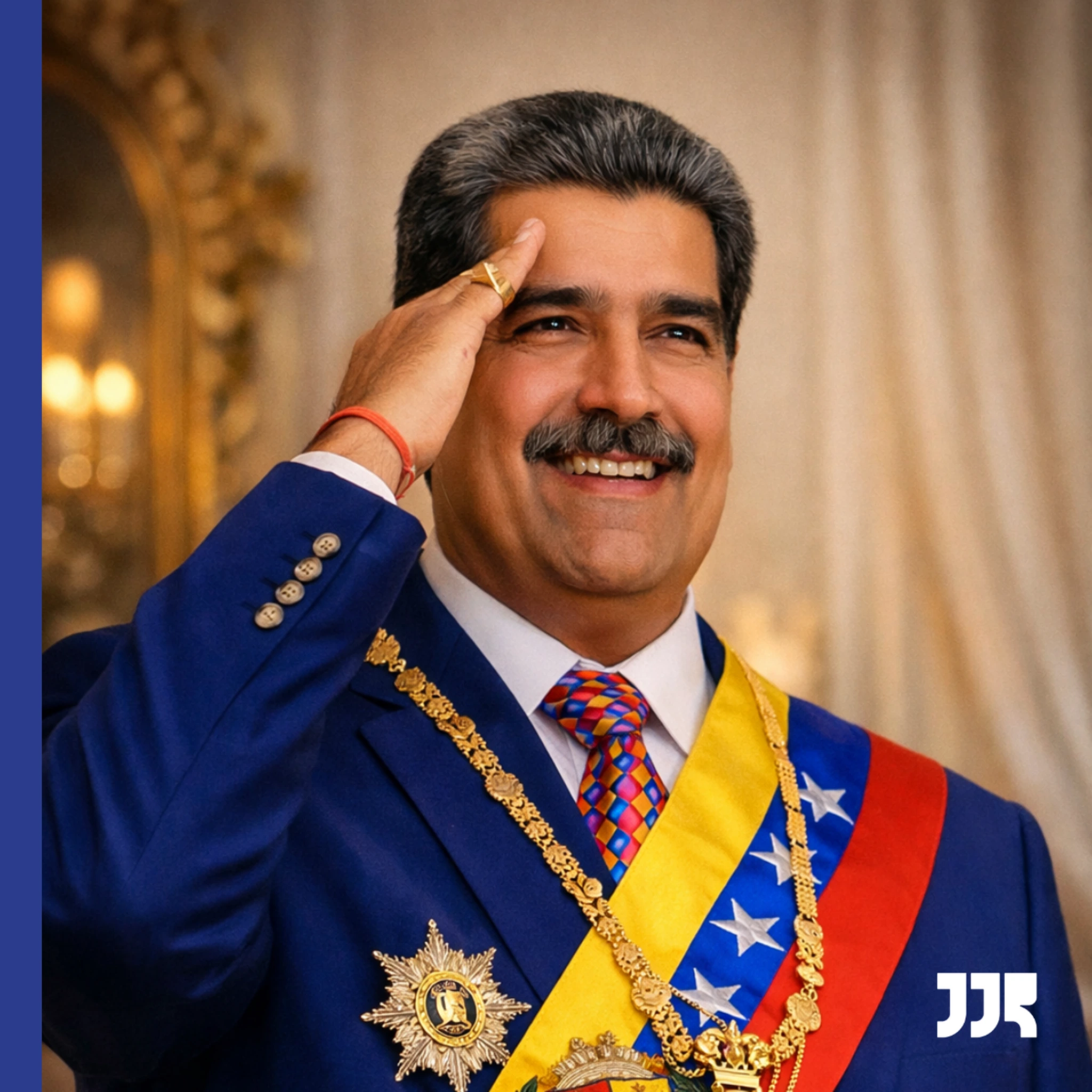La montée de la violence et du crime organisé alimente, en France, des comparaisons de plus en plus fréquentes avec le Mexique. Si certains signes peuvent troubler, les données montrent que les réalités restent, pour l’instant, très différentes. Jusqu’à quand ?
Une comparaison de plus en plus présente dans le débat public
Depuis plusieurs mois, le terme de « mexicanisation » s’invite dans les débats politiques et médiatiques. De plus en plus de responsables, de chroniqueurs et d’experts établissent un parallèle entre la situation sécuritaire de la France et celle du Mexique.
Mais cette analogie résiste-t-elle à l’examen des faits ?
Des signes inquiétants… mais encore éloignés de la réalité mexicaine
Certains éléments peuvent, à première vue, nourrir la comparaison. Les armes de guerre – notamment les Kalachnikovs – circulent désormais dans plusieurs grandes villes françaises. Les règlements de comptes se multiplient. Le trafic de stupéfiants s’affiche de plus en plus ouvertement. Et des groupes criminels, solidement organisés, semblent prêts à tout pour contrôler des pans entiers de territoires urbains.
Cependant, un regard objectif sur les chiffres invite à nuancer fortement ce constat.
Des écarts statistiques majeurs entre la France et le Mexique
En 2023, le Mexique enregistrait un taux de 23,3 homicides pour 100 000 habitants. En France, ce taux s’établissait à 1,3. Un écart considérable.
Autre donnée marquante : contrairement au Mexique, aucune fosse commune liée à des règlements de comptes n’a été découverte sur le territoire français.
Une violence qui évolue, des territoires sous pression
Malgré ces différences, la situation en France évolue dans un sens préoccupant. Mois après mois, de nouveaux quartiers basculent dans une forme d’insécurité chronique. Les tirs d’armes automatiques y deviennent plus fréquents. Les habitants, eux, vivent dans une tension permanente, redoutant de devenir les victimes collatérales d’un affrontement qu’ils ne contrôlent pas.
Des forces locales en première ligne
Dans ces territoires fragilisés, les forces de l’ordre, les élus de proximité et les associations de terrain jouent un rôle essentiel. Leur engagement quotidien permet encore de contenir l’effondrement de certains quartiers. Mais cette résistance est-elle tenable sans renforts ?
Légalisation des drogues : un faux remède ?
À l’étranger, certains pays testent des approches radicales. En Colombie, la légalisation de toutes les drogues est envisagée comme réponse à l’échec des politiques répressives. En France, certains suggèrent de légaliser le cannabis, prétendant qu’il ne serait pas plus dangereux qu’un verre de vin.
Une banalisation qui ignore les conséquences. Une telle mesure aggraverait les tensions dans les quartiers, renforcerait la désorganisation familiale, et affaiblirait encore l’État dans sa mission régalienne de protection.
Lutter ou contourner : un choix stratégique
Deux voies se présentent : contourner l’obstacle ou l’affronter de face. Seule la seconde permettrait d’inverser la tendance. Mais elle exige du courage politique, des ressources conséquentes, et surtout, une réforme profonde des finances publiques.
Des choix impopulaires, mais indispensables
Mener une lutte efficace contre le crime organisé suppose des décisions difficiles. Or, dans l’histoire récente, popularité politique et efficacité sécuritaire n’ont que rarement fait bon ménage.
Sans changement rapide, la France pourrait glisser, lentement mais sûrement, vers une situation de perte de contrôle.
Il est encore temps d’agir
Le temps presse. Mais il est encore possible de reprendre la main. À condition d’ouvrir les yeux collectivement, et d’engager les moyens nécessaires. La sécurité n’est pas une option. C’est un fondement.