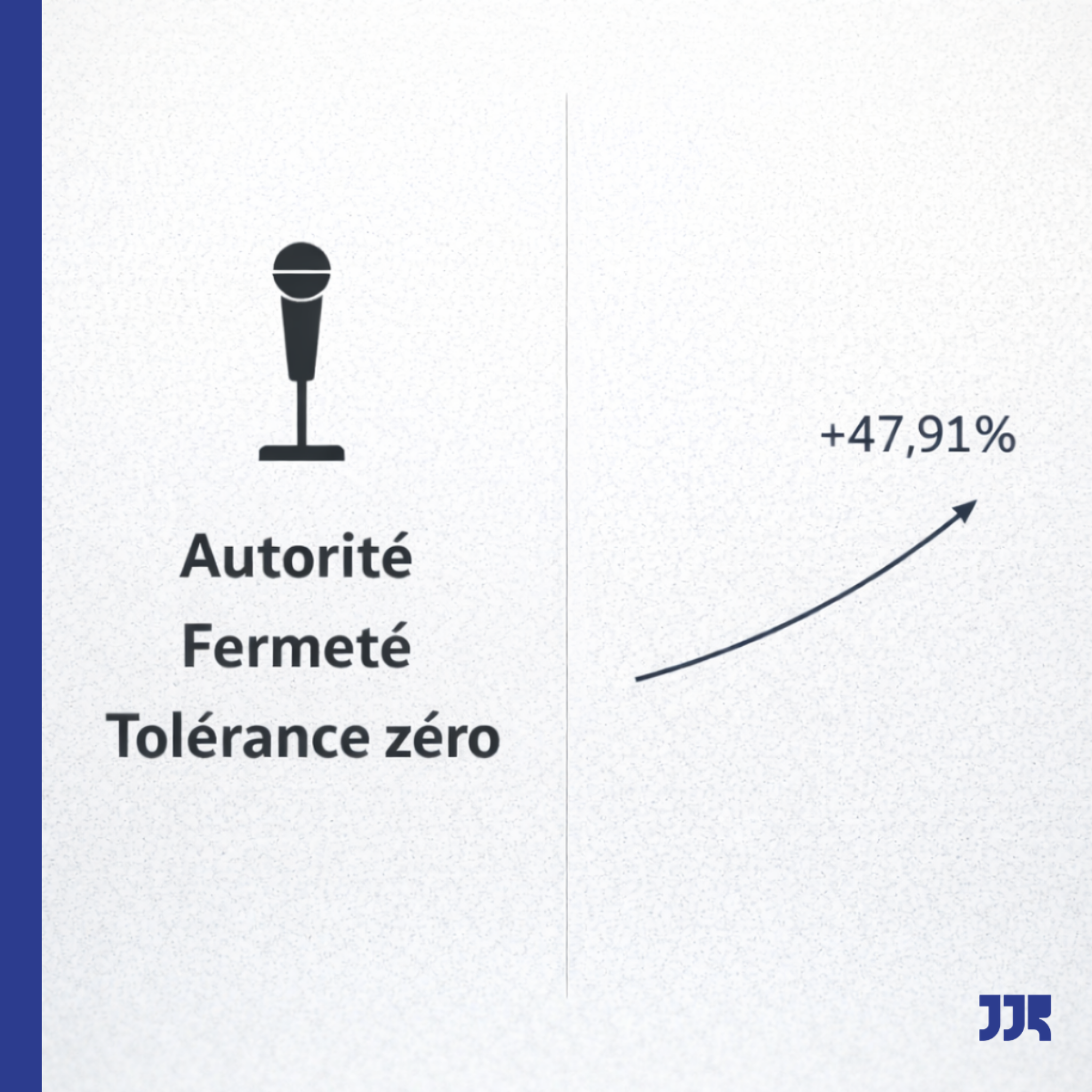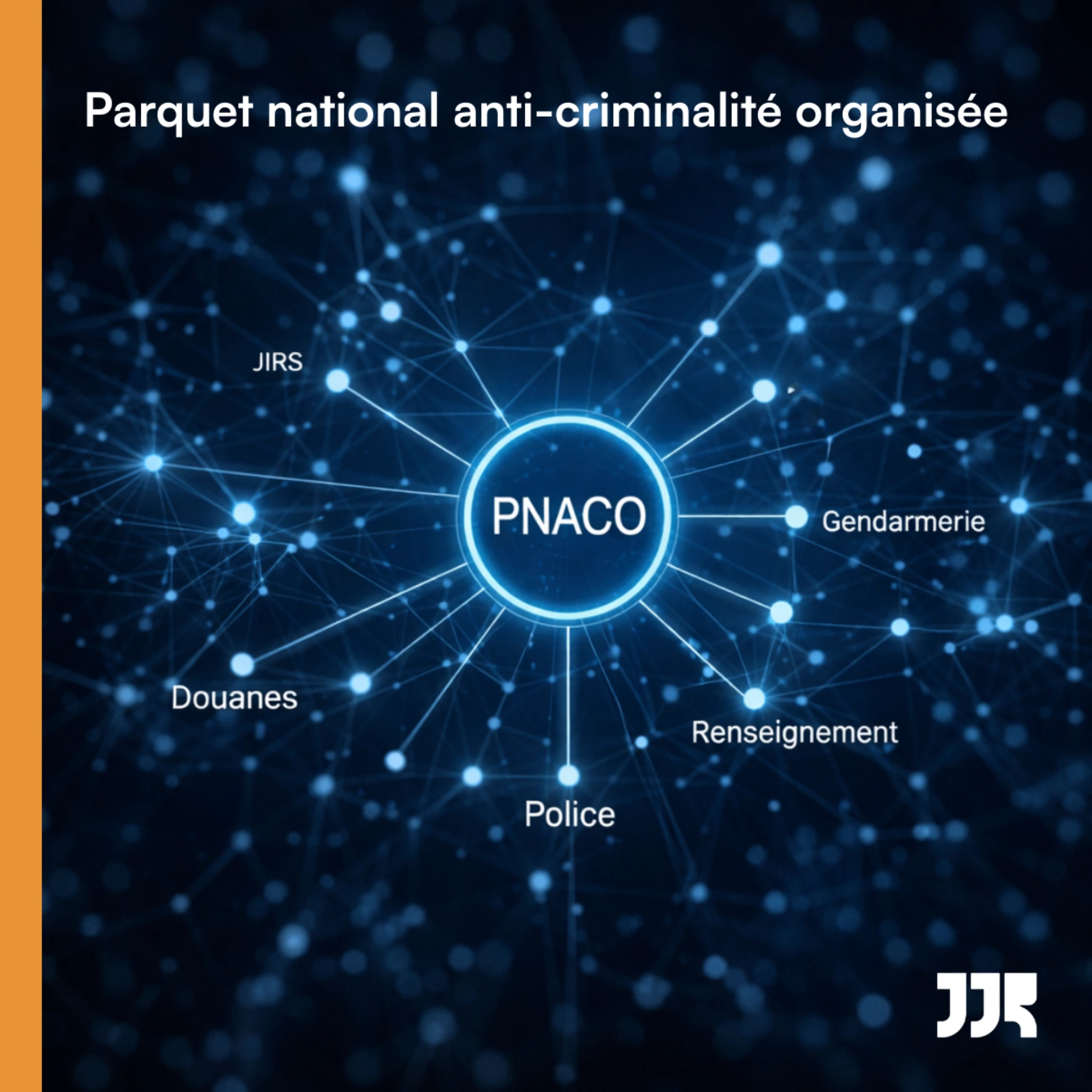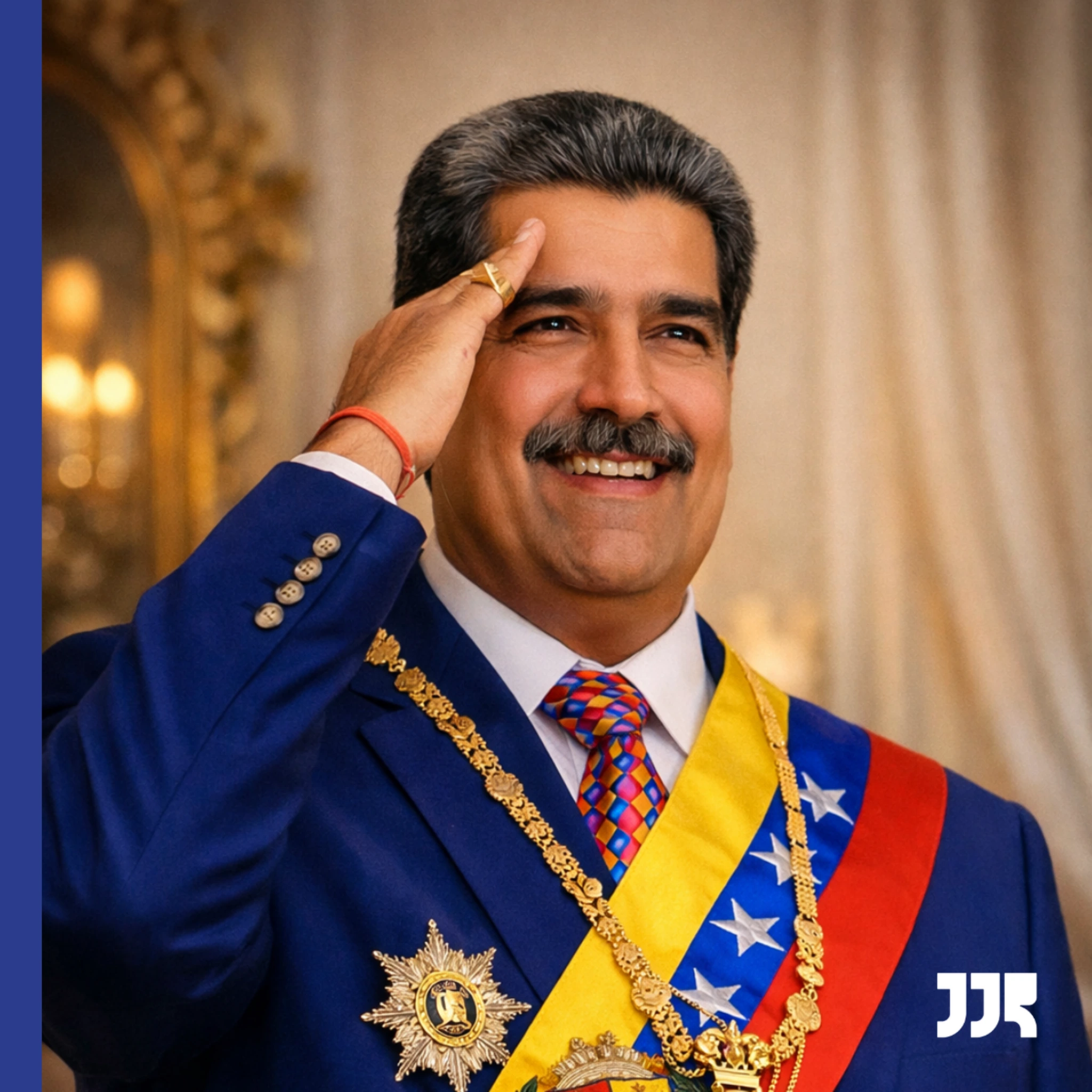Fondé dans les ruines de la guerre d’Irak, l’État Islamique (EI) a connu une ascension fulgurante avant d’être militairement défait. Mais en 2024, son idéologie reste vivace à travers des cellules dispersées et des affiliés régionaux. Retour sur l’évolution de l’organisation terroriste la plus redoutée de ces dernières décennies.
Des origines dans le chaos irakien
L’État Islamique, également connu sous le nom de Daech, prend racine en 2006 avec la création de l’État Islamique d’Irak (EII). Issu de la fusion de plusieurs groupes djihadistes, dont Al-Qaïda en Irak dirigé par Abou Moussab al-Zarqaoui, il profite de l’instabilité post-invasion américaine pour s’imposer.
En 2013, l’organisation étend ses opérations en Syrie sous l’appellation d’État Islamique en Irak et au Levant (EIIL), avant de proclamer un califat transfrontalier en 2014, sous la houlette d’Abou Bakr al-Baghdadi.
Les figures marquantes du leadership
Depuis sa création, l’État Islamique a été dirigé par plusieurs chefs emblématiques :
Abou Bakr al-Baghdadi (2014-2019) : Premier « calife » autoproclamé, il dirige l’organisation à son apogée avant de se suicider en 2019 lors d’une opération américaine en Syrie.
Abou Ibrahim al-Hachimi al-Qourachi (2019-2022) : Il prend la relève, tentant de maintenir l’unité du groupe jusqu’à sa mort en 2022.
Abou al-Hassan al-Hachimi al-Qourachi (2022-2023) : Un mandat bref, marqué par un net déclin opérationnel. Il est tué par des forces rebelles syriennes.
Abou al-Hussein al-Housseini al-Qourachi (2023 – aujourd’hui) : Leader actuel dont l’influence est limitée par la fragmentation de l’organisation.
Des attentats qui ont marqué le monde
L’État Islamique a signé certaines des attaques terroristes les plus meurtrières du XXIe siècle :
- Conquête de Mossoul (2014) : Symbole de l’expansion territoriale du califat.
- Attentats de Paris (2015) : 130 morts dans une série d’attaques coordonnées.
- Attentat de Nice (2016) : 86 victimes fauchées lors des célébrations du 14 juillet.
- Attentats de Bruxelles (2016) : 32 morts dans les transports publics.
À cela s’ajoutent de nombreux autres attentats revendiqués ou inspirés à travers l’Europe, l’Afrique et l’Asie.
Un financement à plusieurs visages
L’EI a bâti son financement sur une combinaison d’activités légales et criminelles :
- Ressources naturelles : Pétrole et gaz vendus sur le marché noir.
- Extorsions et taxes locales : Systèmes de prélèvement imposés dans les territoires contrôlés.
- Trafic humain : Exploitation et traite de femmes et d’enfants.
- Pillages : Commerce illicite d’antiquités et de métaux précieux.
- Dons privés : Provenant notamment de réseaux informels dans certains pays du Golfe.
Une menace évolutive en 2024
Aujourd’hui, l’État Islamique n’existe plus sous forme d’un État territorial, mais il reste une menace décentralisée :
- En Europe : Des attaques inspirées par l’EI, menées par des individus radicalisés, demeurent possibles.
- En Afrique : L’État Islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP) et d’autres affiliés gagnent du terrain dans le Sahel.
- En Asie : L’EI-Khorasan (IS-K) représente une menace persistante en Afghanistan et au Pakistan.
- Au Moyen-Orient : Malgré les pertes, des cellules actives continuent de sévir en Syrie et en Irak.
L’organisation s’adapte : moins visible mais toujours dangereuse, elle privilégie désormais l’action locale et la propagande internationale pour maintenir sa présence.
Une vigilance toujours nécessaire
Loin d’être éradiqué, l’État Islamique a su survivre à la perte de son califat en multipliant les relais régionaux. En 2024, sa menace repose autant sur sa capacité d’action que sur sa force de mobilisation idéologique. Les efforts de renseignement et de lutte contre le financement restent plus essentiels que jamais pour éviter une résurgence de son influence.