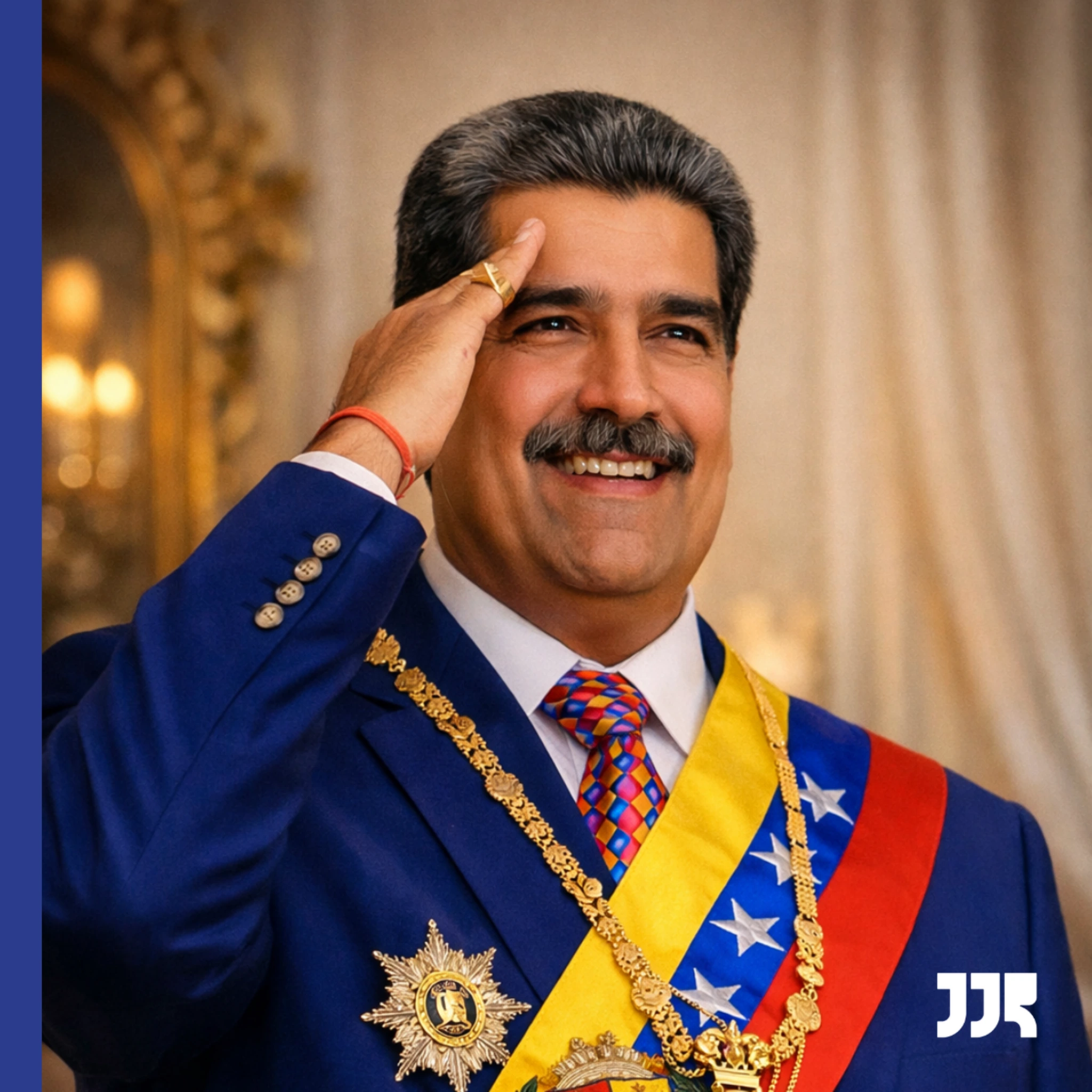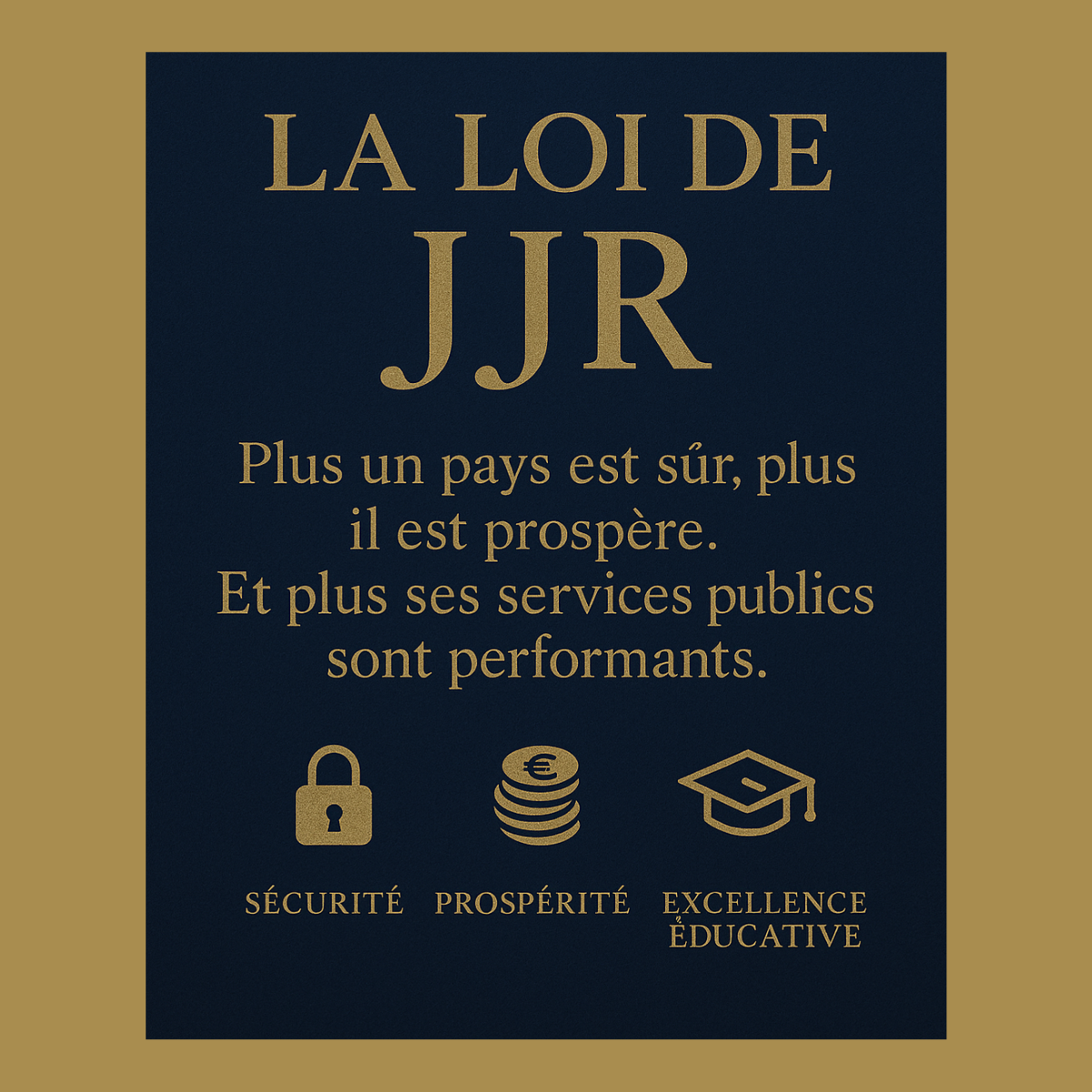L’assassinat de Mehdi Kessaci à Marseille n’est pas un « dérapage », c’est un message. Un crime d’intimidation assumé, que le ministre de l’Intérieur lui-même décrit comme un « point de bascule » dans la lutte contre le narcotrafic.
Face à ce choc, l’État affiche sa fermeté, multiplie les annonces et promet une contre-offensive massive. Mais si l’on regarde les chiffres, les réseaux et les flux d’argent, il y a une évidence s’impose qui est que ce sursaut ressemble davantage à un réveil en retard qu’à un changement de cap.
Un assassinat qui dit la vérité du rapport de force
Mehdi Kessaci, 20 ans, d’Amine Kessaci qui est un militant engagé contre le narcotrafic, a été abattu en pleine rue à Marseille le 13 novembre. Un commando à moto, une scène de guerre en plein jour, dans une ville déjà marquée par des dizaines de « narcohomicides » ces dernières années.
Les enquêteurs privilégient la thèse d’un crime d’intimidation visant à frapper un symbole au travers d’une famille qui a osé dénoncer publiquement les réseaux et leur emprise sur les quartiers.
Dans ce contexte, les trafiquants ne se contentent plus de régler leurs comptes entre eux, mais assument désormais de frapper celles et ceux qui contestent leur pouvoir, comme n’importe quelle organisation mafieuse installée. Ce n’est pas un épisode isolé, c’est un signal envoyé à tous. Le message est que : se mêler de narcotrafic, même pour le combattre, peut vous coûter la vie.
Pendant ce temps, l’État annonce des plans, des lois, des « opérations coup de poing ». Sur le terrain, policiers, magistrats et acteurs associatifs savent pourtant que le phénomène s’est enraciné depuis longtemps. Le système ne se fissure pas en quelques semaines de déclarations solennelles.
Une économie parallèle qui pèse des milliards
Derrière les kalachnikovs, il y a une comptabilité. En France, l’Office anti-stupéfiant (OFAST) estime qu’environ 240 000 personnes vivent directement ou indirectement du trafic de drogue, dont plusieurs dizaines de milliers à temps plein.
C’est l’équivalent d’une ville moyenne, entièrement irriguée par l’argent de la drogue.
Selon l’Insee et plusieurs travaux d’expertise, le chiffre d’affaires annuel des stupéfiants sur le territoire français tourne autour de 3 à 7 milliards d’euros, avec un minimum de 3 milliards retenu officiellement par les comptes nationaux, et des estimations qui montent au-delà dans certaines études.
En clair, c’est l’équivalent d’un grand secteur industriel, mais sans fiches de paie, sans cotisations, avec la violence comme mode de régulation.
À l’échelle mondiale, les ordres de grandeur donnent le vertige. Des travaux repris par des centres de recherche et des institutions internationales évaluent le marché des drogues illicites entre 300 et 500 milliards de dollars par an, faisant du narcotrafic l’un des tout premiers marchés criminels de la planète.
Selon l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), le seul cannabis représente plus de la moitié de ce marché dans certaines estimations, avec un volume global évalué à plus de 160 milliards de dollars.
En Europe, les agences spécialisées constatent une montée en puissance rapide de la cocaïne et des drogues de synthèse, qui grignotent chaque année un peu plus de parts de marché.
La France suit ce mouvement et le marché de la cocaïne est désormais en passe de dépasser celui du cannabis en valeur, porté par une offre surabondante, des prix en baisse et une pureté en hausse.
Avec une telle puissance financière, les réseaux peuvent tout acheter ou presque, comme la loyauté, les silences, des armes de guerre, des avocats très compétents et des façades « propres » pour recycler l’argent. Ils peuvent aussi corrompre ou financer des armées de guetteurs et de logisticiens, qui s’installent durablement dans des territoires où l’économie légale ne propose plus grand-chose.
La légalisation du cannabis, fausse solution miracle
Dans ce contexte, certains responsables politiques ressortent une idée séduisante sur le papier à savoir légaliser le cannabis pour « assécher » les trafics et concentrer les moyens sur la cocaïne et les drogues dures. En France, un rapport parlementaire récent plaide en ce sens, en prenant appui sur les exemples portugais, canadien ou allemand.
Que nous apprennent vraiment ces expériences étrangères ? Les données nord-américaines montrent un recul significatif du marché noir là où l’offre légale est abondante, compétitive et bien régulée.
Mais elles montrent aussi que le marché illicite ne disparaît pas, loin de là, et qu’il peut même se reconfigurer ou rebondir lorsque les prix légaux restent plus élevés ou que certains produits restent interdits.
Imaginer qu’une légalisation du cannabis en France ferait, par magie, s’évaporer les réseaux relève d’une naïveté sans nom. Les organisations criminelles ont toujours fait la même chose qui consiste à ouvrir les robinets B et C lorsque la source A est neutralisée.
L’histoire des mafias italiennes, de la ’Ndrangheta à la Camorra, le démontre, car, malgré des décennies de répression, de maxi-procès et de saisies spectaculaires, leurs chiffres d’affaires se comptent toujours en dizaines de milliards d’euros par an et sont toujours en expansion.
De fait, légaliser le cannabis ne supprimerait pas la demande de produits plus forts, plus dangereux, plus rentables, comme la cocaïne, le crack, la méthamphétamine ou les nouvelles drogues de synthèse. Les réseaux savent parfaitement où se trouvent leurs marges et ils ont la capacité de s’adapter beaucoup plus rapidement que les administrations.
Frapper fort, mais autrement que dans un éternel copier-coller
Faut-il renoncer à « frapper fort » ? Bien entendu que non. Il faut simplement arrêter de croire que la seule réponse pénale suffira. En France, les dernières années ont été marquées par des saisies record, des opérations « Place nette XXL », la multiplication des interpellations.
Mais, le résultat concret sur les quartiers est que les points de deal se déplacent, de nouvelles formes de livraison à domicile voient le jour, et les réseaux reconstituent leurs stocks en quelques semaines.
Dans les pays qui ont réussi à contenir et non pas à « vaincre » l’économie de la drogue, trois volets avancent ensemble. Une répression ciblée, concentrée sur les têtes de réseau et le blanchiment. Une politique sanitaire sérieuse, assumant la réduction des risques, l’accès aux soins, le suivi des addictions. Et un travail de fond sur l’école, l’emploi, l’urbanisme, bref, tout ce qui fait qu’un adolescent ne voit pas le point de deal comme seule perspective de promotion sociale.
Dire que cette « guerre » ne sera pas gagnée peut sembler défaitiste. Toutefois, refuser le mythe de la victoire totale, c’est se donner une stratégie de long terme qui consiste à limiter les dégâts, contenir la violence, affaiblir les empires criminels sans promettre ce que personne n’a jamais réussi à obtenir.
Mettre enfin le consommateur face au miroir
Enfin, gardons bien à l’esprit qu’aussi longtemps qu’il y aura une demande, l’offre sera toujours au rendez-vous. Aussi longtemps que des millions de fumeurs de joints du vendredi soir ou que des cadres prendront, leur dose de coke pour tenir en semaine le marché s’organisera.
En France, plusieurs millions de personnes déclarent avoir consommé du cannabis au cours de l’année, et la cocaïne s’est banalisée dans certains milieux festifs et professionnels.
Chaque gramme de drogue acheté nourrit des guetteurs de 14 ans et amplifie les violences sous toutes ses formes.
Regarder le narcotrafic en face, c’est accepter une équation dérangeante qui est que, tant que la société considérera l’usage comme un geste anodin, presque banal, les réseaux continueront à prospérer. L’État peut se réveiller, se durcir, voter des lois. Mais sans un travail massif sur la demande, sur le sens de ces consommations, il ne fera qu’accompagner, de loin, l’extension d’un marché qui a déjà appris à vivre avec les coups de filet, les plans d’urgence et les hommages nationaux.